
Annie Arnoult
La grande histoire des scieurs de long
Les quelques lignes de cette page, publiées avec l’accord de l’auteur, ont pour objet de vous permettre d’appréhender les difficultés de la vie des paysans auvergnats au cours des siècles derniers, et de montrer pourquoi beaucoup d’auvergnats ont fait souche en dehors de leur terre d’origine. C’est vrai également pour les maçons de la creuse et bien d’autres régions dont les autochtones s’étaient fait un renom dans une spécialité donnée. Si vous êtes intéressés par l’histoire de ces hommes je vous invite à acheter les deux magnifiques ouvrages qui la racontent chez...
Annie ARNOULT Lieu dit Cétéreau
42110 Sainte Foy Saint Sulpice
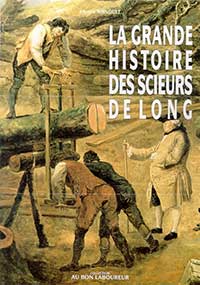
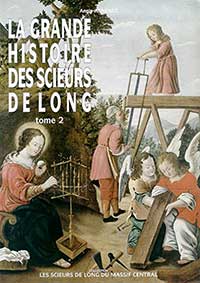
Quand grande pauvreté et surpeuplement rimaient avec émigration
Si tous ces hommes allaient à la scie, c’était
par nécessité, et non pas par goût des voyages,
plusieurs causes s’alliant entre elles. Le climat, avec des hivers
neigeux et sans fin, contraignait ces montagnards à une trop
longue période d’inactivité.
L’Abbé Ordinaire écrivait, en 1802, dans son manuscrit
: Dans l’arrondissement communal d’Ambert, comme dans celui
de Thiers, c’est à dire, dans toute la chaîne orientale
des montagnes de ce département, une multitude d’habitants
s’expatrient pendant la saison où la neige couvre la terre.
Cette émigration que le Conseil d’Arrondissement d’Ambert
porte pour son ressort à six mille individus, procède
essentiellement à la longueur dont y sont les hivers, de l’abondance
prodigieuse des neiges, et de l’extrême retard de leur fonte.
Les hommes inutiles à la terre durant sept mois consommeraient
à pure perte chez eux pendant tout ce temps. Si l’émigration
est relativement plus forte dans cet arrondissement que dans les autres,
c’est que son sol est vraiment plus malheureux.
C’était avant tout des paysans. Ils vivaient ou survivaient
de la culture, de l’élevage et de l’exploitation
forestière. Les scieurs de long se recrutaient aussi bien parmi
les petits propriétaires, que parmi ceux qui n’avaient
aucun bien, à ces laboureurs, se joignaient de modestes commerçants
et artisans.
Leurs sols étaient pauvres, mal exploités, donnaient des
récoltes insuffisantes et irrégulières, des calamités
n’ont rien arrangé et ont entraîné des famines.
Les années : 1630, 1694, 1697, 1709, 1710, 1770 furent cruelles,
avec des hivers et des printemps particulièrement froids qui
gelaient toutes les cultures, auxquels s’ajoutaient les épizooties
et les désastres laissés par les gens de guerre après
leur passage.
Les charges et les impôts seigneuriaux, religieux et royaux écrasaient
les populations. De plus, chaque scieur de long devait cotisé
et devait acquitter une taxe d’industrie, calculée en fonction
du pécule rapporté, comme le confirmaient les rôles
de taille tarifée.
Des écrits accablants
André Simon du village* de Mervillon, paroisse de Sauvain (42)
et Marie Savatier du village de Dizangou se sont mariés le 9
septembre 1741. En 1747, le curé a délivré à
A. Simon un extrait de son acte de mariage et ajoutait:
Voici un passage d’un mémoire anonyme rédigé
vers 1787-1789:
Tous les seigles étant semés au mois de septembre, et
les femmes suffisant pour le soin des bestiaux, la plupart des hommes
sortent et se répandent dans le Royaume, avec leur pioche ou
leur scie pour chercher de l’ouvrage, parce que la nature de leur
terre et la dureté du climat ne leur laissent rien à faire.
Et qu’il leur faut pour payer les charges des numéraires
que les productions de leur sol ne leur procurent pas entièrement.
Pour payer les impôts ils y suppléent par l’émigration
annuelle, ils vont exploiter une partie des forêts de toute la
France.
Rapport du 21 novembre 1787 à l’assemblée provinciale
d’Auvergne
On ne peut attribuer la dépopulation prodigieuse de l’Auvergne
qu’à la surcharge de l’impôt qui ôte
aux malheureux laboureurs tout moyen de subsistance et les force à
s’expatrier pour chercher dans les climats étrangers les
secours qu’ils ne peuvent trouver dans la province.
Pour l’Abbé Ordinaire: le Gouvernement n’a même
jamais ignoré que sans les recours en numéraire que ce
moyen produit au département, les impositions ne pourraient être
acquittées. Les régimes successoraux apportaient une charge
supplémentaire, notamment en cas d’héritier universel,
contraint de dédommager ces cohéritiers et de régler
d’autres dépenses familiales. Il n’était pas
rare de voir réapparaître, après une longue absence,
un scieur de long venu toucher sa part ; d’héritage, puis
disparaître aussi discrètement qu’il était
arrivé, cette fois pour toujours. Pour servir en temps de guerre,
tant que le recrutement de la milice se limitait à un ou quelques
hommes par paroisse il n’avait pas suscité de situation
particulière.
Le problème s’est corsé avec les levées obligatoires.
Avec la Révolution, si certaines charges ont diminué,
en contrepartie l’instauration du devoir militaire fut créée.
Les jeunes gens qui tiraient un mauvais numéro se voyaient embrigadés
pour de longues années, et devaient-ils s’estimer heureux,
s’ils avaient échappé aux massacres des guerres
napoléoniennes, ou autres batailles.
En dépit des risques encourus, beaucoup préféraient
déserter que de se soumettre aux lois de la conscription, ils
choisissaient de s’expatrier dans quelques forets lointaines
Les familles étaient regroupées par feux, voire par communautés
villageoises. Les communautés familiales étaient fréquentes
dans ces régions.
Malgré le fort taux de mortalité infantile et de mortalité
épidémique, les familles étaient nombreuses, trop
nombreuses. Cette surpopulation était inconciliable avec les
ressources insuffisantes des foyers.
Aussi, pour les plus pauvres, un parent parti, c’était
une bouche de moins à nourrir.
Jean Couty, né vers 1830, habitant au village de Donzenat commune
de Nedde dans la Haute-Vienne était scieur de long. Il s’est
marié le 17 septembre 1861 avec Anne Noillier. Voici ce qui était
stipulé dans leur contrat de mariage :
Article9e – Léonard Noillier (le futur beau-père)
s’oblige de loger, nourrir, blanchir, chauffer, éclairer,
entretenir et soigner tant en santé qu’en maladie les futurs
époux et leurs enfants à la charge pour eux de travailler
de leur mieux à l’utilité de la maison commune.
II est convenu; que le futur époux pourra, du consentement auprès
de son beau-père, aller travailler à la campagne de son
état de scieur de long, à la charge pour lui de payer
chaque année d’absence la somme de quarante francs payable
à la St Jean Baptiste…
Trouver une alimentation plus abondante au loin, laisser son pays froid
pour passer l’hiver dans un endroit où le climat était
plus doux, ces deux facteurs encourageaient également au départ.
Heureusement, le caractère de l’Auvergnat facilitait son
intégration.
Dès l’adolescence aller à la scie, l’instinct
d’imiter, de faire pareil que les autres, devenait une tradition.
Les histoires du grand-père racontées aux veillées,
avec tous les détails sur ses exploits d’antan, et sur
ses pérégrinations, incitaient les garçonnets à
partir.
Dans ces milieux on était scieur de long de père en fils….
Même modiques, les gains rapportés par les premiers encourageaient
à l’exode, avec l’obsession chez le paysan d’agrandir
sa propriété en achetant quelques arpents de terre supplémentaires,
sans oublier l’idée de se protéger contre un éventuel
accident grave ou maladie et contre la vieillesse.
Comme le dit si bien Henri Pourrat :
Quand un Auvergnat trouve un biais pour se faire de l’argent,
il appelle toujours ceux de son pays.
Pour toutes ces populations, le phénomène migratoire,
une fois enclenché, devenait irréversible.
D’où partaient-ils ?
Les scieurs de long étaient tous originaires des régions
pauvres, à vocation forestière, et se situant en zones
montagneuses.
Si les Landais, les Pyrénéens, les Savoyards etc…
ont émigré, la plus grosse concentration de ces scieurs
de long se trouvait dans le Massif Central, dans les anciennes provinces
d’Auvergne, du Lyonnais, du Limousin et de la Marche… correspondant
de nos jours aux neuf départements suivants:
Le Puy-de-Dôme (63), arrivait largement
en tête avec le plus gros contingent de scieurs de long partis
principalement du quart sud-est et de l’ouest: les Monts du Forez,
les Monts du Livradois, les Monts Dore.
La Loire (42), partis de l’ouest: les Monts de la Madeleine, les
Bois Noirs, les Monts du Forez.
La Creuse (23), partis du sud-est: le Plateau de Millevaches, le Plateau
de la Marche.
La Haute-Loire (43), partis du nord et de l’est: le Plateau du
Velay.
La Corrèze (19), partis du nord-est: le Limousin, le Plateau
de Millevaches, les Monedières.
La Haute-Vienne (87), partis du sud-est: le Limousin, le Plateau de
Millevaches.
Le Cantal (15), partis du centre et du nord-est: le Cezallier, les Monts
du Cantal.
La Lozère (48), partis du nord-est: les Monts de la Margeride,
le Haut-Gévaudan.
L’Aveyron (12), partis du nord-centre et ouest: les Plateaux ou
Monts d’Aubrac, de la Viadène, de Carladez, du Ségala,
du Haut-Rouergue.
Extrait du magazine "Cartes postales de collection"
n°174 juin/ juillet 1997 pp 3 à 15
Au temps où les planches se
nommaient des ais, les scieurs de long étaient des soyeurs d'ais,
puis des scieurs de long-bois et enfin des scieurs de long. L'auteur dramatique
Jean-François Regnard écrivait en 1708 dans son Légataire
Universel : "Mon oncle soyez sûr que je ne partirai qu 'après
vous avoir vu bien cloué, bien muré, dans quatre ais de
sapin, reposer à votre aise."
Avec le temps, si le mot évolue, la technique ne change pas. Au
début de notre siècle, le scieur de long poursuit une tradition
de belle ouvrage avec les mêmes gestes, les mêmes attitudes
que ses compagnons du Moyen Âge et de l'antiquité.
l'arbre - le bois
L'abattage des arbres, destinés à être débités
par les scieurs, se fait entre octobre et avril, pendant le repos de la
végétation. Ils sont, selon leur destination, choisis en
fonction de leur espèce, de leur âge, de leur dureté,
et coupés pour obtenir un fût le plus long et le plus droit
possible. De strictes règles, basées entre autres sur les
phases de la lune, régissent périodes et façons de
coupes. En ce domaine, la compétence du scieur de long est au moins
égale à celle du bûcheron. Après avoir été
écimé et ébranché le tronc de l'arbre, devient
une grume. Celle-ci est tronçonnée, ébillonnée,
transformée en billes. Rien n'est gaspillé, toute partie
soigneusement recueillie est utilisée. Les maîtresses branches
servent pour la fabrication des sabots ou du charbon de bois, les autres
liées en fagots, approvisionnent pauvres et riches en bois de chauffage
et alimentent les fours du boulanger, du verrier, du tuilier... Jusqu'à
l'écorce des jeunes chênes qui est rassemblée en bottes
et acheminée vers les tanneries.
ils sont partout
Les scieurs de long pratiquent directement sur les chantiers de constructions
de bâtiments, des édifications d'ouvrages d'art, de la marine,
de la batellerie, des chemins de fer, des mines...
Ils plantent leur décor dans la rue, sur la place de la ville ou
du village, dans les granges. Sur le chemin de l'école, les gamins
s'accordent un moment pour les admirer, fascinés par leur rythme
et leur cadence d' automates. Comme les lavandières, le photographe
les néglige, les oubliant en petit plan dans un coin du cliché.
Ils font partie du paysage. Ils s'activent devant la boutique des charrons
et des menuisiers, sur le quai des ports, à la lisière des
bois, au cœur des forêts sur les lieux des coupes. Ils se déplacent
facilement de chantier en chantier, transportant scies, haches, chaînes
et passe-partout.
Les scieurs de bois s'installent directement
sur les chantiers qui vont utiliser leur production. Les vues générales
de ces chantiers de travaux publics, de constructions d'immeubles et bien
sûr de constructions navales laissent nécessairement apparaître
plusieurs chevalets de scieurs de bois.
Existait-il comme ici à Riom beaucoup de ces foires aux planches
? Les scieurs devaient à cette occasion trouver leurs prochains
chantiers et leurs futurs patrons. Quelle meilleure façon de donner
aux spécialistes la possibilité d'apprécier le travail
de chaque équipe.
Les scieurs de long propriétaires
d'une scierie, d'un magasin de bois, travaillent à leur compte
et emploient souvent plusieurs ouvriers.
Les adjudicataires de coupes, les marchands de bois ou les propriétaires
forestiers embauchent des équipes de scieurs de long. Patrons et
ouvriers vivent de ce métier qu'ils pratiquent une grande partie
de l'année voire à plein temps. Les charpentiers, les menuisiers,
les ébénistes, les charrons, les tonneliers sont de gros
consommateurs de planches, de plateaux, poutres, chevrons, voliges...
Ces artisans achètent leur matière première toute
sciée, ou façonnent eux-mêmes le bois nécessaire
à leur entreprise devenant pour un temps scieurs de long. Les paysans,
habitués à vivre en autarcie, savent manipuler la grande
scie et débitent planches et poutres dont ils ont besoin pour se
meubler, construire, agrandir, rénover l'habitat et ses dépendances.
Les outils
L'outillage est sommaire. Les éléments métalliques
seuls se conservent, l'attirail de bois est réalisé sur
chaque chantier. Ainsi, le chevalet, support destiné à maintenir
les billes pour la coupe est fabriqué avec les matériaux
trouvés sur place. Les outils sont peu nombreux mais revêtent
une multitude de formes propres à chaque région, non seulement
en France mais dans le monde entier.
Le chevalet
Il existe plusieurs modèles de chevalets. Le plus simple, utilisé
par les Auvergnats, est formé par un tronc de 4 à 6 m de
long, surélevé à une extrémité à
hauteur d'homme, pour permettre au renard de se tenir debout, et maintenu
par deux pieds obliques venus s'encastrer à grands coups de masse.
La partie arrière touchant le sol s'appelle la queue ou culotte,
elle concourt à stabiliser l'ensemble. Le méplat de la queue
est entaillé d'encoches qui servent à la fois pour le ripage
de la bille à positionner et d'escalier au chevrier, véritable
homme singe.
Les scies
Ils utilisent la grande scie à cadre ou, souvent en Normandie,
le cran. La première est formée d'un cadre en bois de sapin,
hêtre... composé de deux montants d'environ 1,50 m de long,
de deux sommiers de traverse d'environ 1 m de large munis chacun d'une
poignée. L'ensemble se monte et se démonte aisément.
Au milieu est placée une lame fixée à chacune de
ses extrémités par des clavettes engagées dans des
anneaux. Anciennement, la lame était raidie par de simples cales
en bois placées de part et d'autre ; par la suite, l'anneau supérieur
fut muni d'une vis de serrage, d'un tendeur à écrou, avec
des coins. La lame peut être déplacée à l'intérieur
du cadre lorsque la grosseur de la bille interdit tout mouvement de côté
du cadre. Lorsque les grumes sont particulièrement grosses on construit
spécialement un cadre hors norme. Le cran est une scie sans châssis,
constituée uniquement par une lame de forme trapézoïdale
avec, aux extrémités deux poignées aux bras directement
rivés dessus, elle est plus épaisse et donc plus rigide
que celle montée sur châssis. On l'utilise pour scier des
troncs de gros diamètre comme le célèbre chêne
Raoul de la forêt de Bonsecours. Le passe-partout est une scie formée
d'une large lame, munie à chaque extrémité d'une
poignée et dont l'emploi exige aussi deux hommes.
Les hommes
Une équipe de scieurs de long comprend trois personnes : le doleur,
le chevrier et le renard. Le doleur ou bûcheur est le chef d'équipe,
il a acquis son autorité par son habileté à aiguiser
les lames d'outils et par son esprit d'entreprise ; il s'occupe aussi
des repas. Le chevrier est le scieur d'en haut, le renard, le scieur d'en
bas. Plusieurs équipes constituent une brigade ; dans ce cas un
doleur suffit pour quelques paires de scieurs de long. Levés alors
qu'il fait encore nuit, ils sont prêts à empoigner la scie
jusqu'au soir. Aux dernières lueurs du crépuscule, ils la
troquent contre le passe- partout et tronçonnent les billes devant
être sciées le lendemain.
Le travail
L’équarissage
Dès que les bûcherons ont abattu les arbres marqués,
les scieurs se mettent à l'ouvrage. Le doleur écorce puis
équarrit avec sa lourde hache les deux ou quatre faces de la bille
(tronc d'arbre ébranché et débarrassé des
nœuds). Elle est pour cela posée sur un chevron transversal
le chantier, qui la rehausse d'une dizaine de centimètres ; des
crampons métalliques, les clameaux la stabilisent. Équarri,
le tronc présente quatre faces planes formant une section carrée.
La préparation
Le doleur trace, à l'aide d'un cordeau enduit d'une poudre colorée,
autant de lignes parallèles que de planches réalisables.
Il faut calculer au plus juste pour obtenir le maximun de débits
dans la même bille.
La bille ainsi préparée est hissée sur le chevalet,
à force d'homme sur l'épaule, ou roulée par la queue
du chevalet en la faisant riper ; certains s'aident d'un cric de voiturier
ou d'une chèvre de charpentier. Elle est ensuite solidement attachée
par une chaîne et des coins. Afin d'éviter le mouvement de
balancier, ils placent de gros rondins au pied de la queue ou carrément
l'attachent par une chaîne à un arbre ou un pieu. La bille
surplombe le support d'un peu plus de la moitié de sa longueur.
Certaines cartes nous montrent des positions de la bille et du chevrier
qui semblent défier toutes les lois de l'équilibre. Il y
a du funambule chez ces scieurs de long.
Le sciage
Le chevrier grimpe en escaladant la queue du chevalet. Soit il quitte
ses sabots et se tient à pieds déchaux, soit il chausse
des souliers ferrés à griffes pointues pour conserver plus
d'adhérence. Contre le froid et contre les échardes, il
enfile des chaussettes à la semelle renforcée d'une toile
de chanvre. Au sol, le renard lui fait face, jambes écartées.
Il est couvert d'un chapeau à larges bords, ou d'un vieux sac de
toile pour éviter de recevoir de la sciure dans les yeux. Les dents
de la lame sont crochues, elles ne mordent le bois qu'en descendant. C'est
donc le renard qui scie. Pour empêcher que la lame soit coincée,
il enfonce un coin d'ouverture, le bondieu dans la coupe, avec le dos
de la cognée. Il l'ôtera avec la masse ou le chasse- bondieu.
Le chevrier remonte la scie en l'écartant légèrement
de l'entaille et la guide en fixant son regard sur le trait de scie. Il
progresse en reculant. Le travail est équitablement réparti
entre compagnons. Arrivés à hauteur du chevalet, ils s'arrêtent,
font pivoter la bille et attaquent l'autre côté.
La signature des scieurs de long
Ils stoppent leur manœuvre à quelques millimètres du
premier passage, dégagent la scie, détachent la bille et
la jettent à terre. Une ligne rugueuse, la signature ou jetée
de sciage, apparaît alors, marquant la jonction des deux traits
de scie. (Dans un magazine récent, un antiquaire vantant sa marchandise
précisait : toutes mes armoires portent au dos la signature des
scieurs de long).
Les bois trop durs obligent deux renards à tirer la scie. Ils redoutent
également les pins à cause de leur sève qui poisse
tout : outils comme vêtements.
Le salaire
La durée d'une journée de travail est conditionnée
par la lumière du jour. Les scieurs de long réputés
pour leur endurance s'échinent quotidiennement de 12 à 15
heures, pour une maigre rémunération.
Ils sont payés à la journée ou à la pièce.
"Avant que je n'aille plus loin, il vous faut savoir que les scieurs
de long, au temps de ma jeunesse, travaillaient souvent pour un salaire
de journée assez misérable qui tournait autour de huit réaux
(le réal vaut cinq sous), rarement plus. Aussi, les gars ménageaient-ils
leurs forces, faisant aller leur scie sur un rythme économe qu'ils
scandaient ironiquement en disant : sept à huit réaux et
trois sous percés. Et le patron en avait pour son argent, pas beaucoup
plus. Mais quand ils étaient payés à la tâche,
la scie de deux compères, celui du haut et celui du bas, montait
et descendait comme un trait d'éclair parce qu'il leur était
possible de gagner, en s'échinant de l'aube au crépuscule,
un écu de plus (l'écu vaut trois francs)." Pierre-Jackez
Helias La nuit des Vivants
un metier de nomades
L'histoire du Massif Central est marquée par celle des migrations
saisonnières de ses habitants. On évoque habituellement
celles des maçons creusois, des ramoneurs savoyards ou des nourrices
morvandelles, mais n'oublions pas les scieurs de long auvergnats, foréziens
et limousins qui par milliers quittaient à l'automne leur village
et ne rentraient qu'au début de l'été suivant, se
plaçant sous la protection de saint Simon leur saint patron. A
l'époque les déplacements se faisaient à pied et
chacun devait posséder un passeport indiquant ses lieux de départ
et de destination. Ces documents que l'on peut encore retrouver aujourd'hui
permettent de retracer les itinéraires par le jeu des visas municipaux
apposés à chaque étape. Voici un des rares témoignages
d'un ancien scieur de long, M. Jean-Marie Tournebize de Valcivières
(Puy-de-Dôme).
« Dans le temps, à Valcivières, il y avait énormément
de scieurs de long qui émigraient. Cette façon de scier
était également très répandue ici. Lorsque
les gens voulaient faire des réparations chez eux, à la
grange, à l'écurie ou ailleurs, ils sciaient comme ça.
Il n'y avait pas beaucoup de scieries. J'avais 17 et 18 ans quand je suis
parti en Normandie en 1924 et 1925, en remplacement d'un scieur de long
dont la femme était malade. Nous étions douze ou treize
à émigrer ensemble, nous constituions plusieurs équipes.
Juste avant le départ, nous nous rendions à la mairie pour
remplir les formalités. «Nous prenions le train à
Ambert pour Paris, à Paris nous changions pour la Normandie. Arrivés
là-bas, celui qui nous avait embauchés, nous avait dit :
Venez avec moi, je vais vous faire voir où vous travaillerez, et
dans quelle ferme vous logerez .De coucher dans le foin ça ne nous
faisait rien, mais mon frère avait emmené sa femme. Il n'y
avait pas longtemps qu'ils étaient mariés et ne souhaitaient
pas coucher avec nous. Alors le patron leur avait offert la maie comme
lit. C'était étroit, ils s'allongeaient tête-bêche,
et devaient abandonner leur couchette pour quelques jours quand c'était
le moment de faire le pain. Ma belle-sœur nous préparait les
repas. On sciait des traverses pour les chemins de fer. Quelquefois, un
paysan nous demandait de lui scier des planches, des poutres... Nous étions
costauds, nous montions le morceau de bois sur l'épaule pour le
poser et le fixer sur le chevalet. Sur le chantier nous rigolions, nous
chantions. «On travaillait tous les jours de la semaine. Notre seul
moment de repos était le dimanche après-midi. Nous allions
dans un petit patelin acheter des provisions, et nous attabler au café.
Le patron nous payait toutes les deux ou trois semaines. Il nous partageait
les sous, c'était assez intéressant, on se faisait un bon
petit pécule. Partis à l'automne, nous rentrions à
la Saint-Jean pour les foins, pour semer le grain, pour planter les pommes
de terre, et pour panser le bétail. «Mes parents étaient
paysans, ils possédaient une jasserie aux Supeyres, alors fallait
bien que quelqu'un monte pour garder les vaches sur la montagne. Tous
mes frères sont partis scieurs de long : chitayes. Je me suis marié
en 1928. Avec ma femme, nous avons habité Gourbeyre. Nous avons
monté une petite usine où nous fabriquions des lacets pour
les chaussures."
l'humour des scieurs
Depuis les salles de garde jusqu'aux salles de police, tous les corps
de métiers ont un répertoire chansonnesque assez gaillard.
Les scieurs de long, ont par la force des choses, hérité
d'un humour, on ne peut plus scatologique, basé sur la prononciation
chuintante faussement attribuée aux Auvergnats. On voit tout de
suite l'humoristique parti que l'on peut tirer de tout un vocabulaire
à base de scie, scierie, sciant et autre scieur. Nous passerons
sous silence les multiples versions de La chanson des scieurs de long
pour nous arrêter sur quelques extraits du grandiose monologue Adieu
Auguchtin, Auguchtin adieu qui réunit, sous la forme d'une oraison
funèbre parodique, toutes les modulations possibles et imaginables
du thème :
Tu étais bon et brave scieur de long Augustin, tu sciais le jour,
tu sciait la nuit, tu sciais dessus, tu sciais dessous, tu sciais en large,
et tu sciais en long, tu sciais partout,...
[...]Le jour du concours des scieurs de long, c'est toi qui scias le plus
gros tas. Quinze jours avant ta mort tu es resté sans scier, je
crois bien que c'est ça qui t'a rendu le plus malade, car pour
un scieur de long consciencieux, ne plus pouvoir scier, quel atroce supplice.
A vous de traduire en chuintant les s et c !.. Et on rigole ! !
la fin d'un metier
Cette pratique déjà utilisée
dans l'Antiquité romaine, a traversé allègrement
de nombreux siècles. Elle s'essouffle à la fin du XIX°
et au début du XX°, avec l'arrivée des scieries ambulantes
actionnées par les locomobiles à vapeur. En Europe, elle
disparaît définitivement dans les années 1950. Ainsi
s'éteint une activité spectaculaire et toute une tradition.
Désormais, les scieurs de long, qui comme les missi dominici allaient
par deux, débitant à longueur de journée de longues
pièces de bois dans le sens du fil, sont entrés dans le
dictionnaire des métiers disparus, entre le scieur de blé
et le scribe, et leurs grandes scies sont devenues des objets admirés
dans les écomusées.