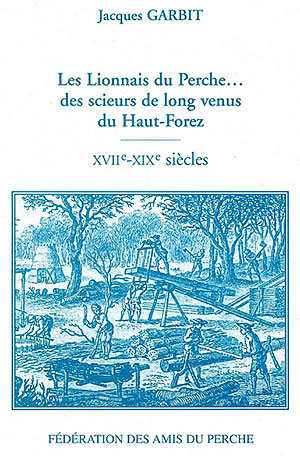Les Lionnais du Perche
Jacques Garbit, présentation
Article sur le site Persée 2004
Voici une monographie originale sur une migration saisonnière : celle des scieurs de long du Forez, dans le Perche, migration de travail qui a pris fin au XIXe siècle avec les progrès mécaniques. Le terroir émetteur est bien délimité : le plateau de Saint-Bonnet-le-Château, en Forez, à la limite de l'Auvergne (département de la Loire). Le terroir récepteur est bien ciblé : le bocage du Perche et ses forêts (qui couvraient une partie du département actuel de l'Eure-et-Loir), un Perche écartelé, sous l'Ancien Régime, entre les généralités de Tours, Alençon et Orléans. Le surnom de « Lionnais » s'explique par le fait que le plateau de Saint- Bonnet a été rattaché à la généralité de Lyon, créée au milieu du XVIe siècle (« Lyon » figure alors en tête de tous les documents officiels). Dans le Perche, l'appellation « Lionnais » devient générique pour désigner indifféremment le métier et l'origine géographique et s'applique aux scieurs de long des paroisses auvergnates voisines. L'administration d'Ancien Régime signale les départs groupés, « au mois de septembre après avoir levé leur moisson et fait leurs semailles », de « sept à huit cents » scieurs de long et pionniers. Cette migration saisonnière est une migration de maintien : elle doit permettre de transmettre intégralement la propriété à l'héritier unique. La migration n'est, en théorie, qu'une parenthèse dans un continuum rural. Mais il s'agit aussi d'une migration de rupture : si ceux qui sont rappelés par les besoins de la « maison » reviennent, d'autres, les cadets surtout, transforment leur migration saisonnière en migration définitive : on saute un retour, puis deux... Il arrive même que le maître scieur ne rentre pas au pays et attende sur place l'équipe de l'année suivante, finissant par se fixer sur les lieux d'accueil. Grâce à un patient dépouillement d'archives, le généalogiste retrace ces fixations viagères. On part des mêmes paroisses, des mêmes familles, pour se diriger vers les mêmes paroisses. Ces constats sont dans le droit fil des travaux de J.-P. Gutton, d'A. Poitrineau ou de l'excellent travail de Bernard Brunei sur « Augerolles-en- Livradois-Forez ». On regrette de ne pas trouver la fresque déjà ancienne, mais toujours féconde, d'Abel Châtelain qui met en perspective, pour toute la France, les migrations forestières. Toutefois, l'approche de J. Garbit offre les avantages de son « resserrement » : l'image est claire. L'auteur nous rappelle les raisons des migrations montagnardes : climat, médiocrité des terres et des méthodes agraires, pression démographique forte, crises de subsistance, manque de liquidités pour constituer les dots, instituer les héritiers, payer les légitimes, rembourser les prêts (usuraires), acquitter les impôts, etc. Et, qui sait, l'appel du large... L'expérience des habitants des Monts du Forez en matière de coupe, de sciage et de débardage sur les pentes les a fait apprécier dans de nombreuses régions. Le vrai protagoniste de cette étude est le métier lui-même. Le sciage de long est représenté par de nombreuses illustrations, allant d'images de l'époque gallo-romaine à des planches de U Encyclopédie ou à des photos anciennes.
« Partir à la scie », cela suppose environ quinze jours de marche pour parcourir 380 km. La route se fait en groupe afin d'éviter aléas et tentations. En tête, marchent le maître scieur et les anciens. On suit d'abord l'axe de la Loire, puis on coupe en direction d'Orléans, où l'on franchit le fleuve, après être passé soit par Ambert, Thiers et Saint-Pourçain, soit par Montbrison, Lapalisse et Châteauneuf- sur-Loire ; mais on peut aussi traverser la Sologne pour atteindre Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Sur tous ces itinéraires, les migrants laissent des traces - parfois dans les registres des hôpitaux.
Avant le départ, les accords sont conclus entre le maître scieur et ses compagnons (souvent illettrés) devant notaire, mais aussi verbalement ou sous seing privé. Les maîtres scieurs recrutent des brigades qui se retrouvent pour plus de sûreté sur les itinéraires habituels. Ces hommes ont leurs auberges ou leurs granges, leurs chants de route, tout comme ils auront sur le chantier leurs chants de travail. Arrivés sur place, ils s'installent soit au village, soit en forêt, dans des loges, sortes de cabanes en rondins. Les troncs à scier leur sont apportés à l'aide de bêtes de trait.
Le maître scieur est seul responsable du travail devant l'employeur, perçoit l'argent du marché, donne à chacun ses acomptes, se rembourse des frais qu'il a avancés et procède au règlement définitif en fin de campagne. L'argent épargné permettra de consolider la propriété ou d entrer en gendre dans une bonne maison. Mais on peut aussi trouver la mort ou la mutilation sous quelques billes de bois.
Pour saisir les usages du Forez (parler local, etymologies, dictons, etc.), l'auteur, descendant des « Lionnais du Perche », a bénéficié d'une aide précieuse en la personne de Marguerite Gonon, enfant du pays et médiéviste, décédée en 1996. Quant à la terre d'accueil qu'on nous présente, elle n'est nullement exotique : on passe le plus clair de son temps en forêt, dans l'entre soi. Quels rapports les scieurs entretiennent-ils avec la population du bocage à l'habitat dispersé, outre les rencontres éventuelles dans ces lieux géométriques que sont la taverne ou l'église? Le fait est qu'on finit bien par se rencontrer, se faire embaucher à la ferme d'à-côté, épouser la fille de la maison... J. Garbit s'attache à relever les croyances communes au Forez et au Perche et les connexions langagières (parfois illusoires comme ces « fourme/fourmage/fromage » ou « araïre/araire » répandus dans toute la France).
Cette étude de la migration est éclairée par des cartes des contrées de départ et d'accueil, des tableaux généalogiques montrant les alliances entre Foréziens et Percheronnes et les générations issues de ces mariages mixtes, des tableaux de la descendance dans le Perche - entre autres celle des Garbit ou Garbil/Galby/ Garby -, des tableaux relatifs à l'âge des épouseurs ici ou là, etc. La démographie, si elle n'est pas au centre du propos, apporte quelque éclairage.
Après 1815, la migration cesse. Dans le Perche, le souvenir des migrations se brouille et le terme même de « Lyonnais » ajoute à la confusion. Pourtant, certains descendants continuent le métier jusqu'à la première guerre mondiale, les autres passant à l'agriculture pour quelques générations. Mais, dès la seconde moitié du XIXe siècle, les machines à vapeur pénètrent en forêt, le sciage mécanique sur place devient possible. Bientôt, les camions transporteront directement les grumes dans les scieries. Curieusement, pendant la seconde guerre mondiale, le travail forestier connaîtra un léger regain d'activité : une vingtaine de réfugiés espagnols de la guerre civile travaillent dans la forêt du Perche tant pour y vivre que pour s'y cacher de l'occupant. Un index, un lexique et des annexes viennent clore le propos de ce livre utile et agréable. Rose Duroux
Article sur Cairn.info 2005
226 Le point de départ de cet ouvrage est une généalogie familiale, ce qui explique l’angle choisi pour ce travail. L’auteur s’est fixé trois objectifs : rapprocher les scientifiques et les généalogistes ; mettre à la disposition des autres chercheurs des données dépouillées ; démontrer que l’image d’un monde immobile est fausse. Sa méthode consiste à identifier et localiser tous les migrants, observer et délimiter le cycle saisonnier des migrations, expliquer enfin comment se fait l’intégration.
227 Qui sont les scieurs de long lionnais et pourquoi partent-ils ? Pour l’essentiel, ils viennent des zones de montagne et c’est pour assurer leur propre subsistance, et celle de leur famille, que ces hommes ont quitté le Haut-Forez. Certes, ces migrations temporaires ont permis de compléter les ressources des montagnards mais on peut émettre quelques doutes sur un rôle déterminant de la pente dans ces migrations. Comme autre raison de départ, Jacques Garbit évoque le remboursement en traites des emprunts, entraînant, quand les hommes n’arrivent plus à y faire face, leur migration. La crise foncière est également un mal chronique et, face à l’expansion démographique à partir de 1740-1750, nous assistons à une généralisation des migrations et à un accroissement de leur durée. On relève des absences prolongées de 2 voire 3 ans. D’autres causes sont encore évoqués : échapper aux contraintes familiales et locales, éviter l’enrôlement dans la milice royale, le désir d’aventure. Enfin, nous pouvons citer quelques cas isolés : l’orphelin qui n’a rien à perdre ou bien le repris de justice. L’auteur nous fournit de nombreux exemples, mais seules des statistiques pourraient permettre d’étayer toutes ces hypothèses.
228 Mais pourquoi aller dans le Perche ? Pour obtenir de meilleures rémunérations, pour constituer un pécule et le transmettre. Les testaments permettent de voir cette transmission du patrimoine. Une fois prise la décision de partir, il faut prendre la route. Sur celle-ci, il semble bien que les scieurs de long soient assimilés à la gent errante par leur aspect et leurs vêtements. L’auteur nous explique que les scieurs de long se rendent dans le Perche soit par les routes, soit par les voies d’eau. Il note que le déplacement pédestre est le plus fréquent et que la durée de ces voyages est parfois très longue. Des étapes sont obligatoires (fermes, auberges, hospices). Or, il faut réussir à se faire accepter par les hôtes. Ainsi, il est nécessaire d’avoir à la tête du groupe un maître scieur qui est, le plus souvent, un laboureur, c’est-à-dire de rang équivalent à son hôte. Plus on s’éloigne et plus il est difficile de se faire reconnaître et plus l’étape coûte cher. Au retour, l’étape est plus facile car les scieurs de long ont de l’argent.
229 Il est justement intéressant de se demander maintenant quel avantage financier procure une telle migration. Le salaire des scieurs semble davantage dépendre du rendement que de la qualification. L’auteur estime que le gain brut d’une campagne de 200 jours, vers 1780, est de l’ordre de 200 livres. Il déduit 90 à 100 livres pour la nourriture et l’entretien, en considérant les prix couramment pratiqués en Île-de-France dont le niveau semble assez voisin de ceux du Perche. Les scieurs de long peuvent donc repartir avec un pécule d’environ 100 livres. Cette somme sert à acquérir de nouvelles terres et à transmettre un patrimoine aux descendants.
230 Mais si le pécule ainsi constitué est important, c’est au prix d’un dur labeur. Les scieurs de long ne travaillent pas uniquement en forêt, ils peuvent aussi exercer leur profession en ville ou dans un bourg. Sur leur lieu de travail, ils s’installent dans des loges. Le maître scieur est la clé de voûte de l’équipe car c’est lui qui cherche le travail et qui signe les contrats (ces derniers n’ont pas été retrouvés). Il est aussi bien migrant qu’autochtone. L’auteur nous fournit toute une description du travail des scieurs de long et les principaux éléments que nous pouvons en retenir sont : la cadence du travail qui dépend beaucoup du temps, la mauvaise hygiène et les nombreux accidents. Plus la fin de la campagne approche, plus l’excitation gagne l’équipe, mais certains ne survivent pas à l’épuisement. Fin mai, début juin, le travail touche à son terme. Le maître scieur perçoit l’argent des marchés, donne à chacun des acomptes, se rembourse des sommes qu’il a avancées et procède au règlement définitif en fin de campagne. Les comptes étant réglés, le chantier débarrassé et le matériel entreposé, on prend le chemin du retour. Garnis d’écus, les scieurs de long suscitent bien des convoitises.
231 Pendant la campagne, le village d’origine des migrants doit continuer à vivre et nous avons une présentation rapide de cette vie notamment celle des femmes. Outre les tâches domestiques habituelles, les femmes ou les jeunes filles se consacrent à des travaux d’appoint leur permettant d’arrondir leurs maigres ressources. Elles sont dentellières, filles de carreau, parfois marchandes de dentelles ou encore nourrices. Femmes, filles ou veuves, hommes trop jeunes, éclopés ou trop vieux pour partir à la scie, subsistent ainsi tant bien que mal d’octobre à juin. L’étude nous montre, grâce aux états « des propriétaires et habitans », que le groupe des imposés à plus de 30 livres dans ces villages, en 1788, rassemble bien des noms connus parmi les migrants scieurs de long dont les pécules se sont accumulés au cours des ans puis transformés en biens fonciers. Dans ce cas, les personnes qui restent au village sont donc chargées de faire fructifier ces terres.
232 Si nous avons vu comment se déroulent les migrations temporaires, il convient maintenant de revenir sur les migrations définitives qui sont l’objet une grande partie de l’ouvrage. Ceci permet de comprendre comment on passe d’une intégration à une assimilation des scieurs de long. Les cadets sont ceux qui sont les plus sensibles à l’émigration définitive. Les scieurs de long apparaissent dans les rapports avec la population et l’auteur note que ceux-ci sont différents selon le type de migration. Plus l’implantation est longue et plus les liens se tissent. Nous pouvons nous demander pourquoi certains Lionnais restent définitivement dans le Perche. En effet, l’énumération des malheurs qui frappent le Perche et les contrées voisines au cours des xviie et xviiie siècles poussent à se demander ce qui, hormis le pécule de fin de campagne, a bien pu inciter les Foréziens à y rester. Certes les cadets n’avaient rien à perdre et le climat était moins rude, la morte-saison plus courte, on pouvait s’y employer à longueur d’année. Que l’on soit né en Haut-Forez ou dans le Perche, l’espérance de vie entre 1680 et 1750 ne dépasse guère une trentaine d’années à la naissance. Les taux de mortalité se situent dans les mêmes ordres de grandeur. Ce n’est donc pas la terre promise, mais ce qui semble attirer les migrants, c’est que le travail soit assuré. L’intégration de ces hommes pose des problèmes de communication. Elle n’était cependant pas impossible car le bilinguisme ne date pas d’aujourd’hui. D’autre part, les croyances et les superstitions de ces deux populations présentent de nombreuses analogies qui ont peut-être donné à ces hommes le sentiment d’appartenir à une même culture. Pour s’intégrer, le Forézien doit d’abord donner des preuves de sa capacité à se stabiliser avant de jouer la carte de mariage, ce qui peut demander beaucoup de temps. Au final, une étroite solidarité se manifeste non seulement parmi les migrants mais aussi entre ces derniers et les Percherons de la forêt : bûcherons, charbonniers, sabotiers, tuiliers, etc. Entre gens de même condition, point de frontières. Ce temps d’acclimatation engendre un retard moyen des migrants au mariage de 5 ans, par rapport aux sédentaires de même origine géographique. S’il existe une stratégie matrimoniale des Lionnais, la réciproque joue aussi chez les Percheronnes. Les alliances se nouent le plus souvent avec les mêmes familles. Cette étude permet de constater une forte endogamie sociale et surtout une forte endogamie géographique. L’auteur nous dresse enfin un tableau de la fin des relations entre les deux régions. Avant la Révolution, la source semble déjà se tarir. À partir de 1792, l’auteur ne trouve plus aucune relation. Pendant la période s’étendant du Directoire à la fin de l’Empire, en 1815, un fait important émerge : la disparition, en une dizaine d’années, des derniers Foréziens émigrés au Perche. L’histoire de scieurs de long Haut-Forez dure néanmoins encore plus d’un siècle car, ça et là, des dynasties perpétuent ce métier jusqu’à extinction. Ceux qui se détournent des métiers du bois se retrouvent en majorité dans l’agriculture, gendres de petits exploitants puis exploitants eux-mêmes, sinon ouvriers agricoles : charretier ou garçon de labour ou simple journalier. Plus les années passent et plus il est difficile de différencier les descendants des Lionnais des autochtones.
233 Pour terminer, l’auteur nous révèle qu’en 1985, vivait encore à la Croix-du-Perche, un ancien scieur de long, né avec le siècle. Avec lui s’éteignit dans cette contrée, comme dans bien d’autres, un métier qui avait longtemps témoigné de la vitalité et du courage des humbles face à l’adversité. Tout au long de ce livre, il y a de nombreux exemples qui permettent d’étayer les idées avancées cependant nous pouvons regretter le manque de statistiques pour confirmer celles-ci. Néanmoins, les nombreuses annexes de ce livre permettront à d’autres chercheurs de faire ce travail.