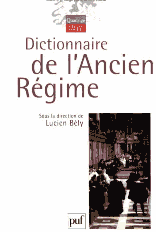Moissons
dans le Dictionnaire de l'Ancien Régime
"La moisson, lit-on dans La Nouvelle Maison rustique, est la couronne
de l'agriculture, la récompense des dépenses et des sueurs
du laboureur, l'espérance de sa famille, la sûreté du
maître, la vie et la richesse de tout l'Etat." Mais nulle tâche
que les "métives" ne créait davantage de tension
dans la France d'Ancien Régime. Les convoitises des voisins ou des
pauvres qui bénéficiaient des droits de "glanage"
(ramasser les épis tombés à terre) et de "chaumage"
(couper les chaumes résiduels laissés dans les éteules),
en vertu de la législation royale (ordonnance de saint Louis de 1261
et de Henri II de novembre 1554) qui s'inspirait du Lévitique, l'appétit
des animaux impatients de profiter de la vaine pâture dans les chaumes,
les intérêts contradictoires entre les exploitants individuels
et la communauté rurale, l'opposition entre les deux types de main-d'œuvre,
locale et foraine, multipliaient les incidents. Aussi les moissons faisaient-elles
l'objet d'une organisation collective, souvent dans le cadre seigneurial.
A la différence des vendanges, l'ouverture de la récolte était
rarement soumise à un ban de moisson mais un minimum d'entente s'imposait
entre exploitants voisins pour réduire les dommages. Chaque village
engageait un ou plusieurs gardes-messiers pour faire respecter l'ordre public,
institution qui, après une période de déclin au XVII°
siècle (sauf en année de disette), se renforce au XVIII°
siècle (avec l'appui de gardes suisses dans les plaines à
blé autour de Paris).
Avec un décalage moyen de une à deux semaines selon les régions
et les années, les premiers travaux commençaient à
la fin juin, avec la fenaison, une affaire d'hommes surtout car éprouvante
(les femmes se contentaient de faner). Une fois les herbages fauchés,
l'ordre des récoltes voulait que les moissonneurs ("estivandiers
", "métiviers", "aoûteux", etc.) commencent
par les céréales d'hiver et terminent par celles de printemps
(les " mars "). Les aléas météorologiques
incitaient à ne pas trop étaler les opérations mais
la relative faiblesse des rendements et le respect des droits communautaires
imposèrent longtemps une coupe lente pour les gros grains. Depuis
le Moyen Age les blés étaient moissonnés à la
"scie " (faucille armée de petites dents) pour éviter
l'égrenage et laisser sur le champ une hauteur suffisante de chaume
pour les pauvres du village: or un "soyeur" (ou "scieur")
ne récoltait pas plus de quinze ares par jour. Pour les menus grains,
en particulier l'avoine, qui avait subi un roulage au printemps, la faux
permettait de moissonner trois fois plus vite. L'escourgeon était
"scié" courant juin, le seigle trois semaines après;
venaient ensuite le méteil, l'épeautre et le froment ; orges
et avoines pouvaient alors être fauchés. A la coupe proprement
dite, activité mixte qui demandait surtout de l'attention, s'ajoutaient
des opérations complémentaires et souvent délicates
: à mesure que l'on sciait les blés, on les faisait javeler,
c'est-à-dire qu'on laissait les brassées d'épis moissonnés
(les javelles) mûrir et sécher sur les éteules (javellage
plus long pour l'avoine qui grossissait grâce à la rosée)
; puis les ramasseuses prenaient cinq à huit javelles pour former
les gerbes liées avec du feurre ou du glui de seigle, parfois de
la tille (écorce de jeune tilleul). Une fois javelées sur
le champ, les avoines étaient écochetées: les moissonneurs
la ramassaient par tas avec des fauchets pour en faire les gerbes. Arrivaient
alors les calverniers qui rassemblaient toutes les gerbes par dix pour former
les " dizeaux " qui restaient dans les champs jusqu'au passage
du collecteur de la dîme - le "dîmeur" ou "dîmeron".
La vulnérabilité des récoltes aux aléas atmosphériques
et la succession de ces opérations conduisaient à mobiliser
le plus de bras possible et à faire quelques entorses au calendrier
religieux. Les dimanches, une messe matinale évitait d'interrompre
les travaux. En cas de nécessité, les moissons n'avaient pas
de fêtes, comme les vendanges. Mais la besogne achevée, alors
les "gaillards aoûterons" pouvaient danser au bout du champ
en priant Dieu qu'il leur rende l'an prochain d'aussi belles récoltes.
Pour mener à bien les récoltes, appel était fait à
une main-d'œuvre complémentaire à celle des habitants
du village. De fait, les moissons suscitaient une émigration saisonnière
de premier ordre : Dauphinois et Piémontois, les "gavots",
profitaient du décalage des saisons pour descendre en Provence faire
les blés ; les montagnards du Rouergue, du Gévaudan et du
Vivarais s'engageaient dans la plaine du bas Languedoc ; Normands, Picards,
Champenois, Bourguignons affluaient en Ile-de-France par bandes entières.
Cette mobilité géographique fut porteuse de changements techniques.
Soucieux d'expédier leur travail pour se louer dans plusieurs domaines
successifs au fur et à mesure de la maturité des grains, les
"horsains" apportaient des procédés de récolte
plus expéditifs mais aussi plus de dextérité. II en
résulta une concurrence accrue entre moissonneurs forains, véritables
travailleurs d'élite, préférés par les exploitants
qui élevèrent leurs salaires en argent tout en gagnant sur
la rapidité du travail et sur les pailles, et moissonneurs locaux
attachés aux techniques et aux usages traditionnels. Tout cela aggravait
le conflit avec la communauté rurale qui défendait âprement
ses droits traditionnels.
Article de Jean Marc Moriceau
Quelques définitions tirées du Larousse du XX° siècle en six volumes
Calvanier: En certaines régions, ouvrier engagé
spécialement pour la moisson, on dit aussi calvénier.
Ecocheler: Ramasser les tiges de céréales au moyen d'un râteau.
Escourgeon: variété d'orge hâtive qu'on sème
en automne.
Eteule: chaume qui reste sur place après la moisson.
Fauchet: Râteau à dents de bois, qui sert à ramasser
les foins ou à séparer la paille du blé battu...
Feurre ( Foerre, Foarre, Fouarre) paille de toute sorte de blé (Auguste
Diot: en patois briard: du faure, au XVI° siècle: du feurre)
Glui: paille de seigle dont on fait des liens pour attacher les gerbes,
accoler la vigne ou couvrir le toit des chaumières / Paille longue
avec laquelle on emballe le poisson.
Horsain (Horzain, Horsin): Se dit en Normandie des gens étrangers
au pays.
Messier: Homme préposé à la garde des récoltes,
des fruits, lors de leur maturité.
Méteil: Mélange de seigle et de froment.
![]() Début
du chapitre: les moissonneurs migrants
Début
du chapitre: les moissonneurs migrants