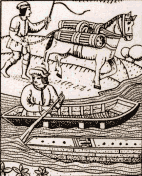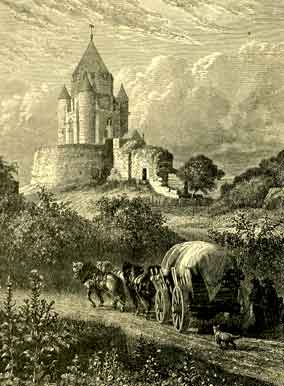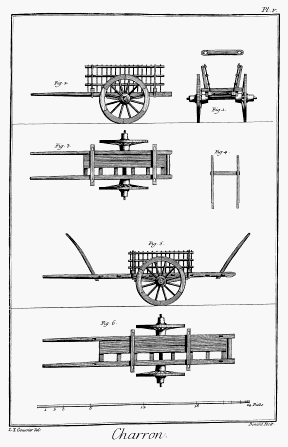Voituriers par terre
voie, voiture, voiturer, voiturier / 2
VOITURE. Transport de personnes
ou de choses pesantes qui se fait par le moyen de chevaux, charrettes,
bateaux, etc. Les rouliers, les patrons d'un vaisseau doivent avoir
leurs lettres de voiture, qui contiennent l'état des choses voiturées.
Se dit, aussi de la manière de porter les choses. La voiture
par litière est la plus commode, celle par eau est de moindre
coût, et c'est la plus douce. La plus rude voiture est celle des
chevaux de messagers, de chasse-marée. Les voitures se font par
des bœufs ou des chameaux, celles des montagnes par des mulets.
On dit proverbialement : adieu la voiture, quand on se moque d'une chose
qui tombe, qui se renverse.
Dictionnaire de Furetière, XVII°s
ROULIER, voiturier par terre, qui
transporte les marchandises d'un lieu à un autre sur des chariots,
charettes, fourgons & autres pareilles voitures roulantes.
Les rouliers, à moins que ceux pour qui ils ont chargé,
ou quelqu'un de leur part ne les accompagne, doivent avoir la lettre
de voiture des marchandises qu'ils transportent ; les congés,
si ce sont des vins, eaux-de-vie & autres liqueurs ; les acquits
des bureaux où ils passent ; des passeports s'il en est besoin,
& s'ils passent par pays ennemis.
Encyclopédie Diderot d'Alembert XVIII°s |
Au voiturier par terre s'opposait le voiturier
par eau, utilisant tout ce qui flotte, aussi bien les bateaux comme les coches
d'eau, les margotats, les flûtes de Bourgogne, les bateaux marnois,
embarcations locales, que des radeaux comme les trains de bois qui descendaient
du Morvan. A l'évidence, rien de tel à la Chapelle Rablais où
l'on serait bien en peine de faire flotter la moindre barque sur le filet
d'eau du ru Guérin. Le sous- sol d'argile à meulières
et la faible pente favorisent plutôt la formation de mares; on en relève
près de deux cents sur les plans cadastraux du début XIX°
s.
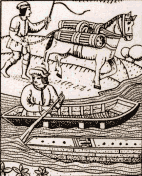
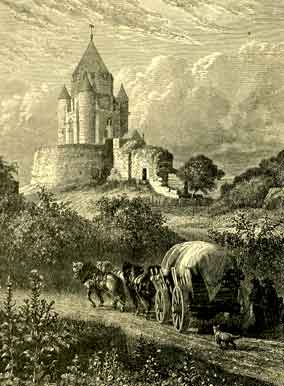
Environ deux cent trente kilomètres
séparent la Chapelle Rablais du bourg de Momignies dans les Ardennes
belges, cinq à six journées au rythme des charrois de l'époque.
Si on considère que les voituriers étaient les camionneurs de
l'époque on peut s'étonner qu'un tel nombre ait choisi de s'implanter
dans un lieu totalement dépourvu de la moindre route! Car c'était
la triste situation de plus d'un village avant les années 1830 et du
nôtre en particulier.
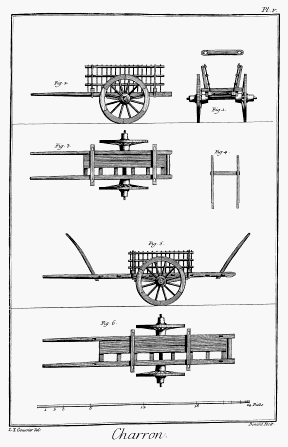
Les mots ont bien changé
de sens, par exemple, à l'origine, diligence est défini, dans
le dictionnaire de Furetière par: Activité
qui nous fait porter avec promptitude à exécuter notre devoir
ou nos desseins. La diligence est la qualité la plus requise pour les
domestiques. Camion:
Epingle déliée pour attacher des toiles fines ou autre choses
délicates. Se dit aussi des griffes des chats à cause qu'elles
sont petites et pointues. Se dit aussi d'une espèce de petite charrette,
ou haquet, qui est traînée par deux hommes et qui sert à
transporter des balles de marchandises par la ville.
Voiture se rapportait à tous les modes
de déplacement, au point que les deux canards de la fable de la Fontaine
proposaient à la tortue: Nous vous voiturerons
par l'air en Amérique et Bernardin de
St Pierre note, dans Paul et Virginie: les nuages
que le vent alizé voiture dans le ciel...
Dans les dictionnaires, voiture, voiturer,
voiturier s'appliquent, entre autres, au transport des marchandises, un voiturier
correspondrait au camionneur ou au livreur de notre époque. Dans le
langage courant, la distinction entre voiturier, roulier et charretier n'est
pas aussi nette, comme peuvent le révéler les textes de l'époque:
Dans cette vaste charrette, peinte en
bleu, se trouvait un gros garçon joufflu bruni par le soleil, et qui
sifflait en tenant son fouet comme un fusil au port d' armes. "Non, ce
n'est que le charretier, dit Benassis. Admirez un peu comme le bien- être
industriel du maître se reflète sur tout, même sur l' équipage
de ce voiturier!
Balzac, le médecin de campagne
Cette hauteur, il la connaissait bien ; mais
il cherchait si quelque charrette oubliée par un voiturier le long
de ce mur ne lui donnerait pas un moyen de gagner le faîte. Une fois
arrivé au faîte, leste et vigoureux comme il l'était,
il eût facilement sauté à l'intérieur. Il n'y avait
point de charrette contre la muraille.
Alexandre Dumas, la comtesse de Charny
Hier, sur le coup de midi, je revenais du village, et, pour éviter
le soleil, je longeais les murs de la ferme, dans l'ombre des micocouliers...
Sur la route, devant le mas, des valets silencieux achevaient de charger une
charrette de foin... La charrette s'ébranla pour partir. Moi, qui voulais
en savoir plus long, je demandai au voiturier de monter à côté
de lui, et c'est là-haut, dans le foin, que j'appris toute cette navrante
histoire...
Alphonse Daudet Lettres de mon moulin, l'Arlésienne

" Ce qui frappe, c'est la lenteur.
Jusque vers 1760, les déplacements, dépassant rarement la moyenne
horaire d'une lieue, quatre ou cinq kilomètres. Les plus rapides, par
les chevaux "courant la poste", le galop réservé théoriquement
aux services royaux, peuvent atteindre la vertigineuse allure de vingt kilomètres
à l'heure; encore faut- il trouver des chevaux frais à chaque
étape...
Après 1775, sur les grandes
routes, les "messageries royales" créées par Turgot
utilisent les diligences. Elles sont équipées de ressorts et
avancent au galop grâce à un système de relais installés
de loin en loin par l'entreprise de messageries qui exploite la ligne. Pour
leur première étape, elles partent en pleine nuit, à
2 ou 3 h du matin, et arrivent assez tard à l'auberge du soir. Les
nouvelles voitures font deux à trois fois plus de chemin en 24 heures
que les carrosses. La diligence de Lyon franchit ainsi environ 470 km en 5
jours seulement, soit à la vitesse moyenne de 94 km par jour; celle
de Valenciennes atteint 101 km par jour, et celle de Lille, la plus rapide,
ne met que 2 jours pour couvrir 234 km. Mais ce sont encore des exceptions.
"
Extrait d'un manuel scolaire Cycle Moyen Histoire
géo Istra vol 2 1982
Les routes étaient coupées de péages
et d'octrois comme celui de la Porte St Jean de Provins
Les
véhicules utilisés sont très lents: coches ou carrosses
dont des voitures mal suspendues marchent au trot et le plus souvent au pas
de chevaux qu'on ne peut relayer pendant toute la durée du voyage. On
s'arrête toujours avant la tombée de la nuit et, en comptant une
halte prolongée à mi-étape pour la dînée,
on avance ainsi péniblement de 40 à 50 km par jour...
Les marchandises vont encore plus lentement: le vin d'Orléans met quatre
jours pour «monter» à Paris; les toiles de Laval cahotent
deux semaines avant de toucher Rouen et celles de Rouen, un mois pour atteindre
Lyon.