
Etienne Fare Charles Huvier/23
curé de la Chapelle Rablais 1752/1759
Acheter son presbytère /2
illustrations pour leur légende.
Ctrl + pour agrandir la page

Etienne Fare Charles Huvier ne laissa pas de commentaires à propos de Charles Bureau, son prédécesseur, du moins, pas dans le registre paroissial qu'il émailla de ses nombreuses "nottes", mais susceptible d'être lu par un autre curé, son possible successeur (et par nul autre). Certains indices laissent à penser que les relations entre les deux prêtres ne furent pas très cordiales...
Que s'était-il passé, pendant les premiers
mois de cohabitation, entre la prise de fonction d'Etienne Huvier, fin
mai 1752 et l'achat du presbytère, en octobre?
Dans les dernières pages de l'acte de vente, le notaire avait
noté la longue liste de ce que Charles Bureau laissait à
son successeur :

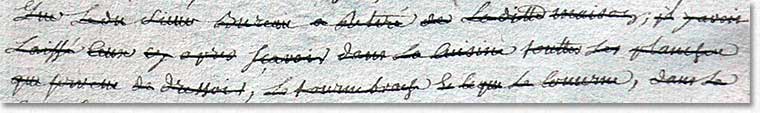
Tout ceci fut proprement raturé. Charles Bureau ne laissait absolument rien à son successeur; plus de buffet, d'armoire, de tournebroche, plus la moindre petite planche... a-t'il seulement laissé la porte verte? Est-ce ainsi que l'on traite quelqu'un qu'on apprécie, ou cette mesquinerie est-elle révélatrice des tensions entre les deux prêtres?
Notons qu'Etienne Huvier prit sa revanche,
quelques années plus tard, en 1755, quand, au sujet du presbytère,
il se fit écho d'une rumeur concernant son prédécesseur,
ce qui l'obligea à verser 72 livres, sous peine d'un procès
: "... Le sieur Bureau ancien curé
dudit lieu présent à laditte assemblée comme propriétaire
de biens dans laditte parroisse a observé qu'il a appris que plusieurs
desdits habitans prétendant qu'il s'estoit autrefois servy des
pierres et de vieux bois conssumés provenans de laditte mazure...
cependant ledit sieur Bureau a offert de donner à laditte église
une somme de soixante douze livres pour engager lesdits sieurs propriétaires
et habitans à se désister de laditte prétention quoiqu'elle
ne soit aucunement fondée... Si les propriétaires et habitans
eussent parlé, il y eut eu dans l'assemblée une difficulté
qui auroit donné nature à un procés de la part desdits
propriétaires e ... tre Mr Bureau mais dans le fond ... "
Acte d'assemblée du 30 novembre 1755 minutes
du notaire Vaudremer AD 77 188 E 63 (lacunes dans le texte)

Charles Bureau, quittant la Chapelle Rablais, s'installa à Nangis, la petite ville proche, mais continua à fréquenter son ancienne paroisse: le 16 novembre 1752, il était procureur général & spécial du propriétaire, bourgeois de Paris, pour le bail de la ferme des Montils; le 9 mai 1753, il fut parrain du fils du châtelain des Moyeux, baptisé par le curé Huvier; en 1753, 1754 et 1755, il loua à bail des terres sur la Chapelle Rablais; en 1754, il était présent lors de l'assemblée des habitants "tant pour luy que pour le sieur Le Semetier" etc... L'ancien curé, pas vraiment impotent, était encore fort présent dans son ancienne paroisse et peut-être encore influent.
Charles Bureau fut témoin des premières actions du curé Huvier dans sa paroisse, qui ne tardèrent pas. Le jeune curé donna quelques coups de pied dans la fourmilière, comme on le verra mieux à la page suivante. D'après les "nottes" émaillant le registre de 1752, l'angélus n'était plus sonné, l'office ne se déroulait plus comme il aurait dû, la sage femme n'avait pas été nommée suivant les règles, le maître d'école ayant officié sous Charles Bureau n'était pas digne de ses fonctions, les dettes n'étaient pas couvertes (plus tard, on découvrira que le curé Bureau, intime du châtelain puisqu'il fut le parrain de l'un de ses fils, n'avait pas exigé l'ensemble des dîmes qu'il devait) ... autant de petits faits notés par Etienne Huvier qui devaient refléter ses opinions mais qui ne devaient pas être du goût de Charles Bureau, pour peu que le nouveau curé ait exprimé publiquement ces remarques.
En quelques mois, les relations entre les deux curés avaient dû s'envenimer, et Charles Bureau n'avait plus été enclin à faire le moindre cadeau à son successeur. D'où ces longues ratures sur l'acte de vente.

Connaissant le caractère bien trempé
d'Etienne Fare Charles Huvier, il est fort étonnant qu'il ait
accepté de se laisser plumer par l'ancien curé, depuis
plus de cinquante ans, les curés achètent leur presbytère...
et par les paroissiens, dont la Fabrique dépensait en impôts,
cierges et entretien presque l'intégralité des recettes
et n'avait pas proposé de dédommagement pour l'absence
de presbytère.
En 1752, Etienne Huvier acheta le presbytère de son prédécesseur
et ne réclama pas le montant d'un loyer !
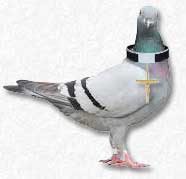
Feuille volante annexée aux minutes du notaire Vaudremer 188 E 63

A
la fin de sa supplique, Etienne Huvier essaya de jouer de ses relations,
en l'occurence la position de son frère Jean, bailli et maire de
la ville de Coulommiers :
"Le suppliant frère de celuy qui a l'honneur d'être
vôtre subdelegué à Coulomiers ne cessera d'adresser
à Dieu ses voeux et ses prières pour la conservation de
la santé de vôtre Grandeur. Huvier Curé de la Chapelle
Arablay"
Ci-contre: portrait de Jean Huvier
conservé aux Archives départementales de Seine et Marne,
de même que son costume: veste et culotte bordeaux foncé,
gilet blanc brodé, 2 noeuds noirs
AD 77 195 J 3-17 & 195J11-1
Le moment était fort mal choisi pour
remettre à l'ordre du jour le dossier du presbytère. Etienne
Huvier n'en fut certainement pas à l'initiative, se contentant
de répondre à une enquête de Berthier de Sauvigny,
intendant de la généralité de Paris sur l'éventualité
de réparations au presbytère. Mais la réponse de
l'intendant l'incita (ou l'obligea) à poursuivre: "Vu
la présente requete nous ordonnons qu'icelle sera communiquée
aux principaux propriétaire et habitans de ladite paroisse générallement
assemblés à la diligence du sindic au son de la cloche
a la maniere accoutumëe pour par eux déliberer sur le contenu
d'hycelle pour leur délibération à nous rapportëe
avec l'avis du Sr Desverneys notre subdélégué à
Montereau être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait à
Paris le vingt quatre janvier mil sept cent cinquante cinq."
Cette date coïncidait avec le début
de coûteux travaux à l'église "le
24° dudit mois de janvier audit an j'ai passé avec eux un
marché sous seing privé des réparations dudit choeur
moyen..." qui avaient donné
lieu à de nombreuses assemblées de paroissiens et des
propriétaires, depuis plus d'un an.
Les paroissiens, manouvriers et laboureurs, avaient déjà
été sollicités à plusieurs reprises pour
assurer le traitement d'un nouveau maître d'école, puis
pour ces travaux à l'église. N'oublions pas que le curé
exigeait déjà d'eux environ un dixième de leur
revenu par la dîme, et qu'il faisait payer le casuel, les cérémonies
religieuses, autres que baptême.
Les habitants de la Chapelle Arrablay tiraient déjà le
diable par la queue, il aurait été malvenu de les solliciter
à nouveau. Etienne Fare Charles Huvier renonça à
ses prétentions sur un presbytère, contre l'octroi d'un
petit terrain (et la pique en direction du curé Bureau mentionnée
plus haut).
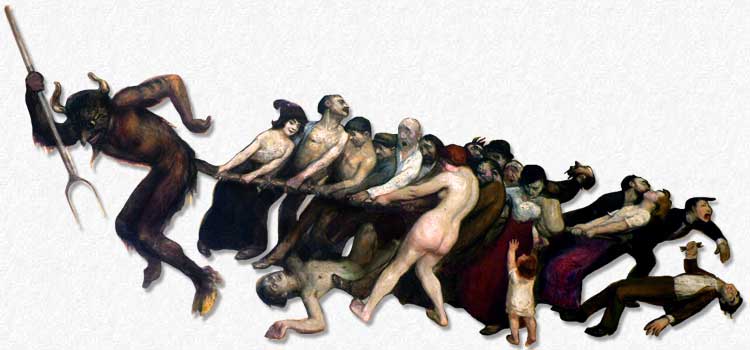
"...Et à l'instant est comparu ledit
sieur Huvier curé lequel ayant égard aux réparations
que lesdits propriétaires et habitans viennent de faire faire
à laditte église dudit lieu de la Chapelle et à
l'indigence desdits habitans, voulant d'ailleurs prouver d'une manière
sensible aux uns et aux autres son affection sincère pour eux,
s'est desisté autant qu'il est en luy estant qu'il sera curé
dudit lieu à touttes prétentions audit presbitère...
... se contentant seulement pour toutte indemnité et reconnoissance
de la part desdits sieurs propriétaires et habitans de la jouissance
d'un terrain consistant en quinze perches appartenant à laditte
église où quelques uns croyent sans fondement solide qu'il
y avoit jadis deux petittes travées de logis couvertes de chaumes..."
30 novembre 1755 minutes du notaire Vaudremer
188 E 63
Dans l'une de ses notes, il ajoute : l'acte "est avantageux pour les propriétaires et habitans et ne lie point mes successeurs. des circonstances n'ont engagé de céder mon droit; mais je ne l'ai fait que par bonté et bienveillance sans néamoins donner la moindre atteinte au droit certain et incontestable de mes successeurs."
Après onze mois de démarches,
"après avoir vu plusieurs
fois Mr le Comte de Guerchy Seigneur de nangis et de cette paroisse.."
avoir convoqué plusieurs assemblées "j'ai
fait convoquer par le Sindic une assemblée trois dimanches de
suitte et ai écri à tous les principaux propriétaires
pour les inviter à s'y trouver",
Etienne Huvier n'aura gagné, comme compensation du manque de
presbytère, que l'octroi d'un terrain de 15 perches carrées,
soit entre environ 600 et 700 mètres carrés (suivant les
mesures au petit ou au grand arpent car les deux valeurs avaient cours
à la Chapelle Rablais.)
Peut être a-t'il aussi gagné une forme de lassitude de
quelques paroissiens, fatigués de tant de sollicitations, et
qui auraient regretté le temps du placide curé Bureau

Les quatre dernières pages ont été
consacrées à l'arrivée du curé Huvier dans
la paroisse de la Chapelle Rablais. Les faits que j'y ai exposés
m'avaient fort étonnés au moment où je les ai découverts.
En débutant les recherches, je n'avais pas imaginé que
des curés avaient pu être obligés "d'acheter"
leur cure ou leur presbytère.
Si la "résignation ad favorem" n'était pas rare
sous l'ancien régime, j'en ai trouvé plusieurs actes,
je ne sais pas si beaucoup de curés avaient été
dans l'obligation d'acquérir leur presbytère, sans contrepartie,
dans d'autres paroisses.
C'est pourquoi je fais appel aux lecteurs de ces pages qui pourraient
m'éclairer de leurs connaissances. Merci d'avance. ![]()
|
|
|