
Les scieurs de long/9
Fatigue, accident,
maladie...


"Les scieurs travaillaient jusqu'au tombant de la nuit, tant qu'ils voyaient la ligne. Ensuite, ils allaient débiter les billes : "Quand il y avait clair de lune ça allait, sinon il fallait tâtouiller. Alors, tu prenais ton bout de bois, tu cherchais l'encoche. Quand tu avais trouvé l'encoche: "Allez, amène le passe-partout", au collègue. On mettait le passe-partout dedans et on sciait. Des fois, c'était pas scié d'aplomb, mais enfin ! " Marc Prival Les migrants de travail d'Auvergne et du Limousin au XX° siècle
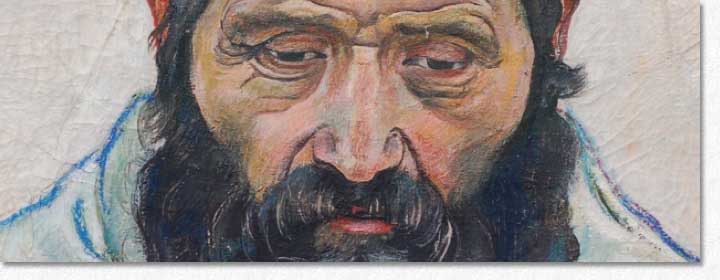
"L'effort pour scier est composé du poids de la scie, plus de l'effort des hommes du bas; si l'homme du haut emploie un effort constant de 15 kil. pour soulever la scie, on peut ajouter pour son poids cette force à celle que les hommes employent; c'est donc un effort de 39 kilogrammes, qui élèverait un poids égal à 50 fois 8 décimètres ou 2.400 mètres de haut par minute, conséquemment à 5000 fois 8 décimètres ou 2400 mètres de haut en une heure. Comme les scieurs de long travaillent douze heures par jour avec la méme force et la même vitesse, leur action journalière élèverait un poids de 59 kilogrammes à 28.800 mètres de haut, ou un poids de 1.128 kilog. à un kilom. de hauteur, et l'action journalière de chaque ouvrier serait de 376 kilogrammes à un kilomètre de hauteur .." Traité de l'art du charpentier Jean H Hassenfratz 1804
"La première
semaine, on ne pouvait plus bouger, ça nous bloquait les membres; on
était courbatu partout. Celui du dessous avait mal aux jambes car il
est toujours sur une jambe (celle qui est avancée). Celui du dessous
avait les yeux qui lui brûlaient, il y a des sciures qui brûlent
plus que d'autres, par exemple le châtaignier. Le peuplier, ça
ne fait rien. Ils disaient, dans le temps, qu'il fallait avoir tué
son père et sa mère pour faire ce métier."
Marc Prival Les migrants de travail d'Auvergne et
du Limousin au XX° siècle

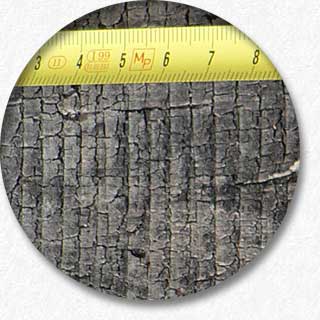
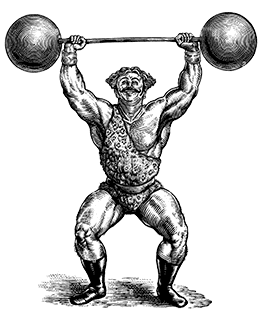
"Le scieur de long travaille par tous
les temps, par la pluie qui transperce ses vêtements comme par la neige,
se consolant à l'idée qu'aucun scieur ne va en enfer, puisqu'il
l'a connu sur terre".
Certains n'ont pour abri qu'une loge qui protège
si peu des intempéries: "Mais la vie est si dure! Même
si, la nuit, le poêle ronfle autant que les hommes, il n'empêche
pas toujours, les jours de grand froid, le quignon de pain de seigle de geler
sur la table." Citations
: Beaucarnot
Même si les anciens craignaient moins
le froid que de nos jours, comme le remarquait déjà Louis Sébastien
Mercier à la fin XVIII° siècle:
"Plus économes ou plus aguerris
contre la froidure, nos pères ne se chauffaient presque point. Trois
feux, en comptant celui de la cuisine, suffisaient dans une maison qui renfermait
dix-huit ou vingt maîtres et quels maîtres! Ceux qui occupaient
les premières places de l'État. Les jambes enfermées
dans une peau d'ours, ils bravaient également et le froid le plus piquant"
Louis Sébastien Mercier, Tableau de
Paris fin XVIII°s
Comparaison en pourcentages entre l'âge au décès des habitants de la Chapelle Rablais en bleu et des scieurs de long (ne figurent ni les décès de deux scieurs de moins de vingt ans, ni l'effarante proportion des morts en bas âge au village. Les scieurs les plus âgés n'étaient plus saisonniers, mais fixés en Brie.)
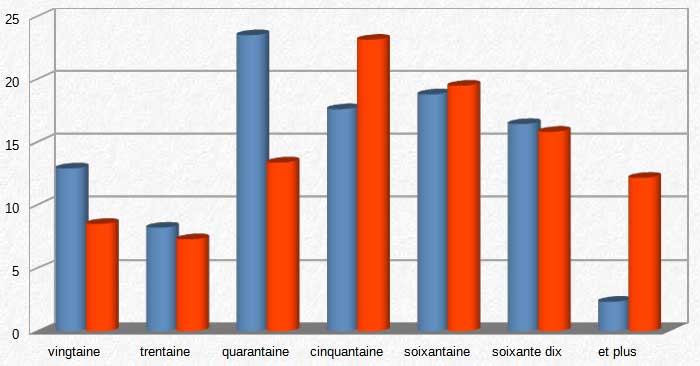
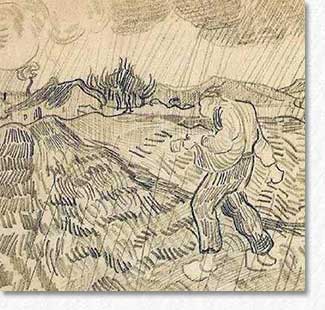
En 1804, Jean Hassenfrast se livra à de
longs calculs sur l'effort déployé par les scieurs de long
qu'il comparera ensuite au débit des scieries :
" Trois scieurs de long font ordinairement en une heure, sur du chêne
encore verd, un trait de scie de 56 décimètres (139 pouces)
de long, sur 3 décimètres (11 pouces 0) de large, Ils donnent
50 coups de scie par minute, c'est 3.000 par heure; la scie est élevée
et abaissée dans chaque coup de 8 décimètres environ
(les conversions en unités anciennes ont ensuite été
supprimées). L'effort moyen de chaque homme est de 15 kilogrammes
environ. Celui qui est placé en haut est occupé à relever
la scie, ceux du bas à la tirer, l'homme du haut pèse un peu
sur la scie en descendant, les hommes du bas soulèvent un peu en
levant ; mais cette pression de l'homme du haut, cette élévation
des hommes du bas sont faibles, surtout lorsque le mouvement de la scie
est de 50 traits par minute. On peut donc considérer l'effort constant
pour soulever la scie comme étant de 13 kilogrammes, et celui pour
l'abaisser et refendre le bois comme étant de 26 kil."
On peut concevoir qu'à ce rythme, les scieurs
aient pu ressentir quelque fatigue, bien que Claude Chabrol dans "Contes
d'outre-temps", en 1969 ait noté:
" Devine ce qu'ils faisaient le dimanche, me lance Pierrot, rigolard
: des concours de scieurs de long! Il en venait de toute la province. On
leur choisissait des troncs énormes, du bois bien dur, et ils crachaient
dans leurs mains !... Imagines-tu un concours de ... Je ne sais pas, de
mécanos qui passeraient leur dimanche après-midi pour gagner
le championnat des rodages de soupapes?"
Les scieurs sciant encore le dimanche ne devaient
pas être des plus nombreux: "On
travaillait tous les jours de la semaine. Notre seul moment de repos était
le dimanche après-midi. Nous allions dans un petit patelin acheter
des provisions, et nous attabler au café."
Témoignage de M. Jean-Marie Tournebize
de Valcivières (Puy-de-Dôme) dans La grande histoire des scieurs
de long
"Le repos est rare : la pause pour les repas, aussi
maigres que ceux de leurs voisins, sauf les jours de Noël et du Mardi
gras, généralement fêtés à grand renfort
de bouteilles de vin, et, bien sûr, le dimanche... "
Jean Louis Beaucarnot Quand nos ancêtres partaient
pour l'aventure

... il fallait protéger le corps. Le protéger aussi de la pluie et du froid, sachant que rien n'était alors réellement efficace, et que l'on se contentait souvent de multiplier les épaissseurs, pour mieux les diminuer par temps chaud, les tenues d'été étant alors inconnues.
Beaucarnot Entrons chez nos ancêtres
"A tout moment aussi, il risque l'accident, la chute pour le "chevrier", l'écrasement pour le "renardier", pour tous le coup de froid, sans parler des varices, des hernies, des rhumatismes et de la phtisie." Beaucarnot
"Le 5 juin, dans la soirée, un scieur de long originaire de
l'Auvergne... était occupé à arracher des culées
d'arbres; sa cognée glissant sur une racine vint s'abattre sur son
pied droit et le lui fendit en deux."
Feuille de Provins du 18 juin 1881
" Un scieur de long, M. Nominé, était
monté sur une pièce de bois placée sur le hourt ou
chantier; en dérangeant la scie, il tomba et sa gorge vint heurter
la pointe de la hache fixée un peu imprudemment au bas dudit chantier,
le taillant de l'outil lui fit une large et profonde blessure par laquelle
il perdit tout son sang; quelques minutes après, il rendait son dernier
soupir entre les bras de son compagnon de travail."
La Feuille de Provins du 20 décembre
1884.


On peut penser que la mortalité fut élevée tant les conditions de vie pouvaient être rudes, entre un travail dangereux et harassant de l'aube au crépuscule et au delà; pendant la mauvaise saison et par tous temps; un hébergement sommaire, une hygiène très approximative : comment se laver en hiver en forêt de Villefermoy? Et où y trouver de l'eau potable? Point de sources, uniquement des mares, un grand étang, bien sûr, qu'il fallait partager avec les grenouilles et un minuscule ruisseau, le ru Guérin. Les scieurs de long furent d'ailleurs plus atteints par l'épidémie de choléra en 1832 que d'autres migrants, comme les maçons, qui pouvaient tous loger dans des maisons.
![]() Doc : scieurs et terrassiers décédés du choléra
Doc : scieurs et terrassiers décédés du choléra
![]() Début du dossier sur le choléra de 1832 en Brie
Début du dossier sur le choléra de 1832 en Brie
Il faut dire que le Forez et le Velay n'envoyaient sur les routes que leurs
hommes les plus forts. Les chétifs, les malingres, les malades restaient
au pays faute de pouvoir supporter le voyage et l'éprouvante saison
de "scie".
Ces jeunes migrants n'eurent d'ailleurs pas trop de mal à trouver
une épouse pour se fixer en Brie, comme on le verra plus loin...


Rare mention de la cause du décès,
pendant l'épidémie de choléra de 1832 qui toucha Paris
en mars avril et les communes rurales autour de Villefermoy en juillet août
septembre:
" Acte de décès de André Forgette mort du coléra
...sont comparus les sieurs André Malfend, sieur de long, âgé
de vingt sept ans, demeurant au hameau de Sansnac commune d'Aligre département
de la Haute Loire, travaillant dans ce moment au Volsin en laditte commune,
et sieur Pierre Sébastien Morin, cabartier en cette * âgé
de cinquante ans (* mention marginale: commune de Varennes), lesquels nous
ont déclaré que ce jourd'huit à une heur du matin est
décédé André Forgette (Fargette) sieur de long
âgé de trente deux ans décédé en la ferme
du Volstin commune de Varennes # (# natif de Sainnat commune de Allegre,
département de la Haute Loire), fils de les déclarants neyant
pû me donner les noms et prénoms des père et mère
du décédé, mais je me suis fait remettre son passeport
qui lui avé été délivré a Voulx le vingt
neuf juillet mil huit cent trente un signé par M. Limosin, maire
de Voulx, les déclarants et témoins majeurs onts signé
avec nous le présent acte après lecture excepter ledit André
Malfend qui a déclaré ne savoir signé. "
19 juillet 1832 Etat civil de Varennes sur Seine
AD77 5 Mi 6735 p 95
Il semblerait que Denis François Barbier, adjoint
de Varennes ait été troublé par l'épidémie
car il accumule les oublis rectifiés dans la marge, les approximations
dans les noms Forgette au lieu de Fargette (et Malfend au lieu de Malfand
ce qui est plus compréhensible).
Il est étonnant qu'André Malfand, né au hameau de Chabannes
(4 maisons, 29 habitants), et résidant probablement au hameau de
Sassac (17 maisons, 83 habitants) n'ait pas connu les parents d'André
Fargette du hameau très proche de Sannac (11 maisons, 58 habitants)à
moins d'un kilomètre des deux autres hameaux. Recensement
Allègre 1846 AD43 6 M 29 p 37
"... les déclarants neyant pû
me donner les noms et prénoms des père et mère du décédé..."
André Malfand, témoin et probablement
équipier d'André Fargette, est né au hameau de Chabannes.
Le 19 mars 1815, sa mère Izabeau, fille denteleuse (= dentelière
en Haute Loire), mit au monde Louise, fille hors mariage dans le hameau
de Sassac; elle décéda peu après, le 3 avril 1815.
André n'avait que dix ans au décès de sa mère.
On ne sait qui le recueillit, ou s'il fut placé dans une famille
éloignée, ce qui expliquerait qu'il ne connaissait pas les
habitants des hameaux proches, et en particulier, ceux de son équipier
présumé, André Fargette.
Etat civil Allègre 6 E 3/19 p 208 et 210