
Texte du livret d'archives
La Chapelle Rablais 1997
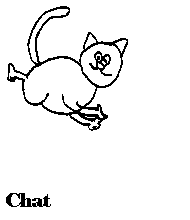
Je
reproduis ici le texte du second livret sur les archives de la Chapelle
Rablais, publié en 1997 et vendu au profit de la coopérative
scolaire. Il y manque toutes les illustrations, dont des cartes. On peut
le consulter à la médiathèque de Nangis, cote 944.37
DUV, aux Archives départementales, cote 295EDT3S1 ou 100J630, ainsi
qu'un premier livret de 1984, AZ14200, ou plus simplement en mairie de
la Chapelle Rablais qui vient de le rééditer avec une nouvelle
couverture et des photographies de Marcel Fontellio.
Depuis sa publication en 1997, j'ai poursuivi les recherches sur le passé
de la commune et découvert de nombreux documents qui l'éclairent,
à retrouver au fil des pages du site...
Introduction
La Chapelle Rablais n'a jamais attiré l'attention, à l'abri de sa forêt. Dans les livres d'histoire, on ne trouve pas de fameuse bataille de la Chapelle Rablais ou de traité de paix des Montils. Ses célébrités se comptent sur les doigts d'une main: un chanteur yéyé qui avait pris le nom du hameau, une ex-concubine de Napoléon III devenue châtelaine, un cheval de course... Ses rues ne portent que des noms de fermes, de bois, de Chemin Blanc, de Vieux Prés, de mares... Pas de héros, de grand savant, d'être exceptionnel; tant mieux; ainsi, l'étude de la vie d'une seule personne, devenue célèbre ne prendra-t'elle pas une importance exagérée, par rapport aux centaines, aux milliers d'hommes anonymes qui ont créé le village, y ont vécu et, peu à peu, l'ont transformé.
Dans cette seconde publication des documents
sur la commune de la Chapelle-Rablais, j'ai essayé d'exposer les
plus significatives des archives qu'il m'a été possible
de rassembler; j'ai découvert quelques documents nouveaux, d'autres
ont pris une signification inattendue. Il est certain que je n'ai pas
tout vu, ni tout compris. Si vous remarquez des erreurs, n'hésitez
pas à m'en informer. J'ai aussi tenté de résoudre
quelques énigmes: pourquoi des hommes ont-ils choisi de s'installer
à cet endroit, pourquoi ont-ils donné ces noms aux lieux
qu'ils fréquentaient: les champs, les bois, mais aussi les villages,
l'église; comment se sont-ils adaptés aux contraintes naturelles
puis ont-ils longuement modifié le paysage?
Les noms de la plupart de ces hommes ont été oubliés,
leurs traces le plus souvent effacées: les papiers perdus, les maisons
détruites, les tombes déplacées; mais il me semble bon
de garder leur souvenir en mémoire comme d'autres évoqueront
peut-être notre bref passage en ces lieux.
JB Duval école de la Chapelle Rablais 1997
La Chapelle Rablais est bornée
au Nord par les territoires de Fontains et de Fontenailles, à l'est
par le territoire de Villeneuve- les- Bordes au sud par celui de Coutençon
et à l'ouest par les territoires d' Echou- Boulains et des Ecrennes.
On trouve au sud- ouest l'ancien manoir des Moyeux accompagné aujourd'hui
d'un joli parc. A l'ouest, le hameau du grand Montils qui compte aujourd'hui
263 habitants.
Dans la plaine qui se développe au sud se trouve la ferme de Tourneboeuf,
le hameau de Frévent, les Farons et Putemuse. Au nord, on rencontre
la ferme des Moulineaux et l'ancien château du Mai. Le village renferme
523 habitants, son territoire consiste en terres labourables et bois et en
prés; il est situé à 6 kilomètres de Nangis à
24 kilomètres de Provins à 24 kilomètres de Melun. Il
est placé au milieu d'une plaine basse sans cours d'eau ce qui le rend
humide.
Extrait du cahier de roulement de l'école octobre
1877
La préhistoire, le Moyen Age, la Haye de Brie, la création des villages... ont été repris dans des pages Internet assez anciennes, du temps des vieux modems et des lignes poussives, d'où des pages très courtes par rapport à celles que je propose aujourd'hui.
![]() Préhistoire, Moyen Age, création des villages...
Préhistoire, Moyen Age, création des villages...
Les origines
L'histoire de la Chapelle Rablais peut se confondre avec celle de ses forêts. Déboisements, cultures, friches, taillis, grands arbres ont dû se succéder au fil des siècles. Chaque expansion des bois recouvrant les traces des anciens agriculteurs. Plusieurs vagues de reboisement ont peut être eu lieu: aux temps barbares après un défrichement possible aux temps gallo-romains; pendant la guerre de Cent Ans, si la population de notre village a été touchée par les désastres de la guerre comme les communes voisines. Ces deux premières évolutions ne sont pas attestées. La troisième vague qui eut lieu au XIX° siècle, favorisée par les gros propriétaires terriens, est mesurable et sera étudiée un peu plus loin. Les friches actuelles laissent présager une nouvelle expansion des bois sur les terrains les moins rentables.
"Jusqu'au cours du X° siècle, le large plateau de la Brie française était resté couvert de sa forêt que la hache avait à peine entamée sur les bords: elle s'appelait la forêt de Bièvre; elle couronnait les hauteurs du bassin de la Seine de Melun à Montereau, et joignait la forêt de Fontainebleau à celle de Chenoise, laquelle se prolongeait jusqu'à la Traconne...,Les forêts de Barbeau, de St Germain- Laval, de Valence, des Montils, les bois de Montigny- Lencoup, de Gurcy, de Villeneuve les Bordes, de Villefermoy, de Châtillon la Borde, la garenne de la Croix en Brie, les bois de Louan et de Montaiguillon, pour ne citer que les plus importants, sont des parties non défrichées de cette forêt de Bièvre." Ernest Chauvet, Nangis Notes historiques
Les cartes archéologiques portent,
en blanc, la marque de la grande forêt de Bièvre dont fait
partie Villefermoy: pas de découvertes; certainement pas d'hommes
préhistoriques. Les hommes de ces temps reculés avaient
choisi de se regrouper le long des voies de communication dans la vallée
de la Seine ou près de ce chemin très ancien que les Romains
ont ensuite aménagé: le Chemin Perré, la voie qui
passait par Châteaubleau. Si quelques haches préhistoriques
ont été retrouvées dans les champs, elles peuvent
être la trace d'un chasseur de passage ou les rares témoins
d'un peuplement oublié.
L'étude de Pierre Geslin consacrée à la Brie antique
laisse aussi en blanc le massif de Villefermoy dans la carte qu'il a tracée
des "fermes à une lieue" supposant par là que
ce territoire n'était pas en culture aux temps gallo-romains.
Mais, un jour, peut-être, la charrue d'un agriculteur ou la pelle
d'un promoteur révéleront-elles des vestiges oubliés.
Alors, certains lieux-dits pourraient prendre une signification nouvelle:
le chemin Perré, au nord des Montils, la Pierre du Compas, la Haute
Borne...
La forêt a longtemps été
peuplée de nomades: des charbonniers, meules de charbon de bois
et forges, des cendriers pour le verre et le savon, des bigres chasseurs
d'abeilles, cueilleurs de cire et de miel sauvage. Sur ses lisières,
les paysans faisaient pâturer les animaux domestiques, surtout des
porcs qui ressemblaient encore à des sangliers. L'épaisseur
de ses sous-bois a donné refuge à des loups, des braconniers,
des voleurs, des ermites... Peut être l'un d'entre eux a- t'il construit
la chapelle qui a donné son nom au village.
Les forêts étaient mystérieuses, elles faisaient peur.
La plupart des contes de notre enfance les peuplent d'ogres, de sorcières
et de magiciens. Les noms de lieux gardent le souvenir des temps oubliés
et nous révèlent la vision que les paysans avaient pu avoir
des terres qu'ils cultivaient, des hameaux qu'ils habitaient au moment
où se créaient la plupart des noms propres de famille comme
de lieux: le Moyen Age. A défaut de posséder une carte de
la région de cette époque, (les voyageurs du Moyen Age ne
dessinaient pas de cartes mais traçaient de simples itinéraires:
des villes ou des carrefours reliés par des traits droits) nous
retrouverons les noms des lieux- dits sur la belle carte de Cassini, milieu
du XVIII° siècle. On y découvre des noms peu rassurants
disposés sur un large cercle centré sur notre village: Maupas,
la Malnoue, Maupertuis (mauvais passage), Malassise, la rue Chaude, la
Diablesse, les Rôtis, le Plessis... On sent la peur, la malédiction
qui pouvait planer autour de ce lieu, car cette forêt était
plus dangereuse encore que les autres bois de la région.
La Haye de Brie
La région a été
dangereuse comme le sont toutes les frontières: les territoires
de la Chapelle et de Fontenailles ont fait partie, pendant une longue
période du Moyen Age d'une zone tampon entre le puissant Comté
de Champagne et l'Ile de France royale. La Chapelle Rablais était
juste dans la Marche séparante comme le suggère la carte.
Depuis le XI° siècle, la puissance des Comtes pouvait rivaliser
avec celle du Roi. Ils s'étaient permis de reculer la frontière
qui était auparavant à la limite de l'ancienne voie romaine:
le Chemin Perré. Les conflits devaient être fréquents;
on garde le souvenir du roi Louis VII qui,
pour se venger de la résistance des Champenois, brûla Vitry
et ses 1300 habitants qui s'étaient réfugiés dans
l'église. Louis Leboeuf, précis
d'histoire de Seine et Marne
Gardée ça et là par des châteaux de bois, les
Plessis, cette frontière aurait été trop perméable
si elle n'avait pas été fortifiée de façon
naturelle. Une forêt touffue de 5 à 15 kms de largeur gênait
le passage des gens d'armes et des cavaliers; on l'appelait la Haye de
Brie. Elle devait rappeler la haie entretenue par les Nerviens qui avait
embarrassé les légions de Jules César qu'il décrit
dans la Guerre des Gaules: ils taillaient
et courbaient de jeunes arbres; ceux-ci poussaient en largeur de nombreuses
branches; des ronces et des buissons épineux croissaient entre
leurs intervalles: si bien que ces haies semblables à des murs
offraient une protection que le regard même ne pouvait violer.
On peut retrouver les limites exactes de la Haie en 1270 grâce à
une sentence rendue au Parlement concernant les commenchemens et les bonnes
(bornes) de terrouirs del roaime et du comté de Champagne. Ce bois-frontière
a été défriché aux 12° et 13° siècles,
cependant des lambeaux de ses franges se sont conservés jusqu'à
nos jours. Le seigneur de Nangis avait choisi de délimiter ainsi
clairement son territoire qui est depuis le
Grand Chemin Paré, qui passe par Châteaubleau, et de là
tenant à Pécy, et depuis Pécy jusqu'à Courpalay,
et dudit lieu par devers Grandpuits et le hameau du Feuillet... de là,
suivant le long de la Haye de Brie, jusqu'à la Pierre du Compas
et dudit lieu,suivant toujours la Haye de Brie, jusqu'à Valjouan.
Ernest Chauvet
Un chemin de la commune conserve le souvenir de
cette haie.
Après s'être copieusement
bataillés, entre comte Eudes 1°, roi Robert II, Comtes Thibaut,
rois Louis, vint le temps de la réconciliation. En 1255, Thibaut
VII, dit le Jeune, comte de Champagne et roi de Navarre épousa
Isabelle de France, fille de St Louis au château royal de Melun.
En 1284, Jehanne de Navarre, fille du comte Henri
III le Large épousait son cousin Philippe, le second fils du roi
de France et en 1285, par la mort de son père et de son frère,
l'époux de Jehanne devenait roi de France sous le nom de Philippe
le Bel. La Champagne et la Brie étaient réunies à
la Couronne. Louis Leboeuf
La frontière n'avait plus raison d'être; la Haye de Brie
subsista, très réduite en taille car Pierre Britaud, seigneur
de Nangis au XII° siècle d'accord avec le seigneur du Châtel,
avec l'abbé, seigneur de Donnemarie, et les autres riverains, conserva
une lisière de bois, large d'environ deux cents mètres,
qui enveloppait les deux seigneuries nangissiennes et les séparait
du Montois et des fiefs voisins. Ernest Chauvet
Si le conflit cessa à la fin du XIII° siècle, il est
probable que le défrichement de la plus grande partie de la Haie
de Brie eut lieu au cours du siècle précédent; non
que les frictions entre les deux grands féodaux aient cessé,
plutôt parce que bien des choses avaient évolué. En
premier lieu, les techniques de fortification: au XI° siècle,
les forteresses étaient encore pour la plupart en bois, comme la
grosse tour de Montereau qui, bâtie à cette époque
ne sera remplacée par un château de pierre qu'en 1227. Des
maisons fortes rendaient moins nécessaire la protection d'une vaste
forêt. Comte et Roi avaient entouré la zone frontière
de Villes Neuves dont les habitants, en plus d'apporter de nouveaux revenus
à leur seigneur, pouvaient servir de réserves de soldats,
proches de la région à défendre. L'extension des
domaines cultivables avait été rendue nécessaire
par un fort accroissement de la population; il fallait trouver de nouvelles
terres puisque l'agriculture ne permettait pas d'améliorer les
rendements. Certains seigneurs laïcs ou religieux devinrent entrepreneurs
en défrichement.
Le défrichement
"Moins répandus en France
qu'en Allemagne, les entrepreneurs de défrichements, cependant,
n'y ont pas été un type social inconnu. Beaucoup d'entre
eux furent des hommes d'Eglise: dans la première moitié
du XIII° siècle, deux frères, Aubri et Gautier Cornu,
prirent ainsi à l'entreprise -quitte à distribuer ensuite
des lots à des sous entrepreneurs- l'essartage de nombreux terrains,
découpés dans les forêts de la Brie.'"Deux
des frères Cornu ont été cités dans l'extrait
des "Caractères originaux de l'histoire rurale française
de Marc Bloch.
Elargissons le cercle de famille: Vers 1180, vivait
à Villeneuve- Cornut, aujourd'hui Salins, près Montereau,
une veuve nommée Elisabeth. Cette veuve avait quatre fils qu'elle
éleva dans la crainte de Dieu; le premier, Gauthier Cornut devint
archevêque de Sens, le deuxième Albéric Cornut fut
évêque de Chartres; le troisième, Gilon Cornut fut
archidiacre, puis archevêque de Sens et succéda à
Gauthier, son frère aîné; le quatrième resta
avec sa mère à Villeneuve.
dans Congrès Archéologique de France
Dijon 1852
Ce texte peu rigoureux (Simon 1 ° eut cinq fils et une fille, l'aîné
n'en étant pas Gauthier, mais Simon II qui reprit la châtellenie
ainsi que le montre Paul Quesvers, l'historien de la famille Cornu), montre
en peu de mots l'importance des futurs seigneurs de la Chapelle Rablais
et Fontenailles. Elisabeth (ou Isabelle) Clément, épouse
de Simon 1° était elle- même fille de Robert Clément,
régent du royaume sous Philippe Auguste.
La base du défrichement de la forêt et de la création
de la Chapelle Rablais et Fontenailles est le petit village de Salins.
Voici comment il fut attribué à cette dynamique famille:
"L'abbaye de Faremoutiers était
bénéficiaire, au IX° siècle, du fief dit de la
Tombe. Elle en céda une part au XII° siècle, au sire
Hilduin qui la donna aux abbayes de St Denis et de St Germain des Prés.
Le roi reprit des terres pour en gratifier le vicomte de Thiange qui créa
la seigneurie de Marolles, fit bâtir en 1203 le village de Villeneuve
en Brie, donna ce fief à Gilles le Cornu qui lui donna son nom."
Pignard Peguet, monographie de Châtenay
Bel exemple de pyramide féodale que l'on verra se prolonger sur
les lieux du défrichement. Mon collègue du siècle
passé ajoute: par suite des débauches
et des désordres de ce couvent royal, les terres furent détachées
de leur unique suzerain et passèrent aux Seigneurs des environs.
M. Boisvieux, instituteur, monographie de Salins
1889
Marc Bloch ne cite que deux des frères
Cornu: Albéric et Gautier II. Il passe sous silence Simon II que
je soupçonne d'être à la base du défrichement
de la forêt qui donnera naissance à nos villages. Gautier
II, fils des déjà nommés Simon 1° et Isabelle
Clément était chanoine de Paris; il devint archevêque
de Sens en 1240. Entre temps, il avait mené à bien un défrichement
dans la région de Rosay en Brie, plus précisément
à Voinsles, pour la Comtesse de Champagne en 1216. Son frère,
Albéric ou Aubry, lui aussi chanoine de Paris qui deviendra évêque
de Chartres en 1236, aura défriché la région de Vernou
pour le compte de Notre Dame de Paris à partir de 1225 jusqu'en
1240.
Quant à Simon II, fils aîné et pour cela seigneur
laïc de Villeneuve la Cornue alors que ses frères ont dû
choisir la carrière ecclésiastique, serait-il resté
les bras croisés à côté d'un bel espace vierge
qui a certainement été défriché à cette
époque? Je pense qu'il a suivi l'exemple de ses frères,
ou même, qu'ils travaillaient ensemble. Mais aucun document n'existe
qui prouverait l'action de Simon, comme on peut authentifier celle de
ses frères.
Après sa mort, en 1266, le fief de Simon sera partagé entre
deux de ses neuf fils: Pierre gardera la seigneurie de Villeneuve la Cornue,
Gautier deviendra le premier seigneur de la Chapelle Rablais et Fontenailles
en Brie; les autres enfants occupant de hautes fonctions dans le clergé,
pour éviter le morcellement du territoire.
En 1292, Gautier fait établir un rôle des vassaux, première
réfection des Terriers. Le rôle en question est un
mince cahier, en parchemin, de 13 feuillets dont le dernier, quoique coupé
par la moitié, est cependant complet. L'écriture est de
la fin du XIV° siècle, ainsi que le fragment de missel qui
lui servait de couverture; c'est vraisemblablement la copie d'un manuscrit
plus ancien dont la date est donnée dans notre manuscrit. Les abréviations
sont bonnes et l'écriture est très claire, sauf deux ou
trois mots que je n'ai pu déchiffrer. Très modestement,
je n'aurais pas pu lire ce manuscrit; il a heureusement été
retranscrit par Paul Quesvers, à la fin du siècle dernier.
Les fiefs
Ce sunt li fieu que len tient
de mon seignor Gautier le Cornu a la Chapelle Erabloy. C'est lefey Agnès,
de la Chapelle de Erabloy: sa meson ou elle maint et sa granche et IIIJ
arpens de terre meson et tout, et li doit XVd.o. de cens a la Saint Remi
de lotise qui fut Gilet le Forestier, et le lendemain de Noël, les
IIII pars de 1 chapon de ce meismes, et si tient IIII arpenz et demi de
terre vers la haie, et arpent et demi a la Flatoire, et XV quartiers au
Trembles et doiuent XLV d. de cens a la S. Remj.
En 1292 commence à s'écrire l'histoire des habitants de
la Chapelle Rablais. Sept cents ans, trente générations
de paysans... Les "grands parents" s'appelaient Ysabeau la Picarde,
Jacquet Cordier, Loré le Charbonnier, Jaquet Marié et la
Borue, Milon le Suor, Gilot Forcul, Theuenot des Molins... Cent dix ménages
sont comptés sur les paroisses de la Chapelle et de Fontenailles.
Quelle population, à une époque où plus de 40% des
ménages avaient entre 8 et 15 enfants?
Le fief des Cornu était morcelé en petites seigneuries.
Henri de Beau Marches, Guillaume de Vernou, Guiot dou Pré, Jehen
Déniant, eux-mêmes vassaux de Gautier Cornu étaient
suzerains de paysans qui leur devaient, à leur tour, l'impôt;
et même recevaient l'hommage de petits seigneurs comme Jehans de
Montrimble, seigneur de Malnoe. On y rencontre même des arrière-arrière
vassaux: à Montceaux, Gautier Cornu a pour vassal Jehen Demant
qui a pour vassal Henri, maire de Montceaux (il faut entendre par là
qu'il percevait les impôts dûs à son seigneur et non
qu'il était premier magistrat de la commune qui ne fut fondée
qu'en 1560). Cet Henri a pour vassal Jehen li Queuz, Gautier et Pierre
de Felimain. C'est, sur un tout petit territoire, un bel exemple de la
pyramide féodale où chacun était vassal de quelqu'un.
Il est dommage que les arpenteurs du Moyen Age aient si peu aimé
les cartes. Ils auraient fait figurer les maisons fortes, sièges
des seigneuries à la Chapelle- Rablais, Fontenailles, le Mée,
le Rû . On y aurait retrouvé le château: La
fame feu Adam dou Val tient de Guillaume IIII arpanz de terre delez les
boys dou chasteau, les moulins à eau: item,
le molin de Lepoisse et le sauçoi delez le ru de leitanpar deuers
Fontins; item,enuiron XII arpenz do terre de sus le moulin par deuers
Fontins... les vignes, heureusement situées
uniquement sur les coteaux de Fontenailles. Parenthèse: j'espère
qu'il n'y en a jamais eu sur le terrain argileux de la Chapelle où
le vin aurait été pire encore que celui redouté par
Boileau:
Je consens de bon coeur pour punir ma folie
Que tous les vins pour moi deviennent vins de Brie.
(La carte essaie de situer les lieux cités dans le rôle des vassaux et d'en trouver une signification possible. Restent quelques noms sans localisation: les Trembles, Queuelevée qui a un rapport avec l'extrémité d'un champ, Terreachat qu'on peut rapprocher de la Rachée ou terre à chaux; d'autres encore: Saleri, Felimain, la Puisière, la Troigne.. qui sont peut-être les villages d'origine des paysans.)
![]() Lien vers la carte des lieux-dits au Moyen Age
Lien vers la carte des lieux-dits au Moyen Age
C'est lefey que monsor Henri de Beau marches tient de monsor Gautier le Cornu: c'est assavoir en viron IIII XX arpens de boys au grand arpent qui tient au bois devant Le Mes et au haies de Brie, et XIII arpen: au grant arpent delez le chemin de Brie, et LVII arpem et III quartiers delez les haies de Brie, et delez le boys Saint Germain a larpent de Champeigne, et des haies de Brie XXV arpenz au grand arpent; item la moitié du fief de la Charmée.
Les colons qui défrichèrent
la forêt étaient attirés par des conditions particulières.
Les impôts étaient moins lourds que sur des terres déjà
mises en culture: environ 4 deniers par arpent, pour des superficies moyennes
de 4 arpents, sans compter la dîme de la dixième ou onzième
gerbe. Les contraintes, pour créer une hôtise, étaient
multiples: obligation de défricher, interdiction de rétrocéder
des terres à des chevaliers ou à des églises, obligation
de demeurer pour celui qui héritait... Cochet Cochet C'est ce qu'imposait
le chapitre de Notre Dame de Paris pour ses défrichements sur Vemou,
organisés par Aubry Cornu; il est probable que les conditions ont
été semblables pour notre forêt. Un chemin fut tracé,
le long duquel les hôtes commençaient à couper les
arbres, installaient l'herbagium: maison, cour, bâtiments, jardins,
dépendances, d'une superficie inférieure à un arpent,
puis continuaient le défrichement, créant de longues clairières
à l'arrière de leurs maisons. Ces étroites parcelles
se retrouvaient encore sur le cadastre, au début du XIX° siècle.
Etaient-ils tous des hommes libres? Le servage existait encore: en
1239, Simon II vend à Simon, abbé de St Germain des Prés,
plusieurs hommes de corps à St Germain Laval pour 40 livres
Maurice Lecomte C'est
une belle somme: les impôts sur la Chapelle Rablais payés
à la St Rémi ne rapportant au seigneur comme
Summe de tôt: IXlib. VIII s.o Plus tard, encore, Aubry , le 12 juin
1283 transigea avec le Chapitre de Sens sur le partage de leurs hommes
et femmes respectifs mariés ensemble Paul
Quesvers
Les colons venaient de Montigny, Rubelles, Machault,
Melun, Provins... puisque c'est le surnom qu'on leur donne. Les noms de
famille ne sont pas encore fixés; on accole au prénom la
provenance Aaliz, fame de feu Jehan de Rosoi,
un défaut ou une qualité: Forcul,
Platpié, le Plusbeau, Houdin le Roi -il
n'était Roi que du tir à l'arc- ou le métier. On
peut donc connaître les activités pratiquées dans
les premiers temps du village: le Cerclier,
le Charbonnier, des Boys, le Forestier, le Cendrier, le Cordier, le Monier,
des Molins, le Coutelier, Lefebvre (forgeron), le Suor (cordonnier), le
Prestre.
La forêt ayant été pendant quelques siècles
la frontière imprécise entre le Comté de Champagne
et l'Ile de France royale, la clairière de défrichement
emprunta des deux territoires. La superficie de certaines parcelles du
rôle des vassaux de 1292, sur Coutençon, est mesurée
à l'arpent de Champeigne, correspondant à une perche carrée
de 20 pieds, soit 42,21 ares, mesure qui figurait encore sur le cadastre
en 1831. Plus au nord, on employait le grand arpent de 22 pieds carrés,
soit 51,07 ares, comme l'indique la citation.
Loin des quelques perches carrées
attribuées aux hôtes, quatre grands vassaux ont des domaines
d'environ 200 arpents. Ce ne sont pas de simples paysans.
Jehen Demant était intendant d'un domaine à Monceaux, peut
être la Brosse Montceaux proche de Marolles, puisqu'il existe aussi
un Miles de la Brouce. Guiot dou Pré compte, parmi ses vingt vassaux
Jehans de Montrimble, seigneur de Malnoe et plusieurs escuiers: des chevaliers
non encore adoubés. Deux vassaux de Gautier Cornu, ont attiré
mon attention: Henri de Beau Marches, dont les domaines sont décrits
dans la citation et Guillaume de Vernou. Leur provenance est Vernou et
Beaumarchais, de la commune des Chapelles Bourbon près de Rosay.
Exactement les lieux des défrichements des oncles de Gautier III:
Gautier II qui essarta Rosay en 1216 et Albéric qui défricha
Vernou en 1225. La coïncidence est trop grande! Je pense que trois
frères Cornu sont devenus entrepreneurs en défrichements,
Simon ayant créé nos villages.
Les origines du nom
Au jeu du téléphone
arabe, un premier enfant chuchote une phrase à un second qui transmet
ce qu'il a cru comprendre à un troisième et ainsi de suite.
Pour peu que la phrase d'origine soit un peu obscure, il est certain que
ce qu'aura compris le dernier n'aura qu'un lointain rapport avec ce qu'avait
proposé le premier. Il en est de même pour les noms inconnus;
s'ils ne sont transmis qu'oralement, il y a de fortes chances pour qu'ils
le soient mal. Alors même qu'ils sont écrits, il arrive d'y
faire des fautes. Combien de lettres a-t'on reçu à la Chappelle
Rabelais avec un E comme l'auteur de Gargantua et deux P à Chapelle?
Au moment de la création du village, l'usage de l'écriture
était très rare, réservé aux actes officiels:
les Terriers qui recensaient les possessions des seigneurs et les obligations
de leurs vassaux; les minutes de procès, le plus souvent à
cause d'une contestation concernant les limites d'un territoire ou les
droits qui s'y rapportaient.
C'est pourquoi la première mention écrite d'un village ne
correspond pas forcément à la date de sa création,
comme le nom qui est inscrit pour la première fois est peut-être
fort éloigné de celui qui avait été donné
à l'origine.
Le premier texte citant notre commune date de 1175 et concerne l'abbaye
de St Germain des Prés. Déjà, au siècle de
Charlemagne, le polyptique d'Irminon décrit les possessions de
St Germain: Trente à trente cinq
mille hectares sont attribué à cette abbaye en vingt cinq
domaines éparpillés de la Bretagne à la Lorraine,
subdivisés en milliers de petites tenures. Pierre
Gaxotte Histoire des Français L'abbé
Denis, dans ses Lectures sur l'histoire de l'agriculture, décrit
les possessions de St Germain dans la Brie, dont des domaines autour d'Esmans.
L'abbaye de St Germain possédait des bois sur Echou-Boulains qui
en ont gardé le nom. La première citation de la Chapelle
en 1175 est: Foresta de Herablen. Il ne s'agit donc que d'un bois, à
la limite de la forêt de St Germain. A noter que le mot Foresta,
s'il désigne, évidemment, une forêt a un autre sens:
Les rois mérovingiens, grands chasseurs,
avaient constitué des réserves non loin de leurs résidences.
Il se peut que le mot Foresta qui apparaît au VII° siècle,
désigne des districts réservés aux chasses royales.
Les princes avaient le privilège d'abattre les bêtes fauves,
aurochs, ours, sangliers... Duby
La première fois que ce qui deviendra Rablais
est cité, c'est sous la forme Herablen, puis Erableyo, ensuite
Aarabloi, Erableii, Darblay, Roableyo... Laquelle de ces formes correspond
au nom primitif, celui qui a eu un sens? Il faudrait être capable
de remonter à l'envers la chaîne du téléphone
arabe!
Terres proches appartenant à
des établissements religieux:
la Chapelle Gauthier: collégiale de Champeaux
Coutençon, Clos Fontaine, la Croix en Brie: Notre Dame de la Charité,
Cluny, puis ordre de Malte, comme Rampillon qui appartint aux Templiers.
Echou et Boulains: religieux de Preuilly, ordre cistercien et St Germain
des Prés
Les Bordes: religieux de Ste Colombe de Sens comme Putemuse, sur le territoire
de la Chapelle Rablais
Grand Puits: abbaye de St Denis comme St Ouen en Brie
Les Ecrennes: abbaye de Barbeau, proche de Fontaine le Port comme Villefermoy
dont la forêt est nommée Forest de Barbeau, sur cette carte.
Laval: abbaye de St Germain des Prés.
Sur le territoire de la Chapelle Rablais, des terres étaient destinées
aux boursiers du collège du Cardinal Lemoine, lieu-dit les Cardinaux.
La Chapelle
Afin que les ouvriers qui se livraient
à l'agriculture ne fussent pas privés d'assister au sacrifice
de la messe, lorsque leurs travaux les retenaient loin de leurs habitations,
nos pieux ancêtres fondèrent dans la campagne une infinité
d'oratoires auxquels ils attachèrent des revenus pour l'entretien
de l'ecclésiastique chargé de les desservir. Ainsi,
au début du XIX° siècle, M. Pascal justifie-t'il la
dénomination de la Chapelle pour notre village, signalant qu'il
existait en France 212 communes portant ce nom.
Une chapelle: Capella de Erableyo est citée pour la première
fois en 1275, cent ans après Foresta de Herablen. A cette époque,
les colons qui ont défriché la Haye de Brie sont installés
depuis au moins une génération: en 1292, on compte cent
dix familles, combien d'habitants? N'aurait-on érigé qu'une
simple chapelle pour une communauté villageoise aussi importante
ou bien la chapelle existait-elle avant le village, avant même que
la forêt ne soit défrichée et peuplée puis,
sur le même emplacement, remplacée par un bâtiment
plus important?
Le saint patron auquel l'église est dédiée est St
Bon ou St Bonnet. Clercs et moines se disputent
les restes d'un Bonet de Clermont (mort en 706), d'un Léger d'Autun
(mort en 680) Georges Duby Pourquoi
se mettre sous la protection d'un tel personnage, presqu'inconnu? Je penche
pour un autre religieux, plus proche de nous sinon dans le temps, du moins
dans l'espace: St Bond, ermite dans l'archevêché de Sens
vers 620 auquel fut dédié un prieuré non loin de
cette ville. Inscriptions de l'ancien diocèse
de Sens La Chapelle Rablais fit partie
de ce diocèse jusqu'en 1790; la famille Cornu, ses seigneurs, donna
plusieurs archevêques à cette ville qui fut l'un des centres
religieux et politiques de la Gaule puis de la France (la ferme du Mée
s'appelait d'ailleurs le Mée l'Archevêque).
Peut- être les premiers habitants du village ont-ils dédié
la chapelle à ce St Bond local. Peut être était-ce
là l'emplacement de son ermitage? Pour l'instant, ce ne sont que
des suppositions.
L'implantation des Montils suit une
crête de grès presqu' imperceptible mettant les maisons au
sec sur un terrain jugé "chaud et sablonneux" alors qu'il
est autre part "froid et argileux"; ainsi le décrivait
mon prédécesseur, chargé de la monographie de la
commune en 1889, pour le centenaire de la Révolution Française.
Le seigneur a dû faire tracer un chemin de chaque côté
duquel il a donné des concessions. Le paysan était chargé
de construire sa maison, le plus souvent le long du chemin, puis de défricher
perpendiculairement à la route, élargissant peu à
peu la clairière. On retrouve ce schéma de petites parcelles
en arêtes de poisson sur le cadastre ancien, avant l'exode rural
puis le remembrement. Les Montils sont cités par les professeurs
d'histoire de Seine et Marne comme village typique du défrichement
moyen-âgeux.
Le plan du chef-lieu est différent: il a un centre autour duquel rayonnent les rues. C'est l'église, certainement reconstruite à l'emplacement d'un monument plus ancien dont elle a réutilisé des matériaux puisque on y retrouve quelques pierres taillées en visages humains et signes mystérieux à des emplacements sans gloire: sous le toit, près de la chapelle, le long du contrefort droit où on distingue deux visages et une gravure qu'on pourrait interpréter comme un poisson surmontant une boule, signe de reconnaissance des débuts de la chrétienté, le poisson ayant précédé la croix comme symbole chrétien; ce pourrait être aussi la marque, cachée à l'origine, d'un ouvrier tailleur de pierres.
Cartulaire du Paraclet
Le village est cité pour
la première fois dans le Cartulaire du Paraclet, c'est à
dire, dans le registre où les religieuses de cette abbaye transcrivaient
les dons reçus et notaient les titres de propriété
de cette abbaye fondée en 1130. Dès 1147, le légat
du Pape en dresse une longue liste pour confirmer les droits des nonnes:
des bois à Courgiveaux, aux Brosses, à
Marcilly, à Pouy, à Charmoy. Des terres à Fontenay
le Pierreux, à Bossenay, à Pommereaux. Des dîmes en
nature sur les propriétés de nombreux seigneurs de la région
qui contribuaient au ravitaillement du monastère en blé,
seigle, volailles, viandes ou poissons. S'y ajoutaient de nombreux biens
immobiliers, maisons, moulins, vignes, près ou champs. Albert
Willocx Ces noms évoquent des terres
proches du monastère situé dans l'Aube, dans l'arrondissement
de Nogent sur Seine. Son extension, due à sa renommée, exigea
la création de prieurés dépendant de la maison mère,
dont l'un St Thomas de Laval, prieuré du diocèse de Sens
soumis à l'abbaye du Paraclet établi à Donnemarie
en Brie histoire de la Ville et du Diocèse de Paris
La pratique des dotations aux ordres charitables se prolongera jusqu'à
la fin de l'Ancien Régime, comme l'atteste celle que fit le Marquis
de Guerchy, seigneur de Nangis et de la Chapelle, le 9 mai 1745 à
l'Hôtel Dieu, entre autres: 200 livres
de rente foncière non rachetable à prendre par chacun an
sur la terre et la ferme des Farons, située finage de la Chapelle
Rablais, consistant en 120 arpents de terre et 17 arpents de Blé.
Trouver, dans le dictionnaire topographique du département de Seine et Marne de Hubert et Stein, après Foresta de Herablen, vers 1175 (Poupardin, St Germain des Prés, I, p291), la mention: Capella de Erableyo, 1275, (Cart.Paraclet) pouvait laisser entrevoir un rapport avec un personnage, ou plutôt avec le couple le plus célèbre de l'histoire du Moyen Age.
Il s'agit bien du très scandaleux Abélard et de son épouse Héloïse, chanté par Georges Brassens sur un poème de François Villon:
Dictes moy ou, n'en quel pays
Est Flora la Belle Rommaine,
Archipiades, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine,
Echo parlant quand bruyt on maine
Dessus rivière ou sus estan,
Qui beaulté ot trop plus qu'humaine.
Mais ou sont les neiges d'antan?
Ou est la tres sage Helloïs,
Pour qui chastré fut et puis moyne
Pierre Esbaillart à Saint Denis?
Pour son amour ot ceste essoyne...
Mais ou sont les neiges d'antan?
Pour résumer l'épisode
célèbre voici un extrait de l'Encyclopédia Universalis:
Après quelques années de succès
paisible, il séduit Héloïse, fille fort lettrée,
nièce du chanoine Fulbert; un fils leur naît, qu'Héloïse
nomme Astralabe; Fulbert les contraint à un mariage qu'ils veulent
garder secret. Héloïse s'étant retirée au monastère
d'Argenteuil, Fulbert la croit répudiée et fait émasculer
Abélard. Les deux époux entrent en religion, elle à
Argenteuil, lui à St Denis.
De sa désagréable mésaventure,
Abélard lui même écrira "Conformément
à la justice, l'organe qui avait pêché est celui qui
a été frappé et qui a expié, dans la douleur,
le crime de ses plaisirs."
Hélas, pas d'Abélard à la Chapelle Rablais qui n'a
jamais fait partie des biens du Paraclet, l'abbaye que fonda le mari puis
que reprit sa femme. Notre village n'est cité qu'à cause
d'une simple dispute entre religieux au sujet du droit à percevoir
les impôts, comme le confirme l'extrait provenant de la bibliothèque
de Troyes:
Lettre d'ung discord avec le chappitre de Sens:
Girardus, decanus, totumque capitulum Senonense.. Notum facimus, quod, cum
contentio sive discordia verteretur inter nos et sanctimoniales de Paraclito
de decimaria in territorio de Monte Bruleti, de Nangis, et de Monte Dei...
Une traduction rendra plus clair le sens, les
lieux cités gardant leur mystère...
Girard, sizenier, et tout le chapitre de Sens faisons
connaître qu'alors qu'une tension ou un désaccord s'est élevé
entre nous et les religieuses du Paraclet au sujet d'une décision fixant
la dîme sur le territoire du Mont Brûlé, de Nangis et du
Mont de Die.., Les religieuses, par ailleurs, percevront en toute paix et
quiétude la dîme de toutes les terres qui sont par devers le
Mont Brulé comme se réunissent le rû du Bourguignon et
le rû de Spissia Lumbardi continûment et en droite ligne jusqu'à
Plantehart et jusqu'à Charmenta en suivant le chemin jusqu'à
la masure du défunt Tyon et de la masure du défunt Tyon en suivant
le chemin jusqu'à Bordeta et de Bordeta jusqu'à Frantaillia,
aux limites concernant la dîme de la Chapelle Rablais ... seu confinia
decimarie de Capella de Erableyo. Datum anno Domini M° CC° LXXV°,
mense julio. traduction: Mme Antil
L'histoire de la commune
L'histoire de notre commune a été publiée à plusieurs reprises par des érudits comme Michelin en 1829, réédité canton par canton chez Amatteis, Lecomte dans l'Almanach de Seine et Marne de 1909, ou Pignard-Pegnet en 1911. Leur propos était de rédiger, commune par commune, l'histoire de la Seine et Marne. Ils se sont attachés à donner la succession des seigneurs telle qu'on peut la reconstituer à partir des archives antérieures à la Révolution déposées aux Archives Départementales à Dammarie. D'une écriture difficile à déchiffrer, surtout au XVII° siècle, nombre d'entre elles sont heureusement résumées, imprimées, et disponibles en salle de lecture.
![]() Lien vers les documents sur la commune
Lien vers les documents sur la commune
On peut ainsi y lire, cote B 506-1636:
..La Chapelle Rablais où existaient deux
fiefs, l'un appelé les Moyeux appartenant à Pierre Lefèvre,
l'autre, le Mée l'Archevêque appartenait à Antoine
Saive, consistant en maison manable, grange, étable, jardin avec
cent arpents de terres, bois et prés, droit de haute, moyenne et
basse justice, le tout affermé IX vingt livres par an...
Sur la carte de Cassini ne figure pas de gibet,
comme à St Ouen, près de la Tuillerie ou la Justice de Nangis.
N'ayant pas fait de réelles recherches sur les siècles qui séparent le rôle des vassaux du premier cadastre, permettez- moi de recopier en partie l'article de Maurice Pignard-Pegnet:
...Après cette famille
(les Cornu), les seigneurs de la Chapelle- Arabloy ont eu à enregistrer
les dégâts de la Guerre de Cent Ans accompagnés de
l'émigration et de la ruine. Au XVI° siècle, en vertu
du droit du premier possédant, chacun s'empara de ce qu'il pouvait:
celui-ci des Moyeux, celui-là des Montils, un autre de Tourneboeuf,
un quatrième du Mée l'Archevêque, créant ainsi
autant de seigneuries partielles et de fiefs distincts. Pierre Lefèvre
Desclos devint ainsi seigneur des Clos de Fontains et seigneur des Moyeux
où il éleva un château et une chapelle; un sieur de
la Brière occupa les Ménils* avec son château seigneurial;
le Mée l'Archevêque devint la propriété d'Antoine
de Saive, Tourneboeuf celle d'Etienne d'Avran. La famille de la Brière
prospéra aux Montils qu'on appelait la Borde lez Montils. Cyprien
de la Brière réunit en 1747, aux Montils, les fiefs de Tourneboeuf
et des Moyeux.. Le fief de Putemuse, qui appartenait aux religieux de
Sainte Colombe, fut annexé en 1633 par François le Rahier,
seigneur des Bordes l'Abbé. Son fils acheta en 1686 le Mée
qu'il revendit en 1721 à François des Roches-Herpin, seigneur
de Bois Boudran. Le marquisat de Nangis, qui s'était formé
en 1612 au profit d'Antoine de Brichanteau, s'annexa plus tard la seigneurie
principale...
Est-ce que cette suite de noms et de dates révèle la transition
entre le temps des seigneurs et celui des bourgeois?
Les réfections des Terriers (1555, 1627, 1650, 1724...), les divers
procès doivent-ils être considérés comme de
simples anecdotes ou des repères? Je n'ai pas découvert
les documents qui permettraient d'éclairer un peu mieux cette période
-ou peut-être n'ai-je pas su les interpréter correctement.
Par exemple, j'aimerais découvrir, un jour, les recherches effectuées
sur le château des Moyeux commandées par l'un de ses anciens
propriétaires, monsieur Vannier.
* Ménil signifiait Moulin. Il en existait trois à l'époque: le moulin à eau de l'abbaye de Villefermoy, un moulin à vent situé sur une petite butte, au bout de l'allée face au château de Villefermoy et un à l'entrée des Montils.
Quelques documents sur l'histoire de la commune consultables aux Archives Départementales, Dammarie :
Terriers dans la section E (E 208 etc..). Almanach de Sens, 1789 pages 34-35. Michelin notes historiques 1829 tome V, pages 1556-1557 réédité chez Amatteis en 1982. Almanach de Seine et Marne 1909. Paroisses et communes de France p 245. Maurice Pignard Peguet, Histoire générale illustrée des départements, la Seine et Marne 1911. Ernest Chauvet Nangis, notes historiques 1910, réédition Amatteis.
Les maux arrivoient tant par les gens mêmes
du Roy que par les Anglois, et estoit la pillerie par toute la Champagne et
la Brie, en telle manière qu'un hommme n'y pouvoit metttre remède.
XV° siècle
Les laboureurs hors d'espérance de pouvoir semer les bleds, les vignerons
de faire leur vendange. XVI° siècle
Toutes les femmes et les filles en fuite, et les habitans restez sans
meubles, ustanciles, vivres et destituez de tout secours spirituel et
temporel. Mais, sur tout les malades languissans, moribons et mourans,
sans pain, sans viande, remèdes, feu, lit, linge, couverts. XVII°
siècle
L'Histoire, de la guerre de Cent
Ans à la Fronde, semble être en constante répétition
pour le paysan. Il semble que le cultivateur cherchait à subsister,
à survivre, entre deux catastrophes.
Son exploitation a été rançonnée par les guerriers
de tous les aveux, par des compagnies de soldats ou de brigands. Une année
sur trois, pendant cette période, a été année
de guerre. Les paysans briards ont vite appris à fuir ceux qui
les pillaient et dont le combat les concernait si peu.
La forêt a dû être leur meilleure protection, après
même que la construction des remparts de Nangis en 1544, sous François
1° à cause de plusieurs larcins,
vols, pilleries, rançonnements, violences de filles et autres efforts
et violences qui se commettaient chaque jour audit bourg de Nangis.
Nangis, notes historiques
La Chapelle Rablais n'est pas citée parmi les nombreux villages
touchés par les pillages. Sa situation éloignée des
grands chemins, l'isolement procuré par la Grande Haye (ou l'absence
de documents) peuvent l'expliquer.
La situation des paysans de cet âge classique rappelle étrangement celle des populations des pays d'Afrique, d'Asie... poussés à la limite de la survie par faits de guerre ou de climat. Si la guerre s'est éloignée, si le climat s'est adouci, si les invasions de rats, de loups, la peste et autres épidémies, la famine ont cessé de préoccuper le paysan briard, essayons d'imaginer avec quelle angoisse ont dû être vécus les mois de "soudure" entre deux récoltes. Comme elle offrait la sécurité contre les pillards, la forêt a dû permettre la survie pendant les périodes de disette, quitte à manger racines et glands au risque de mourir du "Trousse Galant".
Un exemple de changement de propriété pendant la guerre de Cent Ans: l'inventaire des Clos établi, peut-être, pour payer la rançon de Tristan de Maignelay, capturé à la bataille de Poitiers en 1356, alors qu'il portait la bannière du fils de Jean le Bon, duc de Normandie. Souvenez-vous: "Père, gardez-vous à droite, Père; gardez- vous à gauche..."
"L'Ostel appelé des CLOZ, c'est assavoir une grant sale contenant trois chambres dessus et deux dessoubz. Item, un grand grenier et étables dessoubz, une chapelle, cuisinne et despence dessus joignant ausdictes chambres et sale. Item, une granche à dix travées couverte en tuille. Item, le colombier tournant à eschiele à roue bien peuplé de coulombs. Item, une maison contenant deux chambres et une cave dessoubz à dix pas de degrez, un gelinier et dessoubz une estable à mettre pourceaux, cloz à murs tout entour le pourpris et trois jardins emprès. "
La Révolution
On se souvient des tableaux d'histoire
Rossignol, dans leur cadre en bois, que l'instituteur montrait à
chaque nouvelle leçon d'histoire. Celui de la Révolution
française présentait la Prise de la Bastille: canons, fumée,
et têtes au bout de piques. La situation semble avoir été
plus calme dans notre région.
Si, à Echouboulains, le curé se plaignit des tracasseries
de certains bûcherons, il n'a pas pour cela connu l'échafaud,
ce qui fut le cas du curé de St Barthélémy, vers
la Ferté- Gaucher; pas plus que n'eut à souffrir le marquis
de Nangis, M. de Guerchy qui, malgré quelques procès et
dons forcés, aurait conservé château et fortune si
sa manufacture de coton n'avait pas périclité. Les habitants
de Nangis et peut-être de la Chapelle Rablais qui avait fait partie
du marquisat de Nangis, allèrent même en délégation
le sortir des prisons républicaines de Melun où il avait
eu à répondre de l'émigration de sa famille. Personne
ne songea à effacer les armes des anciens seigneurs de Nangis gravées
dans la cour de ce qui est aujourd'hui le café du village: "d'azur
à six bezans d'or". Elles y sont toujours.
Quant au curé, sa présence fut toujours souhaitée: "...Les habitants de la Chapelle Rablais surent bien, au mois de mai 1793, manifester leur volonté à l'égard du culte catholique. Ils consentirent à la répartition, entre eux, d'une somme de 60 livres pour le loyer de la maison occupée par le curé, mais ils refusèrent d'accepter la réunion de leur paroisse à une autre paroisse 2." Ils demandèrent, en termes menaçants, au Directoire du Département, la construction d'un presbytère à leur profit..."3 En 1787, Ponce Péchenard, après avoir racheté 1000 livres sa cure à Nicolas Pailla, son prédécesseur, ne dut pas être dérangé, ayant prêté serment à la Constitution.
Des propriétés changèrent de mains. Les émigrés et le clergé se firent confisquer leurs biens: la famille Sigy perdit un peu moins de 35 hectares; les fabriques 4 des églises de la Chapelle et Fontains se trouvèrent ruinées. La cure gérait environ 60 arpents à la Chapelle. Bien qu'ayant été vendue 9.000 livres tournois à François le Rahier, la ferme de Putemuse, 240 arpents se vit confisquée parce qu' appartenant à Sainte Colombe de Sens.
De cette époque date aussi la nationalisation des "bois de la ci-devant abbaye de Barbeau appelés forêt de Villefermoy" 5 d'une contenance de 2650 arpents, 83 perches soit 1344 hectares; ainsi que ceux de la "ci-devant abbaye de Preuilly appelés bois d'Echoux, situés commune d'Echouboulains" dont le bois d'Echou de 218 hectares et celui de l'Etançon de 49 ha.
1 dans Essais historiques et statistiques sur le Département de Seine et Marne, Michelin 1829, réédition Amattéis 1982
2 Fontains
3 M. Lecomte dans l'Almanach de Seine et Marne 1909 pp 189 à 207
4 la Fabrique d'une église était “Tout ce qui appartient à une église paroissiale, les fonds et les revenus affectés à l'entretien de l'église.../... les marguiliers chargés de l'administration des revenus et des dépenses d'une église” Littré 1863
5 L'abbaye de Villefermoy était une "grange", une annexe, de l'abbaye de Barbeau, sur les bords de la Seine.
Les champs et les bois
Plus de cinq cents ans séparent
les deux périodes que je développe plus longuement dans
ce livret grâce à des documents originaux: le défrichement
moyen-âgeux et le XIX° siècle. Le saut dans le temps
est moins brutal qu'il peut y paraître. Les rapports entre les hommes
ont évolué, les techniques de même; pourtant il me
semble que le dessin des champs des petits propriétaires du XIX°
siècle était déjà tracé au Moyen Age:
on retrouve dans le cadastre napoléonien les parcelles longues
et étroites dues au défrichement puis au mode d'exploitation
des terres:
...Suivons des yeux un laboureur. Ses boeufs
avancent lentement, ses chevaux, s'il est un peu plus riche pour en avoir,
vont un peu plus vite. Mais on dirait que le sillon qu'il trace n'en finit
pas. C'est seulement lorsqu'il arrive à la limite de son territoire
mis en culture, après avoir avancé sur cent mètres
ou même plus, que nous le voyons accomplir, non sans difficulté,
un demi-tour... Son champ est très long mais très étroit;
et puisqu'il n'est bordé par aucune clôture, il n'en connaît
guère la largeur que par le nombre de sillons qu'il a le droit
d'y tracer. Cet extrait de "la vie
quotidienne en l'an mille" ne pourrait-il s'appliquer au travail
du petit paysan neuf siècles plus tard? Notons que le nom de la
ferme de Tourneboeuf peut avoir un rapport avec ce mode de culture.
Un archéologue pourrait certainement, au vu du parcellaire ancien,
retrouver les trois soles correspondant à la rotation des cultures
sur trois ans pratiquée depuis le Moyen Age jusqu'au siècle
dernier: saison des bled: blés d'hiver, Mars: céréales
de printemps et jachères: années où on laissait reposer
la terre.
La plupart des petites parcelles a disparu bien avant le remembrement
de 1966/69 comme sont en train de disparaître les arbres à
cidre, pommiers, poiriers, qui bordaient les chemins. Mais on peut encore
découvrir çà et là les traces d'une autre
habitude de culture:
"En la Brie, où sont les
terres gloizes * et humides, on laboure en talut comme en dos d'âne;
et tient- on entre cinq rayons un scillon plus large, dressé aussi
en talut pour recevoir les eaux, tant de pluye de du dessous du guéret
qui est toujours humide. Et pour ce mesme effet sont au bout des terres
certaines levées assez hautes, où il y a entre ladite levée
et pièce de terre, une fosse faite au propre comme une longue cuve
pour recevoir les eaux qui s'escoulent des grandes pluyes; autrement,
elles pourriraient et suffoqueraient le grain; cela nuyt aux passants
par ce pays: c'est pourquoy l'on nomme les Sautereaux de Brie"
XVII° siècle. Abbé Denis, lectures
sur l'histoire de l'agriculture
* terre gloize, glaise ou glatte: autres noms
de l'argile, d'où dérive le nom de Glatigny qui est sur
un banc de marne.
Parmi les quelque 200 mares qui figurent sur le cadastre ancien, quelques unes avaient encore cette forme allongée à l'extrémité des champs. Il en subsiste encore.
Les archives communales conservent un Registre des renseignements statistiques concernant les productions agricoles de 1857 à 1865. Sa reproduction intégrale serait très intéressante car on y détaille, pour chaque type de produit, le nombre d'hectares cultivés, le rendement, le prix moyen et un jugement sur la qualité de la récolte. Il est dommage que ce registre ne fasse pas la part des productions destinées à la vente et celles réservées à la consommation courante. Nous aurions pu y voir si les petits propriétaires d'alors pouvaient avoir des productions autres que vivrières. Si on écarte les cultures de peu d'extension, les bois et les 48 hectares de prés naturels situés dans les parties basses inondables et donc hors des rotations de cultures, on peut diviser le territoire de la commune en quatre parties d'environ 150 hectares. 140 hectares étaient occupés par les prés artificiels, deux parties étaient réservées aux blés dont l'une de 180 hectares au froment, la dernière partie était en jachère morte, autrement dit la terre reposait sans culture pendant une année ou plus. Le sarrasin n'est pas signalé, alors qu'en 1889, l'instituteur notera qu'il sert d'aliment pour l'élevage de faisans.
Le Registre signale 151 bovins et 970 ovins. A cette époque, 700.000 moutons parcouraient la Brie. Les recensements de conscrits notent 9 bergers sur 140 jeunes gens de la commune. On ne compte, bizarrement, que 25 cochons alors que, traditionnellement, chaque famille engraissait un goret. Le gros bétail devait pâturer dans les près et les moutons, regroupés sous la garde de bergers rétribués par la collectivité, devaient brouter les jachères. Peut- être avait- on encore l'autorisation de pratiquer la "vaine pâture", le droit de faire paître les bêtes sur toute l'étendue du territoire après les récoltes. Le registre signale qu'elle est abolie. En 1840, la pâture fut à l'origine de la révocation du garde champêtre, Simon Petit ...qui, contrairement à ses devoirs avait compromis plusieurs par ses faux rapports en les excitant lui même de faire paître leurs bestiaux dans des lieux non communs ... et avait ensuite verbalisé contre ces personnes. Registre des délibérations
A noter que la betterave à
sucre n'est pas cultivée; la sucrerie de Nangis ne fonctionnera
qu'à partir de 1873. Il est possible que la traction bovine et
les labours profonds nécessités par la culture des betteraves
soient étroitement liés ainsi que le suggérait le
suggérait monsieur Giboux, ancien maréchal-ferrant de Rampillon.
Le Registre Statitique ne mentionne aucun boeuf de même qu'aucun
bouvier n'est cité à cette époque.
L'inventaire en 1918 de la ferme des Montils ignore les boeufs alors que
le catalogue pour la vente des Moyeux vers 1920 montre l'existence d'une
“bouverie pour douze boeufs charolais,
et une vacherie où se trouvent 50 vaches normandes”.
D'où l'interrogation sur la
date de construction du "travail" de maréchal ferrant,
destiné au ferrage des chevaux, mais surtout des boeufs: il suffit
de noter à quelle hauteur se trouve le joug de tête pour
se rendre compte qu'il aurait été inutile au maintien d'un
cheval qui n'a pas besoin d'être entravé, à la différence
du bovin qui doit être maintenu par des sangles. Les plans anciens
n'en portent pas la trace évidente. Il n'est pas mentionné
dans les documents, n'étant à l'époque qu'un outil.
Sa mise en valeur le révèle comme un rare objet du patrimoine
puisqu'il semblerait qu'il n'en subsiste que deux sur le territoire de
la Seine et Marne.
La forêt
Deux villages au centre de deux clairières. Nous sommes revenus, sept cents ans après, à la situation initiale du Moyen Age. Et pourtant, il a été possible de se rendre de la Chapelle à Nangis sans traverser de bois. Leur nouvelle extension est récente et mesurable comme l'indique le graphique des pourcentages par rapport à la superficie totale de la commune, à l'inverse de l'évolution de la superficie du territoire boisé pour la France. ( 80% du territoire était boisé en 3000 avant JC, au 1° siècle: 50%, 17°s: 25%, début 19°s: 15%, actuellement: 26%. dans Duby, histoire de la France)
Il faut se rappeler que, pendant longtemps,
le bois a été le matériau le plus utilisé:
pour le chauffage, évidemment, mais aussi pour la construction
de charpentes et des murs à pans de bois que l'on appelle aussi
colombages, murs fréquemment construits dans les parties les moins
nobles de la maison traditionnelle; on l'utilisait aussi pour les charrettes,
outils, chaussures, bateaux...
Dès la période de la guerre de Cent Ans, des mesures ont
été prises pour l'exploitation rationnelle des futaies;
plus tard, Colbert obligera les communes à réserver intact
le quart des bois, entre autres mesures de protection. Nous en avons la
trace pour la forêt maintenant domaniale sur Coutençon. Ces
mesures de protection avaient pour but de réserver de grands fûts
pour la construction navale: un chêne ne doit être coupé
qu'au bout de 150 ans.
Peut être ces mesures servaient- elles à prévenir des abus: le paysan ne se contentait pas de ramasser des bourrées et son bois d'oeuvre, il y faisait souvent pâturer ses bêtes et coupait des baliveaux qui servaient de fourrage. Cette pratique est attestée par l'autorisation donnée aux paysans en 1893, année de grande sécheresse, de faire pâturer leurs vaches dans la forêt domaniale. En 1860, une demande de Renseignements sur les Redevables du Trésor ne relève pas moins de dix délits dans la forêt de l'Etat.
La comparaison entre la carte de Cassini
datant du milieu du 18° siècle et la carte d'Etat Major de
1889 montre l'extension des bois entre la Chapelle et Fontains, entre
notre commune et celle de Fontenailles.
Sous l'Ancien Régime, on pouvait se rendre dans ces villages sans
traverser de forêts, ce qui n'est bien sûr plus le cas maintenant,
ni à la fin du siècle passé.
Si, de nos jours, les forêts sont sources de loisirs, il y a cent
ans, leur extension a été ressentie tout autrement par la
grande majorité de la population, encore très agricole qui
voyait, dans la réduction progressive des terres labourables, la
perspective du manque d'emplois dans la commune et l'obligation d'aller
chercher un travail d'ouvrier dans une ville.
L'exode rural au cours du XIX° siècle s'est traduit par une
baisse de la population qui est passée de 563 en 1856 à
un minimum de 292 avant la récente création des lotissements.
Le 31 octobre 1789 Les principaux habitants
de la Chapelle Arablay, près de Nangis en Brie, élection
de Montereau, supplient très humblement Messieurs les vénérables
membres de l'assemblée nationale d'écouter favorablement
leur supplique.
Depuis plusieurs années, différents propriétaires
de biens dépendant de notre paroisse laissent volontairement la
plus grande partie de leurs terres en friches et d'autres propriétaires
font planter une grande partie en bois. Comme une telle conduite est très
répréhensible, vu qu'elle est très préjudiciable
au bien général et qu'elle fait éprouver des torts
réels et des pertes sensibles à notre paroisse, les-dits
habitants osent supplier très instamment vos augustes personnes
d'interposer leur authorité et ordonner aux propriétaires
des biens dépendant de la Chapelle Arablay, de les faire valoir
où de les louer à un prix raisonnable et de leur défendre
expressément de faire planter leurs terres en bois, et vous ferez
justice.
Rousseau, sindic; Cavillieu, Denis Toussaint Félix, Vourrel, Henri
Denis Félix, Lémaignan.
Malgré l'opposition des petits exploitants, les terres cultivées ont été replantées en bois par les gros propriétaires. Les châteaux (les Moyeux, Champ Brûlé, Bois Boudran..) n'étaient que les résidences campagnardes de ces riches aristocrates. Elles étaient destinées au plaisir de la chasse .
Malgré l'opposition des petits exploitants, les terres cultivées ont été replantées en bois par les gros propriétaires. Les châteaux (les Moyeux, Champ Brûlé, Bois Boudran..) n'étaient que les résidences campagnardes de ces riches aristocrates. Elles étaient destinées au plaisir de la chasse . Ils ont préféré étendre leur domaine giboyeux plutôt que de cultiver des terres d'une rentabilité moyenne: elles sont trop humides et nécessitent de gros frais de drainage; de plus, avant la myxomatose, les invasions de lapins réduisaient encore les rendements.
Situé au centre d'une région
de grandes et belles chasses giboyeuses, les Moyeux est une des plus remarquables
entre toutes. On tuait et on tue chaque année: 4.000 lapins de
garenne, 1.000 faisans, 250 lièvres, 600 perdreaux, 50 chevreuils,
des cerfs et des sangliers.
Le domaine est doté à cet effet d'une organisation bien
comprise: centres d'élevage de gibier, de repeuplement et postes
de garde. Le principal élevage, la faisanderie, est située
à proximité du château, juste à la limite du
parc...
Un des avantages de la chasse des Moyeux réside dans le fait qu'elle
n'est pas isolée. Le domaine s'encastre en effet au milieu d'autres
domaines giboyeux. Voulez-vous connaître ces voisinages, en partant
du nord pour faire le vaste tour du propriétaire? La propriété
de Mme Chennevières; les Brûlis à M. Berseon, le domaine
des Bordes à M. Dutey Harispe, le domaine de Cotanson à
M. de Cernay, la forêt domaniale de St Germain Laval, les terres
de la ferme des Gargots à M. Touchart, la forêt domaniale
de Villefermoy, la propriété de M. Emile Tancelin, la propriété
de M. Le baron Hottinger. Non loin aussi est la célèbre
chasse de Bois Boudran.
Ainsi était décrite la chasse des Moyeux dans le catalogue
d'une vingtaine de pages pour sa vente, vers 1920.
(Sur la carte de la page précédente,
on devine la part qui restait aux paysans du village. Le plan des petites
parcelles qui ouvre le chapitre consacré aux temps modernes s'encastre
presque parfaitement dans les blancs.) Denis Toussaint Félix, maire
de la commune et figurant parmi les plus imposés ne possédait
que les champs disséminées qui figurent sur la carte. Les
riches se partageaient la plus grande partie des bonnes terres, tous les
bois, négligeant les fonds de rus trop humides. Ils avaient la
possibilité d'utiliser les machines modernes que le comte Greffulhe
préconisait et dont il organisait, à Bois Boudran, des expositions
et démonstrations.
Les Moyeux, dont le domaine atteindra plus de 1.000 hectares possédaient
2 charrues butteuses,5 charrues araires, 5 brabants, 8 jeux de herses
en fer, 2 croskill, 6 rouleaux, 2 distributeur d'engrais, 6 semoirs,6
faucheuses en vert, 3 faneuses à râteaux, 5 moisson-neuses
lieuses, 1 batteuse botte- leuse électrique... 30 chevaux et 12
boeufs charolais...
"Considérant que plusieurs gardes de M. Greffulhe font journellement sur les chemins de la commune et auprès des habitations, au moyen de cors et de fouets, un tapage assourdissant de nature à nuire à la tranquillité publique... il est expressément interdit ... aux gardes de M. Greffulhe et à tous autres qui seraient tentés de les imiter, de faire, soit de jour soit de nuit ... aucun tapage qui soit de nature à occasionner des accidents ou à troubler le repos et la tranquillité publiques."
Dans la première édition des documents sur la commune, je n'avais pas donné d'importance à cet extrait du registre des arrêtés du maire de 1886, pensant qu'il ne s'agissait là que de joyeux fêtards. La découverte, grâce à une férue d'histoire locale, des articles du Père Gérôme, lève le voile sur ce texte administratif. Le comte Greffulhe, dont l'épouse, la princesse Caraman-Chimay servit de modèle à Marcel Proust pour Madame de Guermantes, partisan des méthodes d'exploitation agricoles modernes, député de Melun, se révèle étrangement féodal dans ses relations avec le menu peuple qui habite ses domaines et les alentours.
"Vous plairait-il, ce matin, de venir faire un tour de chasse? me demande-t'on. (Des paysans de Glatigny) On décroche les fusils, on siffle Duchesse, une jeune chienne, et l'on part... (sur une parcelle appartenant aux fermiers) Mais voici que tout à coup, sort d'une hutte et accourt au grand trot, un garçon de ferme armé d'un fouet et qui, bien avant que nous y soyons arrivés, fait le tour de notre pièce en claquant à coup répétés. Une volée de perdreaux se lève... Nous nous dirigeons vers une autre pièce et d'aussi loin que nous apparaissons, voilà le même manège qui recommence: un autre garçon sort d'une hutte et bien vite fait le tour de la pièce en claquant son fouet comme s'il conduisait un troupeau de deux cents vaches à l'abreuvoir. Et mes deux amis m'expliquèrent que chacune de leurs pièces de terre était ainsi gardée par un homme qui, de toute la sacro-sainte journée, n'avait que cette besogne: chasser le gibier des pièces où il se pose, aussitôt que le propriétaire arrive pour le tirer... Le bien des petits cultivateurs est fait pour être mangé par le gibier de monsieur le comte, mais le gibier de M. le comte ne doit être tué que par lui seul." Extraits d'articles du journal le Briard, 1892, signés le père Gérôme, de Glatigny
Le conseil municipal a essayé
de s'opposer aux abus du comte Greffulhe qui ne possédait que peu
de terres sur le Chapelle. Mais comment résister au châtelain
des Moyeux?
Certains furent bienveillants comme M. Debrousse, fondateur de l'hospice
qui porte son nom ou Mme Rigaud qui dota les jeunes mariées, releva
la chapelle et les croix des carrefours; d'autres se révélèrent
bien mesquins comme celui qui consentit à payer une partie de la
pompe à incendie à la condition qu'elle reste au château...
![]() Voir le chapitre : la Chapelle Rablais dans la Capitainerie de Fontainebleau
Voir le chapitre : la Chapelle Rablais dans la Capitainerie de Fontainebleau
Les chemins
..."Parmi les hautes et puissantes
considérations qui déterminent les membres du Conseil Municipal
à voter la confection prompte et urgente dudit chemin, c'est l'état
affreux des chemins qui conduisent à Nangis et à Fontainebleau
et qui paralysent l'industrie agricole et commerciale; une route de grande
communication sortirait de la misère et de la détresse un
climat tout entier, un canton de la Brie qui, jusqu'à présent
a été oublié et qui cependant mérite toute
la protection de l'administration.
Les terres ne demandent que de bons chemins pour s'enrichir des engrais
des villes; la carrière de grès des Montils et de la Chapelle
Rablais, les superbes et précieuses forêts de Villefermoy
appartenant à la liste civile s'exploitent difficilement à
défaut de chemins praticables, celui projeté doit leur donner
une nouvelle vie et une double valeur; les vignobles de Machault et de
Féricy et du Gâtinais verront avec le plus grand intérêt
s'ouvrir un nouveau débouché pour leurs vins; en un mot,
les pays traversés par la route de grande communication verront
s'accroître leur prospérité et les villes de Nangis
et de Fontainebleau gagneront considérablement à cette nouvelle
voie qui les alimentera de céréales, de bois et des produits
des autres climats.
Qu'il plaise à l'administration, au conseil d'arrondissement et
au conseil général de jeter un coup d'oeil sur la carte
du département, ils verront partout des routes départementales,
des chemins de grandes communications traverser de riches contrées
et dont nous avons contribué de nos centimes à leur confection;
aujourd'hui, nous réclamons à notre tour, il est temps de
s'occuper d'une contrée du Département qui ne demande que
justice et protection pour sortir de cette triste position...
fait et arrêté en séance le
8 juillet 1838 et ont tous les membres signé à l'exception
du sieur Enguerrant qui a déclaré le ne savoir.
La création de chemins praticables a été au centre des préoccupations de la Municipalité à partir de 1835. Des routes au tracé rectiligne ont été créées pour remplacer ces chemins qui laissaient les chartiers en souffrance par les obstacles qu'éprouve la libre circulation pendant les trois quarts de l'année. Essayez de suivre le trajet de l'époque pour vous rendre à Nangis; le chemin existe encore, il passe entre la ferme des Moulineaux et les premières maisons du village. Imaginez l'emprunter en hiver, parmi les ornières avec une charrette lourdement chargée! Une patache a peut- être desservi quelques villages avoisinants, mais aucune diligence n'a jamais dû s'aventurer sur ces chemins défoncés. Les relais de Poste sont bien connus et ne jalonnent que les grandes voies; sur la route Paris Bâle: Guignes, Mormant, Nangis, Maison Rouge, Provins....
![]() Voir la page sur les chemins du dossier "Thiérachiens"
Voir la page sur les chemins du dossier "Thiérachiens"
Les passeports pour l'intérieur
Quelques Passeports pour l'Intérieur sont conservés dans les archives de la mairie. Il s'agit de sortes de cartes d'identité que devaient présenter ceux qui avaient à voyager, du marchand de sangsues, au curé de la paroisse allant visiter son village natal ou au comte Just Faÿ Latour Maubourg se rendant à Paris.
![]() Qu'est-ce qu'un passeport?
Qu'est-ce qu'un passeport?
![]() Voir le chapitre sur les passeports
Voir le chapitre sur les passeports
Les maisons
Le village, s'il était à la frontière de deux provinces au Moyen Age, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, se trouve aussi à la limite entre deux styles de construction traditionnelle, la séparation étant Nord/Sud. Un peu plus au midi, vers Echouboulains, on trouve en grand nombre de petites maisons à nervures de briques 1. Plus au nord, les arêtes sont en grès. Une promenade dans le village permet de rencontrer autant de grès que de brique. Peut- être ce dernier mode de construction correspond-il plus au style de la fin du siècle passé: s'il fallait faire quelques kilomètres pour trouver des briqueteries 2, le grès s'extrayait directement dans la commune. Les constructeurs traditionnels, s'ils avaient pour eux le temps, évitaient les longs transports sur des chemins boueux.
Comme maintenant, les maisons étaient
construites en fonction des fortunes. Les plus pauvres devaient être
les vieilles gens; quelques toutes petites maisons ont dû être
construites à l'intention de ceux qui ne pouvaient plus habiter
chez leurs enfants; on les appelle des “maisons de vieux”.
L'ouvrier agricole habitait dans une "bricole", telle celle
qui fait l'angle, face à l'église prévue pour deux
manouvriers.
Un peu plus riche, on faisait construire une maison à étage,
pignon sur rue ou sur cour, comme on trouve au centre du village où
les fermes à cour carrée ont peu à peu disparu avant
la guerre de 1914, comme celle qui a laissé la place au café
actuel.
La fin du siècle passé nous a laissé quelques "belles
maisons" dans un style que l'on retrouve aussi bien à Deauville
qu'à Arcachon, construites par l'ancêtre du maçon
actuel.
Elles se distinguent d'autant mieux des maisons traditionnelles qui les
entourent qu'on les a le plus souvent couvertes d'ardoise. Le clocher
de l'église, reconstruit en 1859 a lui aussi droit à cette
distinction.
Les écoles (1874 pour le chef- lieu, 1882 pour le hameau) ressemblent
à toutes les écoles construites à cette époque,
dans le même style fin du XIX°. Les habitants de Montils, certainement
jaloux de ceux du chef- lieu qui, bien que moins nombreux à l'époque,
avaient la mairie et une école en trois travées, ont dû
compenser ce manque d'honneur par l'érection d'un clocheton supplémentaire.
Non compris au devis, il en coûta 1.120,61 francs de plus.
Pour découvrir les plus belles demeures, il faut sortir du village...
1 c'est à dire que les lignes architecturales à renforcer: angles, ouvertures, étages, sont constituées de briques, les intervalles étant maçonnés avec la pierre locale, ici de la meulière jointoyée différemment suivant l'importance du pan de mur: recouverte de "plâtre gros" ou d'enduit chaulé lissé pour les façades, laissée à "pierres vues" pour les parties moins prestigieuses du bâtiment.
2 à St Ouen, lieu dit la Tuillerie en allant vers Lady; voir la carte de Cassini.
3 par exemple le café actuel est l'un des bâtiments d'une ferme transformée en 1914
Les Moyeux
Construite à l'écart
des maisons paysannes, on trouve toutes les lieues environ, une résidence
campagnarde, un château: Bois Boudran, Champ Brûlé,
les Moyeux, la Vénerie, les Bordes. Des rendez- vous de chasse
sont aménagés, comme aux Clos ou la villa Putois, la ferme
des Moulineaux. La plupart des châteaux ont été reconstruits
au siècle dernier. Les Moyeux, au milieu de la clairière,
d'où son nom, doit son aspect actuel, non au comte Latour Maubourg,
mais à son successeur, M. Lemaire Marie Claude qui fit abattre
en 1849 la maison cadastrée C 17 taxée à 200 francs
de revenu pour faire édifier en 1852 un château rapportant
450 francs de revenu à la Commune, matrice cadastrale
C'est maintenant un château tout blanc, du
temps de Louis Philippe, qui se dresse sur la douce inclinaison d'une
pente boisée, dans l'encadrement d'alignements de grands arbres
et de futaies, précédé de parterres à la française.
De tous côtés s'ouvrent de grandes échappées
sur la plaine d'où le regard embrase ici des paddocks, là
les vastes champs où les attelages assurent le productif labeur
de la terre. A l'image des domaines des gentilshommes du XVIII° siècle,
prairies et cultures se joignent harmonieusement jusqu'aux abords de la
demeure, ajoutant l'intérêt, l'action et la vie d'une exploitation
de culture et d'élevage et d'une chasse giboyeuse, à l'adorable
tableau des architectures de verdures et de fleurs. Ainsi s'ouvrait
le livret d'une vingtaine de pages édité pour la vente de
la propriété vers 1920. Y sont longuement
décrits les vingt cinq hectares de parc, l'orangerie, les serres,
le haras, la ferme de Toumeboeuf et les belles et grandes chasses.
A. Maumené Les Moyeux, prêt Amatteis
Il existe peu de documents sur
le château des Moyeux, on pourrait retrouver la liste de ses occupants
en dépouillant les Pouillés où l'on trouve
Les Moyeux, paroisse de la Chapelle Rablais, chapelle
domestique dans le château qui appartenait à M. de la Brière
inscriptions du diocèse de Sens,
ou les Terriers comme: Roole des nobles demourant
en dedans des terres dépendant du marquisat de Nangis... le dixième
jour defebvrier, l'an mil cinq cent soixante et dix neuf: ...le sieur
Damours demeurant en son fief, terre et seigneurie de la Borde des Montilz,
en la paroisse de la Chapelle d'Arablay. E.
Chauvet.
Les châtelains, depuis la Restauration,
ont souvent été maires: Just
Fay Latour Maubourg, né à la Motte Drôme le 8 juin
1774, officier et aide de camp, chevalier de Malte, lieutenant des gardes
du corps, campagne de Luxembourg... armes: de gueules à bande d'or
chargée d'une fouine d'azur, notes
biographiques, manuscrites, Archives 77
propriétaire à Courpalay et la Chapelle Rablais fut nommé
maire par le préfet en 1830 jusqu'en 1835. Messieurs Lemaire, Debrousse,
Rigaud, le furent aussi.
On trouvera plus facilement la trace des hommes que des bâtiments,
cependant, on peut avoir une petite idée de l'aspect du château
d'après le plan d'Intendance. Il existe, au château un immense
plan des terres qui avait été prêté pour l'exposition
des archives de la commune en 1984.
En 1823, l'instruction était
donnée aux enfants dans une maison particulière louée
à cet effet. Cette maison qui existe encore actuellement, mais qui
a subi des restaurations et des transformations assez importantes est située
derrière l'église; elle ne comprenait alors qu'une seule pièce
servant à la fois d'école, de cuisine, de salle à manger
et de chambre à coucher.
La seconde habitation affectée à l'enseignement se voit
encore aujourd'hui à peu près telle qu'elle existait autrefois,
dans la partie orientale du village. Elle était composée
de deux pièces, l'une, la chambre à coucher, l'autre, l'école,
la cuisine et la salle à manger. Ce bâtiment constituait
aussi une propriété particulière louée à
la commune pour y recevoir ensemble les garçons et les filles.
Le troisième local appartenait à monsieur Félix.
Il s'élevait sur l'emplacement de la maison commune actuelle. Cette
fois, la classe et le logement de l'instituteur étaient séparés.
monographie de l'instituteur, M. Martin, 1889
Les lois Guizot obligeaient les communes de plus de cinq cents habitants
à entretenir une maison d'école. Celle qui fut achetée
était une maison couverte de tuile,
sise au lieu de la Chapelle- Rablais, contenant deux travées de
bas logis, l'une servant de chauffoir où il y a four et cheminée,
grenier au dessus, l'autre servant de grange, une petite laiterie en appentis
au couchant.. L'école servit aussi
de salle de réunion pour la mairie et de salle des ventes pour
le notaire. La propriété fut agrandie par l'achat de la
maison de l'instituteur Gasc qui partait en retraite.
Composée de deux chambres à feu,
une autre chambre servait de boucherie, un cellier, une grange y attenant,
un cour, un puits, et la cour entourée de murs, le tout couvert
de tuiles, pour servir de maison d'école et de logement pour l'instituteur
. On peut imaginer la vie quotidienne dans
cette petite “bricole”, entre le four à pain niché
dans la cheminée, les rares pièces à feu et les appentis
rajoutés ça et là.
Le salaire du maître d'école était en partie versé
par les familles par la contribution scolaire: un élève
apprenant à lire versait 0,75 francs par mois, calcul et lecture
se payaient un franc; 1,25 F pour les plus grands. La part des enfants
de familles indigentes et le complément pour un salaire presque
décent était versé par la commune qui trouvait là
un moyen de pression considérable sur les instituteurs. Deux au
moins furent contraints de quitter la commune parce qu'ils avaient cessé
de plaire.
La nécessité d'une
nouvelle construction se fit sentir en 1866 . Des projets virent le jour
qui ne purent être réalisés à cause de la guerre
de 1870; non que la commune ait connu d'autres atrocités que la
réquisition d'une vache et d'autres fournitures, mais le paiement
des indemnités de guerre mit à sec le budget communal pendant
au moins deux années. Le 16 octobre 1870, on discute de la
répartition à faire de la somme de
164.737 francs qui tombe sur l'arrondissement de Provins, qui est engagé,
pour éviter des représailles, à payer sa portion
dans le délai de six jours. La commune
paya alors 1.359,60 francs. Le 8 janvier 1871, le département étant
imposé pour un million, la part de la commune s'élèvera
à 3.134 francs. Après avoir hésité entre la
restauration des deux petites maisons existantes et la construction sur
le même emplacement d'un bâtiment neuf, le projet se concrétisa
enfin en 1874. Le mobilier fut acheté en 1875; il s'agissait alors
de six longues tables par classe, chacune mesurant 3,60 mètres.
Le système de chauffage fut payé par le comte Greffulhe
de Bois Boudran, partisan de l'éducation populaire: il avait fondé
l'école d'enseignement mutuel de Nangis et possédait du
matériel agricole moderne de démonstration à la ferme
de son château. Garçons et filles occupaient des classes
et des cours de récréation différentes. La classe
actuelle était celle des garçons. Les fillettes avaient
droit à des cours de couture dispensés par des maîtresses
spécialisées; les petits garçons ont échappé
en 1907 à une société scolaire de tir, refusée
par la Mairie. C'était l'époque où les élèves
maniaient des armes en bois et apprenaient à nager sur des tabourets.
L'aspect probable de la classe des filles est donné par plusieurs
textes étrangement semblables, des rédactions du cours de
"style" conservées, avec d'autres devoirs, dans de gros
cahiers appelés cahiers de roulement. Quelques années avant
les lois laïques de Jules Ferry, voici comment était décrite
la classe des filles (actuellement, salle de réunions de la Mairie)
Georgina Michaut, école de filles
de la Chapelle Rablais, le 17 octobre 1877.
Nous entrons à l'école avant l'arrivée de notre maîtresse.
Faisons un petit voyage autour de l'école. Le premier objet qui
frappe la vue, c'est le Christ, au dessous, c'est le tableau noir muni
des exemples que nous aurons à suivre pendant la journée;
il est déjà rempli ce qui nous prouve qu'une main active
l'a préparé dès le matin. Au dessous, c'est le bureau
de notre maîtresse; que de paroles encourageantes elle nous dit
en un jour! ... A gauche du bureau est le calendrier, ensuite, le tableau
de répartition trimestrielle des matières de l'enseignement
plus loin est l'emploi du temps. Sur la façade du midi est l'horloge,
dessous la carte de France. Que j'aime voyager à l'aide de cette
carte! Au dessous est le tableau noir. Pauvre tableau, que de pleurs tu
m'as fait verser! Dans l'angle se trouve le poêle... Sur le mur
du levant se trouve la carte de la mappemonde, au dessous le tableau noir,
plus loin est la carte de l'Europe. Sur la partie Nord est la carte de
la Palestine, puis la carte du département... Sur la partie du
couchant est la carte du canton de Nangis à côté est
la statue de la Sainte Vierge. Qui se met sous ton pieux asile ne faillira
pas! Au dessous de cette statue est le tableau d'honneur. Que mes parents
sont heureux quand ils savent que mon nom y est inscrit! Mais chut! Voilà
notre maîtresse. Silence!
La création au chef-lieu
d'une école à deux classes fut un mauvais calcul. Elles
ne fonctionnèrent simultanément que pendant huit ans. Dès
1881, les parents d'élèves des Montils exigèrent
une école pour leurs enfants qui étaient obligés
de faire plusieurs kilomètres à pieds pour se rendre en
classe. Une école leur fut construite en 1883. A cette date, on
ferma donc la deuxième classe de la Chapelle qui fut louée
ensuite, puis laissée à l'usage du garde- champêtre.
La mixité n'étant pas de coutume, la classe des Montils
avait été prévue pour que garçons et filles
ne se côtoient pas: une cloison à mi- niveau séparait
la classe en deux, à partir de l'estrade magistrale. Un bon- point
doit être décerné à la municipalité
de la fin du siècle dernier. Bien que le budget n'ait jamais été
copieux, les conseillers décidèrent, en opposition avec
la préfecture, la gratuité scolaire dès 1877; Jules
Ferry n'imposa cette obligation aux communes qu'à partir de 1881.
Les membres du Conseil s'engageaient même à en payer les
frais de leurs propres deniers si l'autorisation de s'imposer de cette
somme ne leur était pas donnée. Je pense qu'il faut comprendre
par là que M. Debrousse, maire et propriétaire des Moyeux,
s'engageait à assumer cette dépense; ce châtelain
bienveillant légua son château à l'Assistance Publique.
Comme dans toutes les écoles rurales, la fréquentation des
classes dépendait grandement des travaux des champs. Quelques cahiers
d'appel des années 1910 montrent la désertion progressive
des enfants jusqu'à ce que l'instituteur écrive que l'école
a cessé, faute d'élèves; en novembre, après
les semailles, des enfants doivent “garder les corbeaux”,
avec des crécelles ou des tic-toc-maillets, ils étaient
chargés d' effrayer, pendant tout le mois, les oiseaux picoreurs.
Considérant que les travaux de la moisson
ne commencent guère dans la commune que dans les premiers jours
du mois d'août et se continuent jusqu'à la fin de ce mois...
les familles seraient privées de leurs enfants au moment où
elles en auraient le plus besoin et où elles ne pourraient s'occuper
de leur entretien.
Ouvertures et fermetures de classes
se succédèrent suivant les fluctuations de la population.
Un accroissement du nombre d'élèves et le désir de
scolariser les enfants de quatre ans nécessita la création
d'une seconde classe aux Montils, dans la salle à manger du logement
de fonction; la classe des filles de la Chapelle- Rablais ayant été
louée. En 1959, on ouvrit à nouveau la seconde classe de
la Chapelle- Rablais qui fut encore fermée en 1963. Il n'y eut
plus de classe ouverte au village à partir de 1970: les élèves
étaient conduits aux Montils par M. Beusart; ils n'étaient
plus que neuf !
La situation s'est inversée en 74/75 quand fut créé
le Syndicat Pédagogique de Villefermoy qui accueille actuellement
(1997) en douze classes les élèves de trois villages: la
Chapelle, Fontenailles et St Ouen. Cette création, due à
une inversion du mouvement démographique, permit entre autres améliorations,
la création d'une école maternelle. Mais les jeunes parents
qui acquirent une maison en lotissement envoient maintenant leurs enfants
au collège ou au lycée. Les effectifs scolaires baissent
et des classes commencent à se fermer.
L'église devait être
au centre des préoccupations d'une commune déclarant 556
catholiques romains sur 557 habitants au recensement de 1851. L'exception
étant un Anglais résidant au château des Moyeux. Le
Registre Paroissial tenu par le curé, transcrivant baptêmes,
bénédictions nuptiales et inhumations est le calque presque
parfait de l'Etat Civil enregistré à la Mairie. Pourtant,
les archives révèlent des moments de friction, pour des
motifs bassement matériels: la commune a toujours été
pauvre. Vers 1830, il lui est demandé de participer à la
création des nouvelles routes; les lois Guizot lui imposent l'entretien
d'une école qui existait peut-être déjà mais
n'apparaissait pas au budget. En mars 1841, le curé Ozouf décède.
Il possédait personnellement le presbytère (qu'il avait
peut être racheté à son prédécesseur
Ponce Péchenard, lequel avait repris le bénéfice
de la Cure à Nicolas Pailla contre 1.000 livres de pension en 1787;
le presbytère ne figure pas dans les biens nationaux confisqués
sous la Révolution). Ce devait être la plus belle maison
du village, la seule de première catégorie, comportant dix
neuf portes et fenêtres, dépendances, granges et colombier;
hélas, dans un triste état.
En mars, les membres du Conseil et les plus imposés de la commune
avaient voté: dix neuf voix contre huit se sont prononcées
contre l'acquisition du presbytère. Le dix sept avril, se présente
le nouveau curé desservant accompagné du Doyen de Nangis
pour exercer son ministère dans notre commune,
et procéder à son installation pour autant que la commune
aura à lui présenter un logement décent et convenable
pour un prêtre. Le Conseil Municipal
et les membres du Conseil de la Fabrique ont consenti
à l'acquisition du dit ancien presbytère à l'exception
de la grange couverte en paille. Ce qui
sera fait l'année suivante pour la somme de 4.000 francs. Le maire
d'alors s'était empressé, sans autorisation du conseil municipal,
et sans demander avis, à faire faire les réparations les
plus urgentes afin d'installer monsieur le Curé. S'ensuivent quelques
années où on sent l'animosité et la mesquinerie,
les menaces de procès, les chicaneries pour des bouts de terrain,
des réunions de conseil qui ne peuvent avoir lieu, faute de quorum.
Depuis que le presbytère était
en ruines, la commune était privée d'ecclésiastique;
pour ne pas priver la commune du secours de la religion, Monseigneur l'Evêque
avait donné des ordres à M. le Curé de Fontenailles
pour desservir la commune en attendant le rétablissement du presbytère
mais ces travaux n'ayant pu se terminer aussi promptement que l'on aurait
désiré, Monseigneur a retiré le pouvoir à
M. le Curé de Fontenailles ne l'autorisant qu'à y faire
des inhumations et autres simples cérémonies de la religion
avec défense de dire la messe le dimanche. En représailles,
la commune décide qu'il n'est pas non plus juste que M. le Curé
profite des revenus du jardin et des enclos du presbytère.
On s'empresse donc de les louer à un particulier. Du mois de septembre
1845 jusqu'au mois de novembre 1850, il n'y a pas de curé.
Le presbytère fut rasé,
quelques parcelles vendues ou distraites sans droit par le sieur Lepanot,
d'ailleurs mari de la nièce du curé Ozouf, le bâtiment
actuel fut construit en 1883. Il ne fut jamais attribué à
un prêtre, bien que celui de Fontains l'ait demandé en 1902,
mais loué puis revendu à un particulier en 1934.
Après la mort de Jean Jacques Ozouf, dernier propriétaire
du presbytère, le curé desservant fut, entre 1841 et 1845
celui de Fontenailles.
A la fin du XIX° siècle, les almanachs indiquent que la
paroisse est desservie par le curé de Fontains, comme binage, et
fait partie du doyenné de Nangis, diocèse de Meaux, depuis
1790. elle était naguère une cure conférée
par l'archevêque de Sens, valant au XVIII° siècle 1.800
livres de revenu... Le curé de cette paroisse, capella de Erableyo,
était taxé à 105 sols, mais il ne put payer cette
petite somme à cause de sa pauvreté et on l'exempta.
Almanach de Seine et Marne 1909
Le curé Emile Mavré accompagna les soldats durant la guerre
de 1914-18, retourna au village jusqu'en 1922. Le curé Gille est
installé à la Chapelle Rablais et reste jusqu'au mois de
juillet 1928. Il aurait occupé une petite maison sur la chemin
de la mare à la Canne. Ensuite, le curé Laurain de Fontenailles
et ses successeurs s'occupent de la Chapelle Rablais. liste
établie par M. le curé Juffermans de Fontenailles
![]() Voir le chapitre : bio d'Etienne Fare Charles Huvier, curé de la
Chapelle Rablais de 1752 à 1759
Voir le chapitre : bio d'Etienne Fare Charles Huvier, curé de la
Chapelle Rablais de 1752 à 1759
Le Conseil Municipal de ladite commune
ayant reconnu l'urgente nécessité de faire réparer, le
clocher de l'église de cette commune, elle même dans sa voûte
et sa couverture et autres parties d'icelle, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, comme aussi à la sacristie, après
avoir fait un devis estimatif des réparations à faire à
ladite église par un homme de l'art, lequel devis se monte à
la somme de deux cent quarante neuf francs. Procès
verbal des délibérations prises par le Conseil Municipal, session
de 1817 pour 1818
L'église ne fut réparée que
quarante ans plus tard, le devis s'éleva alors à 17.306,99
francs, rabaissé par l'abandon d'une horloge. Entre temps, l'église
était devenue tellement dangereuse qu'elle fut délaissée
en 1854: à la fin du registre paroissial de cette année,
on trouve: Liste des enfants qui ont fait
leur première communion dans l'Eglise de Fontains, l'Eglise de
le Chapelle Rablais étant dans un état de ruine; depuis
45 ans cette cérémonie n'avait pas eu lieu à Fontains.
Il s'agit d'ailleurs de la seule annotation autre que baptêmes,
bénédictions nuptiales et inhumations en cinquante ans sur
les registres tenus par le prêtre. Même l'épidémie
de choléra qui fit plus de trente morts pendant l'été
1832 n'a pas provoqué de commentaires.
Le clocher fut rénové en 1859. On aurait pu penser que sa
flèche avait été ajoutée; et que le clocher
aurait pu ressembler à celui à quatre pignons de Saint Ouen,
type fréquent en Brie, mais plusieurs actes de 1754, concernant
des travaux urgents à l'église, montrent qu'il avait déjà
sa forme actuelle, en bien mauvais état. En 1911, l'érudit
(constesté) Maurice Pignard-Peguet note:
la base du clocher forme porche, à la façon des constructions
du XII° et XIII° siècles. L'entrée en est défendue
par une grille. Les travaux de 1754 notent,
au contraire, l 'absence d'un tel porche où auraient pu se tenir
les assemblées des habitants, au sortir de la messe.
Il fallut rénover les vitraux et les boiseries du choeur, travaux
non prévus au devis, qui eurent lieu en 1862. Pour les financer,
on vendit un peu de tout: les anciens bois de charpente, les peupliers
entourant les croix, les fagots des chemins, même la boue de la
mare ! Les travaux à la sacristie commencèrent en 1877;
la chapelle fut abattue pour être relevée en 1904 par la
châtelaine, Mme Rigaud. Il est probable que la statuaire date de
cette époque, relevant du style Saint Sulpicien. Seuls un tableau,
l'autel et une armoire en triste état semblent plus anciens. La
cloche, marquée Louise bénite
en 1789 est, en fait, la plus récente
des cloches du canton, ayant été refondue en 1953.
Si, vers le milieu du XIX°
siècle, l'église tombait en ruines, il en était de
même du presbytère, de la maison d'école qui nécessitait
des travaux et même du cimetière dont le mur était
en piteux état: Je suis informé
de l'insalubrité du local affecté à l'école
de votre commune. La cause de cette insalubrité est attribuée:
1/ aux eaux stagnantes et à la boue qui se trouvent devant la porte
de l'école.
2/ à la grande humidité des murs et du peu d'élévation
du solivage de l'école
3/ et à l'exhaussement du sol du cimetière par rapport à
celui de la maison d'école. On m'a signalé également
le mauvais état de la clôture du cimetière où
s'introduisent, sans difficultés, les bestiaux et le volailles.
lettre du préfet 1872
Car le cimetière était au centre du village, comme dans
la plupart des communes rurales. Dans la maquette réalisée
par les élèves, ils se sont empressés de coller,
dans l'allée du cimetière,un petit cochon poursuivi par
un paysan en colère; on y voit aussi le maréchal ferrant
Guérin qui ne possédait que la petite maison près
du "travail à ferrer"; le charron Adrien Toussaint Félix
qui œuvrait près de la mare, le maître Gasc qui attend
ses élèves, la veuve Bony dans sa petite maison derrière
l'église. On aurait pu y mettre les trois cabarets trop proches
de l'école, au goût du préfet: Les
enfants qui fréquentent l'école communale ne peuvent arriver
en classe sans passer devant les cabarets qui avoisinent la maison d'école.
lettre du préfet 1851
La rue devait être encombrée de tas de fumier, de fagots,
de roues de charrons, peuplée de bestiaux allant pâturer,
d'oies en promenade puisque plusieurs arrêtés du Maire essaient
d'y mettre bon ordre. L'aspect de la place du village a dû bien
changer quand le cimetière fut transféré sur une
parcelle donnée par M. Lesourt, propriétaire des Moulineaux.
Considérant que la translation de l'ancien
cimetière sur un autre point de la commune s'est faite en 1868
et que la dernière inhumation dans l'ancien cimetière date
du premier juin 1868 et que dès lors il n'y a plus eu d'autres
sépultures,la première inhumation dans le nouveau datant
du 4 août 1868 et que dès lors il y a lieu de pourvoir à
destination de l'ancien terrain; arrête: article 1: A partir du
jour de la publication du présent arrêté, les propriétaires
de monuments funèbres existant sur l'ancien cimetière ..
sont invités à les retirer de leurs places respectives avant
le premier juin 1873. registre des arrêtés
du Maire 1872
![]() Voir le chapitre : bio d'Etienne Fare Charles Huvier, curé de la
Chapelle Rablais de 1752 à 1759
Voir le chapitre : bio d'Etienne Fare Charles Huvier, curé de la
Chapelle Rablais de 1752 à 1759
Les métiers au XIX° siècle
Les archives font découvrir les transformations du village: les maisons, les routes, les terres, les bois... Elles permettent aussi d'approcher les habitants de la commune, les hommes et les femmes qui y sont nés puis morts. A compulser ces vieux papiers, on acquiert une certaine familiarité avec quelques uns de ces personnages: ceux qui ont été assez influents pour siéger au Conseil municipal, ceux qui ont été assez malchanceux pour entrer en litige avec l'administration... leur nom peut revenir fréquemment. Ceux qui possédaient leur maison ou des terres figurent aussi sur les matrices cadastrales. Les autres auraient pu traverser le siècle sans laisser d'autre trace que sur les registres d'état civil. Avec les élèves, nous avons retrouvé les nombreuses traces de l'un des anciens maires, Denis Toussaint Félix propriétaire de la petite maison qui a servi d'école.
Tous les jeunes gens de vingt ans figurent
sur les listes de conscrits; certains malchanceux partiront à l'armée
pour six ans parce qu'ils auront tiré le mauvais numéro
et que leurs parents n'auront pas été assez riches pour
leur payer un remplaçant.
On peut connaître leurs noms, familles, défauts physiques,
degré d'instruction, à partir des lois Guizot et leurs métiers
ainsi que ceux de leurs pères. Sur 140 inscrits, de la classe de
l'an 7 de la République à celle de 1832, il n'en est qu'un
seul qui ne travaille pas de ses mains: il était clerc de notaire
chez son père, il attendait encore, en 1857, les honoraires que
la Commune, souvent mauvaise payeuse, devait à son père
depuis 1839.
Quel était le métier
d'un jeune homme de vingt ans à la Chapelle Rablais, voici maintenant
150 ans? Bijoutier, voiturier, garçon épicier ou cordonnier:
un seul.; cinq charrons, deux maréchaux ferrants. Des apprentis
ont dû se succéder, année après année
dans les ateliers près de la place du village. Puis ils prenaient
la route pour terminer leur apprentissage, nous avons ainsi retrouvé
les traces de l'un des fils de Félix: Louis Ferdinand qui fut dispensé
de service militaire pour avoir tiré au sort un bon numéro,
mais aussi du fait de sa taille trop réduite: 1,55 mètre.
Plusieurs années successives, il a sollicité un passeport
pour l'intérieur afin de se rendre dans différentes villes
de la région avant d'exercer sa profession de maréchal ferrant
à Coulommiers.
A part ces artisans, tous les autres conscrits, soit 9 sur 10, vivaient
directement de la terre: nous trouvons 3 terrassiers et un carrier qui
devait exploiter les carrières des Montils dont les grès
ont servi à renforcer les chaînages d'angles des bâtiments
et à paver la route Paris- Bâle, actuellement RN19.
89 jeunes gens vivaient de la culture: un vigneron, 3 marneurs, 2 gardes,
6 batteurs en grange, 9 bergers, 34 bûcherons, un scieur de long...
Les agriculteurs sont: cultivateurs:4, chartiers:45, manouvriers:11, domestiques:6,
journaliers:2, classés, dès vingt ans par ordre de prestige,
ou plutôt de fortune, tels étaient les métiers des
jeunes gens de vingt ans dans la première moitié du XIX°
siècle.
Le recensement nominatif de 1851 indique la profession de tous les actifs
de la commune: propriétaires cultivateurs:10, fermiers:3, journaliers:
218 dont 89 femmes, journaliers- propriétaires: 45, domestiques
d'exploitation:14, bûcherons charbonniers:1. Pour ce dernier métier,
il est probable que la plupart des bûcherons et cuiseurs de charbon
devait être itinérant et ne figure donc pas dans les statistiques
de la commune. Le bâtiment occupait sept maîtres, on trouvait
trois ouvriers dans l'habillement: il y avait une fabrique de schalls
(châles), 9 maîtres et 10 domestiques dans les cafés,
onze rentiers, un instituteur et un curé, six professions libérales:
des voituriers. 116 femmes vivaient du revenu de leur mari.
Les talons des passeports pour l'intérieur révèlent
quelques professions itinérantes, comme le chasseur de sangsues.
Cent un enfants en bas âge ne sont pas comptés parmi les
travailleurs puisqu'ils ont moins de sept ans!
Les nourrices
Denis Toussaint Félix
dont nous avons recherché les traces avec les élèves
nous a donné l'occasion de fouiller dans bien des documents. Ils
sont présentés dans un programme sur ordinateur "Félix,
maire", mis en forme par les élèves dans le cadre du
Club Informatique. Dans les registres paroissiaux prêtés
par M. le Curé avant qu'ils ne soient archivés au diocèse
et dans les registres d'état civil, nous avons retrouvé
ses actes de naissance, de mariage, son décès. La naissance
de ses onze enfants, leur mariage, les petits enfants... Parmi ceux-ci,
Céline Brigitte ne vivra que 11 mois, Alexandre Hyppolyte un mois
et demi, Louise Victorine sera ondoyée, c'est à dire baptisée
par la sage-femme car morte en naissant, d'autres encore mourront en bas
âge. Le destin le plus triste a été celui de sa fille
Anne Rose qui s'est mariée avec Louis François Picard et
eut 6 enfants. Trois moururent avant l'âge de deux ans, dont Pierre
Joseph pendant l'épidémie de choléra de 1832. Anne
Rose, elle même, décédera avant son père. A
l'époque, le taux de mortalité était de 28 pour mille,
presque trois fois plus que maintenant.
La mortalité infantile est particulièrement élevée;
en 1827, sur 9.961 naissances, 1.541 enfants sont morts avant l'âge
de trois mois. La plupart de ces nourrissons meurent à la fin de
l'été, en août, septembre. dossier
des Archives Départementales, Vivre sous les Bourbons
Notre Félix était parrain de nombreux enfants. Au hasard
des pages, car je n'ai pas tout lu, l'oeil cherchant à tomber sur
le nom Félix ou Rondinet, j'ai découvert le décès
d'un petit parisien: Pierre Louis Henry Flamant, âgé de 19
jours, mort le 19 frimaire de l'an 11. La déclaration portait le
nom de Denis Toussaint Félix, manouvrier et père nourricier
qui a signé et de Marie Anne Rondinet, nourrice, qui a déclaré
ne savoir signer.
Marie Anne était l'une de ces nombreuses nourrices de la campagne
qui élevait des "Petits Paris" du sein gauche pendant
qu'elle nourrissait ses propres enfants du sein droit. S'il faut en croire
le lieutenant général de police en 1780, sur
21.000 enfants nés à Paris, à peine 1.000 sont allaités
par leur mère, 1.000 par des nourrices qui viennent au domicile
des parents de l'enfant et 19.000 sont envoyés chez des nourrices
à l'extérieur de la ville
où ils étaient apportés à la campagne dans
des paniers à ânes ou par chariots entiers. "Je
n'ai jamais rencontré, sans éprouver une vive émotion,
ces larges voitures de meneurs dans lesquelles sont entassés pèle
mêle comme des animaux nourrices et nourrissons" s'attriste
encore Un auteur en 1866.
L'épopée des bébés, éd.
de la Martinière
Pendant des siècles, la majorité
des nourrissons sont trimballés par leur mère paysanne qui
les amène avec elle aux champs, dans des paniers d'osier. Il sont
aussi laissés sous la garde de quelque grand-mère ou d'une
grande soeur parfois âgée de moins de dix ans. Dans ce cas,
lorsque le bébé commence à marcher à quatre
pattes, il arrive qu'il finisse par se noyer dans la mare ou dans le puits
de la ferme. Pour toutes les femmes des villes qui doivent travailler,
il est hors de question d'élever au sein un bébé
pendant une année ou deux et de le surveiller à l'âge
où il commence à explorer la maison: la seule solution est
la mise en nourrice... L'épopée
des bébés.
Ce n'étaient pas seulement les riches bourgeoises soucieuses de
préserver leur ligne qui faisaient nourrir par
d'autres leurs bébés, mais la plupart des femmes de modeste
condition, obligées de travailler pour moins de deux francs par
jour (dans le Registre des renseignements statistiques de la commune pour
1857/61, c'est le salaire d'un journalier agricole).
Il aurait été intéressant de poursuivre cette recherche:
quels étaient les tarifs, combien parmi la centaine de femmes de
manouvriers, déclarées vivre du revenu de leur mari aidaient
à faire bouillir la marmite en élevant des Petits Paris,
quitte à accumuler grossesse sur grossesse pour continuer à
avoir du lait?
La réponse sera peut-être dans la prochaine édition
des documents sur le village, dans une dizaine d'années, si je
continue à ce rythme ou si quelqu'un veut bien reprendre les recherches
et pousser un peu plus loin l'enquête: aller aux Archives Nationales,
recueillir les témoignages des Anciens, trouver une meilleure interprétation
aux documents que je viens d'exposer... A suivre....
Pour terminer, deux personnages qui ont fait jaser dans les chaumières, bien oubliés depuis... Deux personnages ayant défrayé la chronique à leur époque vécurent à la Chapelle Rablais. La fortune ne leur sourit pas de la même manière: l'une eut la chance de devenir châtelaine, l'autre paya bien cher une rixe d'ivrognes.
![]() Voir les Petits Paris et enfants en nourrice à la Chapelle Rablais
Voir les Petits Paris et enfants en nourrice à la Chapelle Rablais
Eléonore Vergeot
Eléonore Vergeot, 21 Champs Elysées, Paris, château des Moyeux, la Chapelle Rablais eut des débuts bien modestes. Elle s'appelait alors Alexandrine, était repasseuse, dans la Somme, dans la ville de Ham. Ce bourg tire sa célébrité d'une forteresse où furent détenus, entre autres prisonniers politiques, Louis de Condé, le prince de Polignac, le général Cavaignac et Louis Napoléon Bonaparte. Celui- ci était emprisonné pour avoir tenté de renverser Louis Philippe en 1836 à Strasbourg puis en 1840 à Boulogne. Il s'en évada en 1846 en endossant les habits de l'ouvrier Badinguet, d'où le surnom qui lui fut donné. Le caractère du prisonnier commençant à s'aigrir du fait d'une chasteté prolongée, il lui fut octroyé une maîtresse choisie administrativement. Une dizaine de jeunes filles furent présentées au prisonnier, pour s'occuper de son linge, par l'entremise d'un abbé qui devint plus tard second aumônier du château impérial des Tuileries et évêque d'Adras. Alexandrine- Eléonore fut choisie; on l'appelait la Belle Sabotière, surnom qu'elle garda quand Louis Napoléon devint célèbre. Mais, en décembre 1842, le commandant du fort de Ham écrit à son ministre: "Par ma lettre du 26 novembre dernier, j'ai eu l'honneur de vous rendre compte que la femme que vous avez autorisée à entrer dans la prison pour visiter et réparer le linge était enceinte..." Le bébé naquit le 25 février 1843 et reçut les prénoms de Eugène Alexandre Louis. Le père demanda à une amie intime, Mme Cornu (aucun rapport avec les seigneurs du XIII° siècle), de le prendre en pension. André Castelot note qu'en mars 1845, à force de repasser le linge du prisonnier, Eléonore met au monde un second fils, Louis. Vous pourrez suivre leur carrière dans les Histoires d'amour de l'histoire de France de Guy Breton. Eléonore ne devint pas impératrice, Napoléon III ayant épousé Eugénie de Montijo en 1853. Elle se maria en 1858 avec Pierre Jean François Bure, frère de lait de Napoléon III, trésorier général de l'Empire qui acquit les Moyeux en 1865. Il revendit le château en 1870, pour partager l'exil de la famille impériale en Angleterre après le désastre de Sedan et la capitulation devant les Prussiens. Eleonore Bure née Alexandrine Vergeot-Camus mourut en 1886.
sources: RC Plancke: Nangis et son canton à la belle époque / André Castelot: Napoléon Trois / Guy Breton: histoires d'amour de l'histoire de France tome 9
![]() voir la page du site, mise à jour, qui lui est consacrée
voir la page du site, mise à jour, qui lui est consacrée
Vincent Paré
En 1783, Vincent Paré,
ancien serviteur de monsieur Belin, curé de la Chapelle Rablais
est accusé:
1° du vol de quatre chemises et de pièces de toile dérobées
chez le curé
2° d'avoir excédé de coups Pierre Gardenet au sortir
du cabaret de la Garde de Dieu
3° d'avoir violé la femme Gardenet dans un fossé et
de l'avoir dépouillée de ses vêtements pour les voler
4° d'avoir volé un fouet de postillon à Seguin, garçon
meunier plus un habit à un compagnon de chambre plus une bêche.
Il a été condamné à être pendu, exposé
pendant vingt quatre heures puis porté aux fourches patibulaires.
De plus, il devait payer une amende de cent livres et voir tous ses biens
confisqués.
Ayant fait appel, la Cour de Cassation le condamne le 17 janvier 1783
à:
1° subir la question ordinaire et extraordinaire
2° avoir bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs par l'exécuteur
puis, mis face tournée vers le ciel tant et si longtemps qu'il
plaise à Dieu de lui conserver la vie.
3° une amende de deux cents livres et confiscation des biens.
Dans la République de Seine et Marne du 8 décembre 1980, édition de Fontainebleau, page de Montereau.