Passez la souris sur les
illustrations pour leur légende.
Ctrl + pour agrandir la page
Etienne Fare Charles
Huvier/14
1724/1784 Curé de la Chapelle Rablais...
Premiers pas à Marolles, finances

Pour le financement de ses deux paroisses, le curé
Renard bénéficiait de la dîme, mais il n'était
pas seul : le prieur de Choisy "étoit
aussi décimateur de toute espèce de dixmes, à l'exception
d'un petit canton dont jouissoit le curé
Michelin
Sur une somme d'environ 1.000 livres, le curé de Choisy devait
gérer deux paroisses et payer deux vicaires, Huvier qui desservait
Marolles et François Joseph Sarazin qui l'assistait à
Choisy (ce dernier continuera le vicariat de Marolles après le
départ d'Etienne Fare Charles Huvier pour la Chapelle Rablais,
en 1752, et ce jusqu'à son décès, en 1769; il fut
inhumé dans l'église du village.)
Je pensais naïvement que les dîmes n'étaient prélévées
que par les curés, pour subvenir à leurs besoins, et que
ces prêtres passaient de champ en champ pour désigner la
part qui leur revenait. Tout était bien plus complexe !
Les dîmes de Marolles, étaient partagées
entre "le prieur, le curé de
Choisy, l'abbesse de Jouarre, le chapelain de la Petite Mère Dieu
dans l'église paroissiale de Coulommiers et l'Hôtel-Dieu
de la même ville." Michelin
Essais ... sur le département de Seine-et-Marne 1829/1841
Les décimateurs cités par Michelin étaient
tous religieux, parmi eux, le chapelain de la Petite Mère de Dieu
que nous avons découvert à la septième page de ce
dossier, dont le maigre bénéfice ne s'élevait qu'à
70 livres. ![]()
Pour complexifier un peu le tout, un laïc, "Mr
de Laval, seigneur de Montferrat &." (que l'on retrouvera
plus loin quand le curé Huvier bénira la chapelle de l'Orme
de Montferrat à Courtacon) semblait revendiquer le droit de dîmage
sur la paroisse de Marolles, puisqu'il en fit lever le plan.
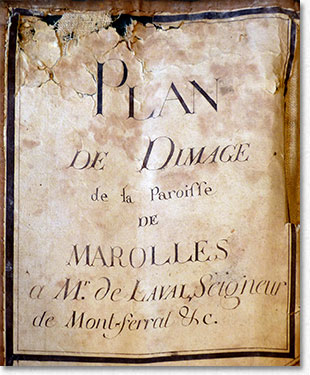
Ce "Plan de dimage de la paroisse de Marolles" ayant subi les outrages du temps (transmis par un descendant de Mr de Laval, que je remercie encore) peut être rapproché du plan d'Intendance (vers 1780) en passant la souris sur l'image ci-dessous. Même orientation, mêmes parcelles, mêmes superficies à une "perche" près. Seuls diffèrent les noms de lieux, plus détaillés sur le plan de dîmage. On trouvera dans la longue page annexe, les recherches relatives à ce plan ainsi que les actes de bénédiction de la chapelle du château de l'Orme.
![]() Doc : Laval de Montferrat, Marolles et Courtacon
Doc : Laval de Montferrat, Marolles et Courtacon
Le mode de perception de la dîme de Marolles n'intéressait
pas directement Etienne Huvier, son traitement ne dépendait que
du curé de Choisy. On ne sait pas quelle somme fut laissée
au vicaire de Marolles et à son collègue de Choisy par le
curé titulaire, pour subsister. Un édit royal du 13 mai
1768 fixa le salaire minimum (portion congrue) à cinq cents livres
pour les curés et seulement deux cents pour les vicaires. Qu'en
était-il en 1749 et le curé Renard s'était-il montré
plus généreux? Le vicaire bénéficiait aussi
de quelques faibles biens appartenant à la cure : le presbytère
et ses dépendances, ainsi que trois quartiers d'arpent de terre
et autant de prés; soit un jardin de curé et de l'herbe
pour son cheval. Source : Biens nationaux
AD77 extraits du classeur 1Q...
![]() Doc: portion congrue, dîmes et novales
Doc: portion congrue, dîmes et novales

Les charges
liées à l'église, le cimetière et la maison
d'école ne relevaient pas de la Cure, mais de la Fabrique qui en
était possesseur et pourvue de biens pour les entretenir. A la
suite de donations, la Fabrique disposait de rentes et de terres qu'elle
mettait en location. Chaque année, un acte devant notaire fixait
les baux arrivés à terme après trois, six ou neuf
années de location; de quatre à six renouvellements chaque
année de présence Etienne Fare Charles Huvier qui participait
à ces réunions, en soutien du marguillier, renouvelé
tous les ans, responsable des fonds :
"Ce jourd'huy dimanche quatrième
jour du mois d'avril mil sept cent cinquante et un, issus des vespres
et complies ditte et chanttée en l'église parroissialle
Saint George et St Thomas de Marolle en Brie, les habittans de ladite
parroisse étant assemblée au devant de la principalle porte
et entrée de l'église et place publique dudit Marolle, après
avoir sonnée la cloche à la manière accoutumée
et sur le réquisitoire de Mesire Estienne Farre Huvier prestre
vicaire de l'église parroissialle dudit Marolle en Brie, pour suitte
et diligence de Pierre Duvalle* manouvrier demeurant à Bois Saint
Georges paroisse de Marolle en nom et comme marguillier et proviseur de
l'église parroissialle dudit Marolle a éttée procédé
par devant Jacques Christophe Camus nottaire substitut de juré
commis aux branches des parroisse de Choisy et Marolle en Brie, dépendant
du tabellion de Coulommier en Brie, résident audit Choisy soussigné
un bail à loyer et adjudications en délivrance des terres
prez et bois appartenant à la dite église fabrique dudit
Marolle au plus offrant et dernier enchérisseur à la manière
accoutumée, pour les temps terme et espace de trois six ou neuf
années consécutives..."
Minutes du notaire Camus à Choisy AD77 67 E 20 / * Pierre Duval
1710/1785 se trouve être mon ancêtre
D'après la liste qui en a été établie pour la vente des Biens nationaux, la Fabrique disposait de cinquante arpents et quarante six perches de terres et prés. Des comptes au brouillon en fin de l'acte de location du 14 mars 1750 semblent comptabiliser, pour l'un des rentes pour cinquante six livres un sol auprès de particuliers "une livre par les héritiers Jean Guiot" et "quinze livres par l'hotelle dieu de Paris", pour l'autre trois cent vingt trois livres et quatre sols qui pourraient correspondre aux locations de terre, sans certitude car les archives de la Fabrique de Marolles sous l'Ancien Régime n'ont pas été conservées. On pourra avoir une idée du budget d'une Fabrique en parcourant celui de la Chapelle Rablais, paroisse où officia le curé Huvier à partir de 1752.
![]() Doc : biens de la Fabrique de Marolles, actes de baux
Doc : biens de la Fabrique de Marolles, actes de baux
![]() Doc: Biens nationaux à Marolles en Brie
Doc: Biens nationaux à Marolles en Brie
![]() Doc : budget de la Fabrique de la Chapelle Rablais
Doc : budget de la Fabrique de la Chapelle Rablais
![]() Fabrique, marguilliers, hommes vivants et mourants, dossier de trois pages
Fabrique, marguilliers, hommes vivants et mourants, dossier de trois pages
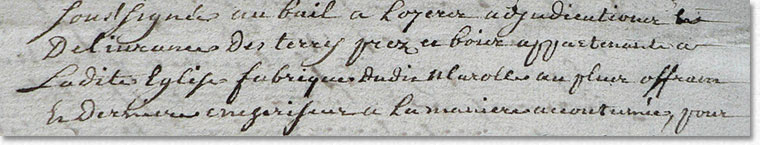
"Le 7 juilliet 1775 a été inhumé dans le cimetière
de ce lieu le corps de deffunte la veuve Griffaut décédée
chez Constantin Griffaut son fils - de cinquante sols et une messe haute
de dix sols et les vigilles à neuf leçons de trente sols
et la levée du corps de dix sols... Le cinq mars 1776 a été
inhumée dans le cimetière de ce lieu le corps de deffunte
François Angélique leRoy dit Dauphin âgée de
39 ans femme de François Lentenois (Lantenois) demt à Malnoux
de trois livres une messe et un nocturne et les laudes... "
AD 77 Journal de Louis Pilliot 279 J 1
Le desservant de Marolles bénéficiait du casuel et des obits
: "Le casuel est une rétribution accordée
au cas par cas au clergé pour l'exercice de certains ministères
(baptêmes, bénédictions, funérailles, mariages)
ou encore lors des quêtes... Un obit (du latin obitus, c'est-à-dire
mort) est un service religieux célébré en mémoire
d'un défunt et pour le salut de son âme, à une date
fixe de l'année (généralement le jour anniversaire
du décès). Les obits étaient célébrés
par le curé ou le vicaire de la paroisse du défunt ou par
un prêtre obituaire. Wikipédia
On verra plus loin que les baptêmes ne donnaient pas lieu à
une rétribution.
Trace d'un obit à Marolles,
cette messe hebdomadaire célébrée en souvenir d'une
ancienne paroissienne: "Sire Joseph-Joachim
Goblet, ancien consul de la ville de Paris, a fondé à perpétuité
dans cette église une messe basse tous les lundis de chaque semaine,
en mémoire et pour le repos de l'âme de Marie-Geneviève
Giraudet, sa chère épouse, qui a puisé sur les fonts
baptismaux de cette paroisse les vertus dont elle étoit douée,
et pour le repos de la sienne après son décès, avec
recommandation au prosne, suivant qu'il est énoncé par le
contrat passé devant Hazon, notaire à Paris, le 13 août
1742. Requiescant in pace.
Cette épitaphe, en lettres dorées, est à droite dans
le choeur, sur un tableau de marbre blanc."
Marolles dans Michelin 1841 tome 4 p 1334 et suivantes
![]() Doc : casuel & obit à Marolles
Doc : casuel & obit à Marolles

Les dépenses qu'Etienne Huvier fit
à Marolles pour l'église furent minimes : une croix de bois,
une niche pour la Vierge...
"Le samedy vingt neuf janvier mil sept cent cinquante deux la niche de la Ste Vierge à été posée. Cette niche à été faite par Prouharam le Bearnet* menuisier à Coulomiers. Toute posée elle à couttée vingt livres laquelle somme à été prise sur les quêtes qu'on à coutume de faire pour la Ste Vierge. Les deux branches de fer ont couté chacune vingt cinq livres." Registre paroissial de Marolles en mairie
* Jean Pierre Prou Haram, dit le Béarnois 1721/1783. Son fils, Jean Pierre 1755/1830 sera uni à Marie Pernelle dans la chapelle de la ferme du Mée à Saints par Etienne Fare Charles Huvier le 14 mai 1782.

On trouve une statue de la Vierge dans une niche de l'ancien presbytère, mais s'agit-il de celle installée par le curé? On peut en douter car on ne comprendrait pas l'utilité des deux "branches de fer" qui auraient pu en constituer le support.
Quant à essayer d'en retrouver la trace
dans l'église, c'est quasiment mission impossible, tant le bâtiment
a été remanié : "Le
terrain étant sablonneux et argileux, l'église est plusieurs
fois restaurée, notamment au XIXe siècle."
Coulommiers tourisme
Dans sa monographie rédigée en 1889,
l'instituteur en traça le plan et l'élévation (ci-contre)
et précisa : "En 1811, l'église
de Marolles subit une transformation et des réparations importantes.
M. Quatre Solz, seigneur et maire, la fit diminuer de deux travées,
et la tour d'une très grande solidité, en fut alors séparée,
mais en 1812, elle fut également démolie et remplacée
par un clocher peu élégant, reconstruit à neuf
en 1857. Les pierres provenant de la démolition de 1811 furent
employées à la réparation du chemin du château."
Monographie de l'instituteur AD77 30 Z 251
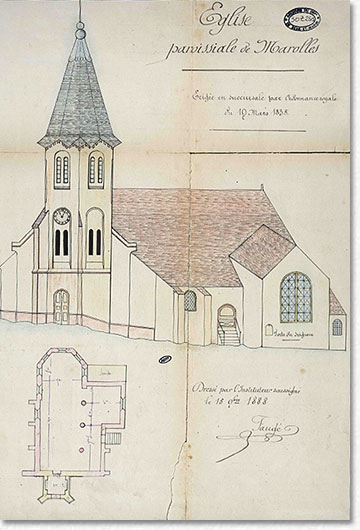
Louis Pierre Pilliot, dernier représentant
d'une longue lignée d'instituteurs à Marolles, que nous
retrouverons plus loin, nota dans un gros livre-journal :
"Possition ou changement de l'église
de Marolles depuis 1811 jusqu'en 1857
En 1811 les maçons étaient sur l'église pour retenir
la couverture, une poutre craque dans l'église, elle a fendu,
on remet à l'éteiller le lendemain, mais dans la nuit,
la poutre casse, elle en fait casser une autre, brise tous les bans
ainsi que la chaire à prêcher, la tuille, la latte, les
chevrons, tout était brisé. Monsieur Stanislas Quatresols,
seigneur de Marolles et maire de la commune, au lieu de remettre deux
poutres pour relever les deux travées fait diminuer l'église
de deux travées, remonte le pignon de deux arcade, la tour qui
aurait duré plus de mil ans se trouvait seul séparée
de l'église d'une arcade, il fait démolir la pauvre tour
qui était d'une solidité sans pareil, où il y avait
deux cloches à côté l'une de l'autre..." AD77
279 J 1
![]() Découvrir la suite de "possition et changement de l'église
de Marolles depuis 1811 jusqu'en 1857
Découvrir la suite de "possition et changement de l'église
de Marolles depuis 1811 jusqu'en 1857

"Le dimanche sept novembre mil sept cent cinquante un après
les vespres, dimanche dans l'octave de la Toussaint, j'ai bénie
une croix que j'ai fait planter près le cimetière au coin
de la haye du jardin qui appartient à la succursale ... La permission
pour faire cette croix m'à été accordée
par Mr l'abbé Garnier grand vicaire de M. de Fontenilles évêque
de Meaux. L'arbre qui à servi pour construire cette croix à
été abbatu dans un petit morceau de pré appartenant
à l'église près le Bois de la Bourdonne. Huvier
vic. desservant de Marolles.
Notte marginale : J'ai fait mettre cette croix en couleur sur la fin
du mois de may mil sept cent cinquante deux par un maître vitrier
de Joüy sur Morin, il en a couté neuf livres."
Registre paroissial en mairie
Il ne s'agit pas de ces croix dans le cimetière,
mais d'une croix de bois vert tout juste coupé dans un "pré
appartenant à l'église",
autrement dit, dans les biens de la "Fabrique"
qui régla certainement la note (élevée!) de neuf
livres pour la peinture.

Notons que, pour l'érection de cette croix, le vicaire Huvier n'a pas fait référence à une autorisation de son curé, qui ne sera jamais mentionné dans les registres, mais a fait remonter la demande jusqu'à l'épiscopat... Peut être parce que ce n'était pas une simple croix, mais une étape symbolique : "... j'ai bénie une croix que j'ai fait planter près le cimetière au coin de la haye du jardin qui appartient à la succursale. Cette croix a été plantée pour faciliter les stations du jubilé dont j'ai fait l'ouverture le mercredy trois dudit mois. J'ay commencé les processions ordonnées pour le jubilé le onze du même mois jour et fête de Snt Martin après les vespres. La première station à été la chapelle de la vierge, la 2e la croix du cimetière, la 3e celle plantée pour le jubilé et la quatrième le maître autel. La permission pour faire cette croix m'à été accordée par Mr l'abbé Garnier grand vicaire..."
"Les occasions de célébrer un jubilé étaient fréquentes. En plus des Années Saintes – ou plus exactement de leur extension à la catholicité un ou deux ans après les solennités romaines, deux grands types de jubilé étaient proposés aux fidèles; les uns accompagnaient l’avènement d’un nouveau pape ; les autres étaient liés à des circonstances exceptionnelles..." C'était "un temps de grâce, au cours duquel la réconciliation du pécheur avec Dieu est facilitée par l’octroi de l’indulgence plénière et les possibilités de remise des fautes les plus graves par les confesseurs". Site HAL SHS
Vingt huit jubilés universels eurent lieu au XVII°
siècle et dix au XVIII°, sans compter plus d'une dizaine
particuliers à la France. Etienne Fare
Charles Huvier en célébra cinq : en 1751, année
sainte, 1759 en l'honneur du nouveau pape Clément XIII, 1766,
1770 pour Clément XIV et 1776 pour Pie VI, nous aurons l'occasion
d'y revenir plus loin...
Le pape Benoît XIV avait débuté la célébration
du Jubilé du demi-siècle la veille de Noël 1749 en
ouvant les Portes Saintes à Rome; les célébrations
de cette année sainte eurent lieu en France à l'automne
1751.
Le vicaire Huvier indiqua, en peu de mots, comment elles se déroulèrent
dans sa petite paroisse : des processions d'une station à l'autre
dans un petit périmètre dans et autour de l'église.
En 1776, il précisera les cérémonies et les parcours
pour "gagner le jubilé" (indulgence plénière)
à Cerneux :
"Suivant la Bulle Confession Comunion,
15 jours de stations dans quatre églises suivant le mandement
de son Eminence, confessions, stations et comunions les 15 jours de
stations réduits à l'assistance à cinq processions.
1ere station le choeur, 2e la croix du premier cimetière, 3e
celle du 2nd, 4° la croix de Saint Pierre... à chaque stations
3 pater et 5 ave Maria" Registre
paroissial de Cerneux
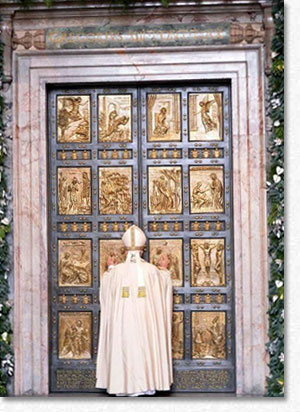 Ouverture
des portes au Vatican pour le jubilé 2025
Ouverture
des portes au Vatican pour le jubilé 2025
Cette simple procession dans une petite
commune était fort éloignée des fastes déployés
à Chartres, pour ce même jubilé de 1751. Après
une procession générale dans les rues de la ville, débuta
une mission de vingt huit jours où s'illustra, entre autres prédicateurs,
le père Bridayne qui prêcha 256 missions en 45 ans.
"... dès cinq heures du matin l'auditoire
était complet, et certains zélés attendaient depuis trois
heures l'ouverture des portes de l'église. Des personnes de qualité,
jusqu'à l'arrivée des missionnaires, faisaient des lectures
édifiantes ou chantaient des cantiques. M. l'évêque disait
la messe, puis le père Bridayne prêchait pendant quatre ou cinq
heures à genoux avec tant d'onction et d'ardeur que son surplis en
était baigné de sueur... quatre mille hommes rangés deux
à deux employèrent trois quarts d'heure pour venir se masser
devant le grand portique de la cathédrale, lieu destiné jadis
aux amendes honorables. M. Guinot, debout devant la porte fermée de
l'église, exhorta la multitude à se prosterner devant Dieu,
pour lui demander pardon des fautes scandaleuses qu'elle avait commises; le
peuple se prosterna donc, après quoi il reçut la bénédiction
de la main du prélat."
Célébration du jubilé
à Chartres par Emile Bellier de la Chavignerie 1855

| Doc : Laval de Montferrat, Marolles et Courtacon | |
| Début de la biographie du curé Huvier | |
| Curés et paroissiens, page des choix | |
| Curés et paroissiens, documents | |
|
|
|

