

Soyeurs, piqueurs, sapeurs
et autres calvarniers
Piqueurs & sapeurs / 4

La faux " s'emploie de deux
manières, selon l'espèce de grain qu'on veut couper. On fauche
en dedans ou en dehors. La première méthode s'emploie pour
les céréales dont les chaumes ont une certaine hauteur, et
généralement pour les diverses espèces de froment et
de seigle.... On fauche en dehors les céréales qui n'ont que
peu de hauteur parce que les chaumes ne pourraient soutenir ceux qui sont
coupés."
Maison rustique du XIXe siècle 1835
"Voici comment le piquage s'opérait
: Le piqueux, ayant la céréale à couper à sa
gauche, donnait les coups de faulx de manière que les crochets de
son harnais, ramassant la portion coupée, la plaçait debout,
ou très peu penchée, ce qui était préférable
pour le ramasseur, en portant cette coupe à gauche contre le reste
de la céréale non coupée. Un rémasseux (ramasseur),
qui était souvent la femme du piqueux (dite alors la rémâsseuse),
suivait derrière en enlevant par brassiées (brassées)
l'andain coupé, déposait chaque brassiée su' in ièn
(chaque brassée sur un lien) qu'il venait de faire avant sa brassée,
s'il était assez habile pour faire les liens et ramasser en suivant
le piqueur. Mais, le plus souvent, c'était un enfant qui faisait
les liens et les plaçait à la portée du ramasseur,
ou bien quelquefois c'était une troisième grande personne
qui fabriquait ces liens et liait les gerbes derrière le ramasseur.
Souvent alors, dans ce cas, le ramasseur et le lieur changeaient réciproquement
de fonction à l'andain suivant, le travail du ramasseur étant
le plus pénible, même que celui du piqueur. On mettait deux
moyennes brassées, sur un lien, pour faire une gerbe."
Le patois briard , Auguste Diot, Société
d'Histoire et d'Archéologie de l'Arrondissement de Provins. 1930

Soir de moisson; moment crépusculaire, on
s'imagine volontiers, assis sous un portail, admirant ce reste de jour dont
s'éclaire la dernière heure du travail, pendant que, déployant
ses voiles, l'ombre où se mêle une rumeur, semble élargir
jusqu'aux étoiles, le geste auguste du faucheur ! pour détourner
quelque peu les vers du grand Victor.
Dommage pour le cliché romantique, le moissonneur, au début
du XIX°, "travaille courbé,
replié sur lui-même, dans une position fatigante qui exige,
pour être supportée, un très long entraînement.
Son labeur est d'autant plus rude qu'il se poursuit de l'aube au soleil
couché. " La moisson se fait
le plus souvent à la faucille.
En italiques: extraits du Petit Journal illustré, 28 Juin 1908
"La grâce robuste et noble de la faux" est rare: environ cent cinquante moissonneurs à la faucille, des soyeurs, sont venus à Grandpuits en 1809 contre seulement neuf à dix faucheurs. L'agent municipal précise que les soyeurs viennent des régions proches: Yonne et Aube alors que les faucheurs sont originaires des Ardennes.
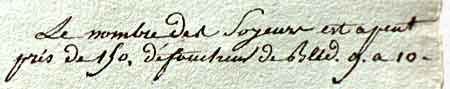 |
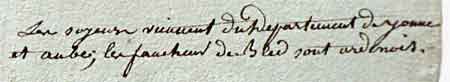 |
 |
|
 |
Autre technique, autre outil: la sape flamande: "Cet
instrument
est une courte faux fixée à un manche d'environ soixante centimètres
de longueur et terminée, à l'extrémité opposée
à la lame,
par un coude que l'ouvrier saisit de la main droite.
L'usage de cet outil est complété par un crochet en fer
que le piqueteur tient de la main gauche et avec lequel
il maintient et étend par terre la javelle
qu'il vient de faucher." Petit Journal
illustré
Si le rédacteur de la Maison Rustique se sent incapable d'expliquer
le maniement de la sape flamande alors qu'il dissèque l'usage de
la faux et de la faucille -saviez- vous qu'il existait un usage anglais
de cet instrument?- c'est qu'il s'agit là d'une technique de véritables
professionnels de la moisson, bien que quelques lignes plus loin: "Elle
est facilement maniée par les femmes, coupe le blé versé
avec une perfection et une promptitude que l'on chercherait vainement à
rencontrer dans un autre instrument. La sape est, je crois, l'instrument
le plus avantageux pour moissonner les céréales dans les circonstances
actuelles."
Comme le nom de l'outil l'indique, les "sapeurs"
viennent du Nord. Le résumé de la Préfecture pour l'enquête
de 1809 les fait tous venir de l'Aisne: "Sciage
des bleds, méteils et seigles, dans ce nombre il y en a environ 150
qui fauchent les bleds, ils viennent du dpt de l'Aisne."
En dépouillant les fiches communales, leur provenance se précise:
nous avons vu que GrandPuits accueillait neuf ou dix faucheurs ardennais;
on trouve cités des Normands à Soignolles et Limoges-Fourches
(peut être la même équipe puisque les villages sont proches);
venant de l'Aisne: à "Comblaville"
soixante moissonneurs, à Montereau sur le Jard une douzaine, 8 à
9 à Réau; un tout seul, venu de Seine et Oise pour les moissons
à Vaux le Pénil. Nous trouvons aussi des "Belges",
venus du Brabant et du département de Jemmapes d'où sont originaires
tant de voituriers étudiés dans un autre chapitre.
![]() Doc: le département de Jemmapes
Doc: le département de Jemmapes
![]() Doc: la Maison Rustique 1835, instrumens pour moissonner...
Doc: la Maison Rustique 1835, instrumens pour moissonner...
![]() Doc: Foins et Moisson dans l'Encyclopédie Diderot
Doc: Foins et Moisson dans l'Encyclopédie Diderot
Un petit bond dans le temps pour éclairer
les pratiques des Piqueteurs flamands au début du XX° siècle.
Il est possible qu'un siècle avant, ils aient eu les mêmes
habitudes, sinon, comment justifier le long déplacement depuis les
frontières Nord de la France jusqu'en Brie?
"Dès le mois de Juillet, ils sont en Sologne, en Beauce et en
Brie, puis progressivement ils remontent vers leur pays d'origine, besognant
de leur infatigable piquet, moissonnant, abattant sans relâche les
blés mûrs sur leur passage. A la fin de Juillet et au début
d'Août, leurs silhouettes tassées se détachent sur l'horizon
des plaines de l'Ile-de-France et du Valois. De là, ils gagnent la
Picardie, puis l'Artois, le Hainaut et la Flandre française. Ils
y arrivent à point pour couper et rentrer leurs propres moissons...
Et, cela fait, ce n'est pas encore le repos, car ces mêmes hommes,
qui ont moissonné tout l'été au grand soleil des champs,
passeront tout l'hiver enfermés au logis devant leurs métiers
à tisser." Le Petit Journal
illustré du 28 Juin 1908

Il semble que les bandes de piqueteurs
aient été capables de faire entendre, avec plus ou moins de
succès, leurs voix:
" Il y a trois ans, leur travail ayant été rendu plus
difficile par la "verse", c'est-à-dire par le fait que,
partout, les orages avaient couché le blé, les piqueteurs
doublèrent et même triplèrent leurs exigences... Une
autre raison déterminait encore leurs prétentions: depuis
quelques années, les moissonneuses mécaniques leur font concurrence
dans les grandes exploitations agricoles. Mais ces machines ne peuvent fonctionner
utilement que si le blé n'a pas été atteint par les
coups de vent. Les piqueteurs, cette année-là, avaient cru
trouver l'occasion de prendre leur revanche et d'imposer leurs conditions...
En dépit de cette loi économique qui veut que les salaires
de l'ouvrier diminuent quand la machine entre en jeu, ils prétendaient,
au contraire, voir augmenter les leurs dans des proportions exagérées.
Mal leur en prit. Ceux d'entre eux qui ne voulurent pas capituler et accepter
le travail aux conditions proposées par les cultivateurs durent regagner
leur pays la bourse à peu près vide. Depuis si longtemps que
les travaux de la moisson dans le Nord de la France ne se faisaient plus
sans eux, les piqueteurs belges avaient de bonnes raisons de se croire indispensables.
L'événement leur prouva le contraire. 0n fit appel aux contingents
ruraux de l'armée, et la moisson put se faire sans encombre.
"Le Petit Journal illustré du 28 Juin
1908
![]() Doc: les Piqueteurs dans le Petit Journal illustré 1908
Doc: les Piqueteurs dans le Petit Journal illustré 1908
"Les dix-huit à vingt
millions de salaires que les moissonneurs belges emportent, chaque année,
en Flandre, demeureront dans nos villages, et nous pourrons enfin voir la
moisson de France faite par des Français." telle est
la conclusion cocardière de l'article du Petit Journal, en 1908.
Un ou deux siècles auparavant, la situation devait être tendue
entre ces professionnels de la moisson, les paysans du cru et les familles
de journaliers: "Cette mobilité géographique
fut porteuse de changements techniques. Soucieux d'expédier leur
travail pour se louer dans plusieurs domaines successifs au fur et à
mesure de la maturité des grains, les "horsains" apportaient
des procédés de récolte plus expéditifs mais
aussi plus de dextérité. II en résulta une concurrence
accrue entre moissonneurs forains, véritables travailleurs d'élite,
préférés par les exploitants qui élevèrent
leurs salaires en argent tout en gagnant sur la rapidité du travail
et sur les pailles, et moissonneurs locaux attachés aux techniques
et aux usages traditionnels. Tout cela aggravait le conflit avec la communauté
rurale qui défendait âprement ses droits traditionnels."
Dictionnaire de l'Ancien Régime, PUF
![]() Doc: l'article "moissons" du Dictionnaire de l'Ancien Régime
Doc: l'article "moissons" du Dictionnaire de l'Ancien Régime

Dans les terres de nuit baignées,
Je contemple, ému, les haillons
D'un vieillard qui jette à poignées
La moisson future aux sillons.
Sa haute silhouette noire
Domine les profonds labours
On sent à quel point il doit croire
A la fuite utile des jours.
Il marche dans la plaine immense,
Va, vient, lance la graine au loin,
Rouvre sa main et recommence,
Et je médite, obscur témoin,
Pendant que, déployant ses voiles,
L'ombre où se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu'aux étoiles,
Le geste auguste du semeur.

